SCULPTURE, s. f. Nous comprendrons dans cet article la statuaire et la sculpture d’ornement. Il serait difficile, en effet, de séparer, dans l’architecture du moyen âge aussi bien que dans celle de l’antiquité, ces deux branches du même tronc ; et si, dans les temps modernes, les sculpteurs statuaires se sont isolés, ont le plus souvent pratiqué leur art dans l’atelier, en ne tenant plus compte, ni de l’ornementation, ni de l’architecture, c’est une habitude qui ne date guère que du XVIIe siècle, née au sein des académies. Jadis les sculpteurs statuaires n’étaient que des imagiers. Ce titre ayant paru maigre, on l’a changé. Ces imagiers travaillaient pour un monument, dans les chantiers de ce monument, concouraient directement à l’œuvre, sous la direction du maître ; mais aussi leurs ouvrages (qu’on veuille bien nous passer l’expression) étaient immeubles par destination. L’institution des académies ne pouvait tolérer une pareille servitude : les imagiers, devenus statuaires, ont prétendu travailler chez eux et n’écouter que leur inspiration ; ils ont ainsi pu faire des chefs-d’œuvre à leur aise, mais des chefs-d’œuvre meubles meublants, qu’on achète, qu’on place un peu au hasard, comme on achète et l’on place dans un appartement un objet précieux. Depuis quelques années cependant, on a cherché à rendre à la statuaire une destination fixe, on a tenté de revenir aux anciens errements ; quelques statuaires ont été appelés à travailler sur le tas, c’est-à-dire à exécuter sur le monument même des parties de sculpture, suivant une donnée générale définie, arrêtée. Mais, malgré ces tentatives dont nous apprécions la valeur, l’habitude du travail de l’atelier était si bien enracinée, que ces sculptures semblent, le plus souvent, des hors-d’œuvre, des accessoires décoratifs apportés après coup, et n’ayant avec l’architecture aucuns rapports d’échelle, de style et de caractère. Nous n’avons pas à apprécier ici le plus ou moins de valeur de la sculpture moderne. Nous avons seulement tout d’abord à établir cette distinction entre les œuvres de l’antiquité, du moyen âge et des temps modernes, savoir : que, dans l’art du moyen âge, la sculpture ne se sépare pas de l’architecture ; que la sculpture statuaire et la sculpture d’ornement sont si intimement liées, qu’on ne saurait faire l’histoire de l’une sans faire l’histoire de l’autre.
Cette histoire de la sculpture du moyen âge exige, pour être comprise, que nous jetions un regard rapide sur les œuvres de l’antiquité, lesquelles ont influé sur l’art occidental à dater du XIe siècle, tantôt directement, tantôt par des voies détournées, très-étranges et généralement peu connues.
La sculpture, dans l’antiquité, procède de deux principes différents, qui forment deux divisions principales. Il y a la sculpture hiératique et la sculpture qui, prenant pour point de départ l’imitation de la nature, tend à se perfectionner dans cette voie, et sans s’arrêter un jour, après être montée à l’apogée, descend peu à peu vers le réalisme pour arriver à la décadence. Les peuples orientaux, l’Inde, l’Asie Mineure, l’Égypte même, n’ont pratiqué la sculpture qu’au point de vue de la conservation de certains types consacrés. La Grèce seule s’est soustraite à ce principe énervant, est partie des types admis chez des civilisations antérieures, pour les amener, par l’observation plus sûre et plus exacte de la nature, par une suite de progrès, soit dans le choix, soit dans l’exécution, au beau absolu. Mais, par cela même qu’ils marchaient toujours en avant, les Grecs n’ont pu établir ni l’hiératisme du beau selon la nature, ni l’hiératisme du convenu, d’où ils étaient partis. Après être montés, ils sont descendus. Toutefois, en descendant, ils ont semé sur la route des germes qui devaient devenir féconds. C’est là, en effet, ce qui établit la supériorité du progrès sur le respect absolu à la tradition, sur l’hiératisme. S’il n’en était pas ainsi, on pourrait soutenir que l’hiératisme, en le supposant arrivé dès l’abord à un point très-élevé, comme en Égypte, est supérieur au progrès, puisqu’il maintient l’art le plus longtemps possible sur ce sommet, tandis que la voie progressive atteint la perfection un jour, pour descendre aussitôt une pente opposée à celle de l’ascension. L’art hiératique est stérile. Ses produits pâlissent chaque jour, à partir du point de départ, pour se perdre peu à peu dans le métier vulgaire, d’où les civilisations postérieures ne peuvent rien tirer. Il est impossible de ne pas être frappé d’étonnement et d’admiration devant les sculptures des premières dynasties égyptiennes. Il semble que cet art si complet, si élevé, dont l’exécution est si merveilleuse, doive fournir aux artistes de tous les temps un point d’appui solide. Il n’en est rien cependant ; cette admiration peut conduire à des pastiches, non à de nouvelles créations. Cet art, si beau qu’il soit, est immédiatement formulé comme un dogme ; on ne peut rien en retrancher, rien y ajouter : c’est un bloc de porphyre. L’art grec, progressiste (qu’on nous passe le mot), est au contraire un métal ductile, dont on peut sans cesse tirer des produits nouveaux. Pourquoi certaines civilisations ont-elles produit des arts fixés, pour ainsi dire, dans un hiératisme étroit ? Pourquoi d’autres ont-elles fait intervenir dans les productions d’art la raison humaine, les passions mobiles, les sentiments, la philosophie, le besoin de la recherche du mieux ?
Cela serait difficile à expliquer en quelques lignes, et nous reconnaissons que le sujet est délicat à traiter. Cependant il est une observation que nous croyons devoir faire ici, d’une manière sommaire, parce qu’elle nous aidera plus tard à expliquer les singulières évolutions de l’art de la sculpture pendant le moyen âge. D’ailleurs, comme nous ne saurions, admettre en ces matières, non plus que dans toute autre, l’intervention du hasard, puisque nous voyons l’effet, la cause doit exister. Quelle est-elle ? Nous croyons l’entrevoir dans les aptitudes propres à certaines races. Remarquons d’abord que toute explosion d’art — et la sculpture est ici en première ligne — ne se produit dans l’histoire qu’au contact de deux races différentes. Il semble que l’art ne soit jamais que le résultat d’une sorte de fermentation intellectuelle de natures pourvues d’aptitudes diverses. Examinons donc d’abord sous quelles influences se développent les arts.
Tous les hommes, ou plutôt toutes les races humaines ne sont pas également portées vers le besoin d’examiner et de comprendre. Aux unes, il suffit de croire et d’ériger les croyances en système ; pour les autres, les croyances ne dépassent jamais une sorte de règle de conduite et ne sont pas aux prises avec les aspirations vers l’inconnu. La philosophie appartient à ces races privilégiées qui examinent, analysent et veulent comprendre pour croire ; à celles-là aussi appartient l’art, tel que les Grecs l’ont développé, tel que nous l’entendons en Occident. Mais, phénomène singulier ! chacune des trois grandes races humaines qui se partagent le globe terrestre n’est pas apte, isolément, à produire ce qu’on appelle des arts. Celle-ci, la race aryane, la race blanche par excellence, est pourvue d’instincts guerriers ; elle enfante les héros ; elle domine, elle gouverne ; elle établit les premières religions, elle règle leur culte ; elle méprise le travail manuel et forme des sociétés de pasteurs et de guerriers, avec le patriarcat comme principe de tout gouvernement. Cette autre, la race jaune, la plus nombreuse peut-être sur notre planète, est industrieuse, se livre au commerce, au calcul, à l’agriculture, aux travaux manuels ; elle est habile à façonner les métaux ; elle se prête facilement à tout labeur, pourvu qu’elle entrevoie au bout un bien-être purement matériel ; dépourvue d’aspirations élevées, de base philosophique, ne se souciant guère de l’inconnu, elle demeure stationnaire du jour où elle a, grâce à son travail et à son industrie, élevé un ordre social passable. La troisième, la race noire, est ardente, violente, ne reconnaissant d’autre puissance que la force matérielle, superstitieuse, guidée par ses besoins physiques ou son imagination mobile et déréglée. Aucune de ces trois races principales, bien distinctes, n’a pu faire éclore un art. Les races blanches pures ne savent se prêter à ce qu’ils exigent de soins matériels, d’études et de travaux ; les races jaunes ne peuvent les élever qu’à la hauteur d’un métier. Quant au noir, dépourvu de ce régulateur qui n’abandonne jamais l’esprit du blanc, incapable de fixité dans ses idées, il laisse son imagination s’égarer jusqu’à concevoir et enfanter des monstres en toute chose. Il est adroit, subtil, ingénieux, mais trop fantasque pour être artiste, comme nous l’entendons depuis l’antiquité ; car il n’est pas d’art sans lois, sans principes. Le noir n’admet l’intervention de la loi que dans l’ordre physique ; pour lui, la loi, c’est la force matérielle, mais son intelligence n’en admet pas dans le domaine des choses de l’esprit. Or, si le blanc et le noir (ce dernier en proportion minime) se trouvent réunis, l’art se développe rapidement et dans le sens du progrès incessant. Dans le mélange de l’élément blanc et jaune, l’art éclôt aussi, mais penche vers l’hiératisme.
Nous ne prétendons montrer ici que certaines grandes divisions faciles à apprécier ; car, dans l’organisme de ce monde, les choses ne sont pas aussi simples et tranchées : ainsi, par exemple, la philologie a démontré de la manière la plus évidente que les races dites sémitiques ne sont pas des Aryans, qu’elles appartiennent à un autre groupe ; elles se rapprochent encore moins des jaunes ou des races mélaniennes, mais cependant elles tiennent par un point à ces dernières par la vivacité et la mobilité de leur imagination. Pas plus que le blanc ou le noir, le Sémite seul n’est artiste, ou, s’il le devient par le contact d’un apport relativement faible du blanc, c’est dans le sens hiératique absolu.
Au contraire, si un noyau aryan considérable se trouve en contact avec un peuple sémitique, le ferment intellectuel qui en résulte produit un développement d’art splendide, et dans le sens de la recherche, du progrès. La civilisation grecque en est la démonstration la plus évidente.
On ne manquera pas ici de nous accuser de matérialisme. Mais qu’y pourrions-nous faire ? Il y a si longtemps que l’on nous repaît de phrases vides lorsqu’il est question de discuter sur les arts ou de définir leurs qualités, que l’envie nous a pris de traiter cette faculté de l’âme humaine à l’aide de l’analyse et du raisonnement.
On l’a bien fait pour la philosophie, nous ne voyons pas pourquoi on ne le ferait pas à propos des arts. Quand vous m’aurez dit que des statuaires sont dociles au souffle de l’inspiration, ne pouvant croire sérieusement que Minerve les protège, si vous ne nous dites pas de quoi l’inspiration procède, nous ne serons guère avancés. En ajoutant que telle statue est remplie d’un sentiment religieux, si vous ne nous expliquez pas comment un sentiment religieux se traduit sur la pierre ou le marbre, votre observation ne nous importe guère, d’autant que beaucoup de gens très-religieux font des statues qui prêtent à rire, et que des artistes passablement sceptiques en sculptent qui vous font tomber à genoux. Pérugin, ce peintre par excellence de sujets religieux, et qui parfois est si touchant, « avait peu de religion et ne voulait pas croire à l’immortalité de l’âme ». C’est du moins ce qu’en dit Vasari. On voudra donc ne pas chercher dans cet article sur la sculpture l’attirail de phrases stéréotypées à l’usage de la plupart des critiques en matière d’art, dont nous nous garderons de médire, mais qui, en ne nous faisant part que de leurs impressions, peuvent nous intéresser, mais ne sauraient nous faire avancer d’un pas dans la connaissance des phénomènes psychologiques plus ou moins favorables au développement de l’art.
Il s’agit de chercher comment l’art le plus élevé peut-être, celui de la statuaire, naît ou renaît au sein d’un milieu social, où il va puiser ses éléments, s’il n’est qu’un ressouvenir, comme dit Socrate, ou s’il est un développement spontané ; comment il se développe et progresse, et comment il décline.
Nous avons parlé de l’hiératisme et du progrès, de la recherche de l’idéal. Plus nous remontons le courant des arts de l’antique Égypte, plus nous trouvons les arts, et la statuaire notamment, voisins de la perfection. Les dernières découvertes faites par l’infatigable M. Mariette ont mis en lumière des statues de l’époque des pasteurs qui, non-seulement dépassent comme exécution les figures anciennes de Thèbes, mais possèdent un caractère individuel très-prononcé. L’art, dès ces temps reculés, était arrivé à une grande élévation. Ce ne pouvait être par l’hiératisme, mais au contraire par un effort humain, une suite d’études et de progrès. L’hiératisme ne s’était donc établi qu’au moment où l’art avait atteint déjà une grande perfection. Nous voyons le même phénomène se produire chez les populations de l’Asie. L’art s’élève (nous ne savons par quelle suite d’efforts) jusqu’à un point supérieur, et, arrivé là, on prétend désormais le fixer. Ce sont ces arts fixés que rencontrent les Grecs lorsqu’ils occupent l’Hellade ; ils les prennent à cette époque de fixité, mais les font, pour ainsi dire, sortir de leur chrysalide pour les pousser avec une ardeur et une rapidité inouïes vers un idéal qui prend pour point d’appui l’étude attentive et passionnée de la nature. Supposons un instant que ces quelques tribus d’Aryans ne fussent point venues s’établir sur le sol de la Macédoine, de l’Attique et du Péloponnèse ; les arts des peuplades de l’Asie Mineure et de l’Égypte, enfermés dans leur hiératisme, s’affaissant chaque jour sous le poids de cet hiératisme même, s’abîmaient dans une négation. Le sphinx et le chérubin restaient pour les générations futures le véritable symbole de ces arts, c’est-à-dire une énigme. Les Grecs, en secouant cette immobilité, nous en font deviner les secrets, nous permettent de supposer les efforts qui l’avaient précédée. En effet, les premières infusions aryanes en Asie, en Égypte, au contact des races aborigènes, s’étaient trouvées dans ces conditions favorables au développement des arts, et ceux-ci avaient atteint rapidement une supériorité extraordinaire ; mais l’élément sémitique dominant de plus en plus, ces arts s’étaient arrêtés dans leur marche, comme se fixent certains liquides par l’apport d’un agent chimique à une certaine dose.
Ceci peut passer pour une hypothèse ; mais ce qui n’en est pas une, c’est le mouvement que les Grecs savent imprimer aux arts chez eux. Ils prennent les formes hiératiques de l’Asie Mineure ; peu à peu nous voyons qu’ils les naturalisent : ils procèdent pour les arts comme pour la mythologie. Des grands mythes asiatiques, ils font des héros, des personnalités ; l’homme, l’individu se substitue à la caste ; l’esprit moderne, en un mot, se fait jour. La divinité ou ses émanations se personnifient, non plus par une sorte de superposition d’attributs, comme chez les Asiatiques, mais par des qualités ou des passions humaines. En même temps, la philosophie se dégage du cerveau humain, jusqu’alors enserré dans le dogmatisme. Car, observons bien ceci, l’art, mais l’art affranchi de l’hiératisme, l’art à la recherche de l’idéal, du principe vrai, marche toujours côte à côte de la philosophie. Lorsque celle-ci s’élance hardiment à la recherche des problèmes humains, l’art se développe avec énergie et ses produits sont merveilleux ; lorsque la philosophie, haletante, ballottée au milieu de systèmes opposés, se jette, comme pour se fixer sur quelques points, dans la scolastique, l’art, à son tour, se formule, et arrive par une autre pente à cet hiératisme dont il avait si bien su s’affranchir. L’art grec, libre, progressif, le regard fixé sur un idéal sublime qu’il recherche sans repos, sous Périclès vit à côté de Platon.
L’art grec, parallèle à l’école d’Alexandrie, retombe dans une sorte de formulaire hébétant, sans issues. Avec le christianisme, nous le voyons abandonner entièrement la statuaire, comme s’il s’avouait qu’il en avait abusé et que ses recherches ne l’avaient conduit qu’au réalisme le plus vulgaire.
On peut donc constater l’influence de ces lois générales. Avec la théocratie, l’hiératisme dans l’art, et dans l’art de la statuaire surtout. Avec les développements des idées métaphysiques, l’étude de la philosophie, la recherche d’un idéal dans l’art en prenant pour base l’examen attentif de la nature, le progrès par conséquent, mais aussi les erreurs et les chutes.
Devra-t-on conclure des observations précédentes relatives au contact des races diverses que, pour obtenir un Phidias, il convient de mettre en rapports intellectuels quelques Aryans et un Sémite, sous une certaine latitude ? que les arts se forment comme les compositions chimiques, d’après une formule et un peu de chaleur ou un courant électrique ? Non ; mais dans l’étude historique des arts, comme dans celle de la philosophie, des mouvements de l’esprit humain, — et les arts ne sont autre chose qu’une éclosion intellectuelle, — il est nécessaire de bien connaître et de constater les conditions favorables ou défavorables à cette éclosion, par conséquent de signaler les courants, leurs mélanges et les produits successifs de ces mélanges.
On s’est un peu trop habitué, peut-être, à traiter les questions d’art d’après ce qu’on appelle le sentiment ; influence mobile comme la mode, fugitive, et qui a le grand inconvénient d’éloigner l’artiste de la recherche des causes, des origines, de l’idée philosophique sans laquelle l’art n’est qu’un métier ou l’emploi d’une recette.
Le sentiment, admettant qu’il faille compter avec lui, a besoin d’un point d’appui ; où le trouvera-t-il, si ce n’est dans l’analyse, le raisonnement, l’observation et le savoir ? Jugeons les choses d’art avec notre sentiment, si l’on veut, mais élevons notre sentiment, ou plutôt notre faculté de sentir, à la hauteur d’une science, si nous prétendons faire accepter nos jugements par le public impartial. D’ailleurs, n’en est-il pas un peu du sentiment comme de la foi, qui accepte, mais ne crée pas. À la raison humaine seule est réservée la faculté de créer ; c’est la raison qui conduit à l’art par la recherche et le triage d’où ressort la définition et la conscience du beau et du bon ; c’est la raison qui conduit à la philosophie par les mêmes procédés. On n’a jamais fait de philosophie passable avec ce que nous appelons le sentiment. Les Grecs, qui s’y connaissaient un peu, n’ont jamais cru que le sentiment seul pût guider, soit dans la pratique des arts, soit dans les jugements que l’on peut porter sur leurs productions. « Toutes choses étaient ensemble ; l’intelligence les divisa et les arrangea », dit Anaxagore[1]. Si la foi et le sentiment font des miracles, ce n’est pas de cette façon. La foi fait mouvoir les montagnes peut-être, mais elle ne sait ni ne s’enquiert de quoi les montagnes sont faites, ni pourquoi elles sont montagnes. Si elle le savait, elle se garderait de les déranger de leur place.
Qu’est-ce, dans les arts, que le sentiment des choses, sans la connaissance des choses ?
Ce serait trop sortir de notre sujet que de nous étendre plus longtemps sur ces influences qui ont dirigé les arts de l’antiquité, soit dans la voie hiératique, soit dans la recherche du mieux. Il nous suffit d’indiquer quelques-uns de ces courants, avant de présenter le tableau de l’art de la statuaire pendant le moyen âge, tableau à peine entrevu, bien qu’il se développe chaque jour devant nos yeux.
Ce qu’était devenue la sculpture sous l’empire, dans les Gaules, chacun le sait. Des types antiques perfectionnés par les Grecs, répandus sur tout le continent occidental de l’Europe par les Romains, reproduits par une population d’artistes qui ne s’élevaient pas au-dessus de l’ouvrier vulgaire, il nous reste des fragments nombreux. Laissant de côté l’intérêt archéologique qui s’attache à ces débris, considérés comme œuvres d’art, ils ne causent qu’un ennui et un dégoût profonds. Nulle apparence d’individualité, d’originalité ; les auteurs de ces œuvres monotones travaillent à la tâche pour gagner leur salaire. Reproduisant des modèles déjà copiés, ne recourant jamais à la source vivifiante de la nature, traînant partout, de Marseille à Coutances, de Lyon à Bordeaux, leurs poncifs, ils couvrent la Gaule romanisée de monuments tous revêtus de la même ornementation banale, des mêmes bas-reliefs mous et grossiers d’exécution, comme ces joueurs d’orgues de nos jours qui vont porter les airs d’opéras jusque dans nos plus petits villages.
La sculpture dans les Gaules, au moment des grandes invasions, c’est-à-dire au IVe siècle, n’était plus un art, c’était un métier, s’abâtardissant chaque jour. Au point de vue de l’exécution seule, rien n’est plus plat, plus vulgaire, plus négligé. Mais comme composition, comme invention, on trouve encore dans ces fragments une sorte de liberté, d’originalité qui n’existe plus dans les tristes monuments élevés en Italie depuis Constantin jusqu’à la chute de l’empire d’Occident. L’esprit gaulois laisse percer quelque chose qui lui est particulier dans cette sculpture chargée, banale, sans caractère, et s’affranchit parfois du classicisme romain en pleine décadence. Ainsi, par exemple, il ne s’astreint pas à des reproductions identiques d’un même modèle pour les chapiteaux d’un ordre dépendant d’un édifice. Les fûts des colonnes se couvrent d’ornements variés. Les types admis pour les ordres se modifient ; il y a comme une tentative d’affranchissement. Ce n’est pas ici l’occasion de nous étendre sur la valeur de ces symptômes qui, au total, n’est pas considérable mais cependant nous devons les signaler, parce qu’ils font connaître que la Gaule ne restait pas absolument sous l’influence étroite de la tradition des arts romains. Des fragments existant à Autun, au Mont-Dore, à Auxerre, à Lyon, à Reims, à Dijon, dans le Soissonnais, et qui datent des IIIe, IVe, et Ve siècles, indiquent ces tendances originales. Voici un de ces fragments, entre autres, un chapiteau (fig. 1) provenant du portique de clôture du temple de Champlieu, près de Compiègne, qui présente une disposition particulière et qu’on ne retrouverait pas dans les édifices italiens de la même époque (IIIe siècle).
Cette tendance, — en admettant qu’elle fût générale sur le sol des Gaules, — se perdit dans le flot des invasions. L’art de la sculpture s’éteint sous les conquérants du Nord, et si, dans les rares édifices qui nous restent de l’époque mérovingienne, on rencontre çà et là quelques fragments de sculpture, ils sont arrachés à des monuments gallo-romains. Sous les Carlovingiens, des tentatives sont faites pour renouer la chaîne brisée des arts, mais ces tentatives n’aboutissent guère qu’à de pâles copies des types de l’antiquité romaine, sous une influence byzantine plus ou moins prononcée. Charlemagne ne pouvait songer à autre chose, en fait d’art, qu’à remuer les cendres de l’empire romain pour y retrouver quelques étincelles ; il essayait une renaissance des formes et des moyens pratiques oubliés. De semblables tentatives n’aboutissent qu’à des pastiches grossiers. On ne refait pas des arts avec des lois, des institutions ou des règlements ; il faut d’autres éléments pour les rendre viables et les faire pénétrer dans une nation. Or, sous les Carlovingiens, l’heure d’une véritable renaissance des arts n’était pas sonnée. Les ferments apportés par les peuplades conquérantes étaient depuis trop peu de temps mêlés à la vieille civilisation gallo-romaine pour qu’un art, comme la sculpture, pût éclore.
Ce n’est en effet qu’à la fin du XIe siècle que l’on voit apparaître les premiers embryons de cet art de la sculpture française, qui, cent ans plus tard, devait s’élever à une si grande hauteur. Alors, à la fin du XIe siècle, les seules provinces de la Gaule qui eussent conservé des traditions d’art de l’antiquité étaient celles dont l’organisation municipale romaine s’était maintenue. Quelques villes du Midi, à cette époque, se gouvernaient encore intra muros, comme sous l’empire ; par suite, elles possédaient leurs corps d’artisans et les traditions des arts antiques, très-affaiblies, il est vrai, mais encore vivantes. Toulouse, entre toutes ces anciennes villes gallo-romaines, était peut-être celle qui avait le mieux conservé son organisation municipale. Les arts, chez elle, n’avaient pas subi une lacune complète, ils s’étaient perpétués. Aussi cette cité devint-elle, dès le commencement du XIIe siècle, le centre d’une école puissante et dont l’influence s’étendit sur un vaste territoire.
Dans une autre région de la France, l’ordre de Cluny, institué au commencement du Xe siècle, avait pris, au milieu du XIe, un développement prodigieux[2].
À cette époque, les clunisiens étaient en rapport avec l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre, la Hongrie ; non-seulement ils possédaient des maisons dans ces contrées, mais encore ils entretenaient des relations avec l’Orient. C’est au sein de ces établissements clunisiens que nous pouvons constater un véritable mouvement d’art vers la seconde moitié du XIe siècle. Jusqu’alors, sur le sol des Gaules, et depuis la chute de l’empire, la sculpture n’est plus ; mais tout à coup elle se montre comme un art déjà complet, possédant ses principes, ses moyens d’exécution, son style. Un art ne pousse pas cependant comme des champignons ; il est toujours le résultat d’un travail plus ou moins long, et possède une généalogie. C’est cette généalogie qu’il convient d’abord de rechercher.
En 1098, une armée de chrétiens commandée par Godefroi, le comte, Baudouin, Bohémond, Tancrède, Raymond de Saint-Gilles et beaucoup d’autres chefs, s’empara d’Antioche, et depuis cette époque jusqu’en 1268, cette ville resta au pouvoir des Occidentaux. Antioche fut comme le cœur des croisades ; prélude de cette période de conquêtes et de revers, elle en fut aussi le dernier boulevard. C’était dans ces villes de Syrie, bien plus que dans la cité impériale de Constantinople, que les arts grecs s’étaient réfugiés. Au moment de l’arrivée des croisés, Antioche était encore une ville opulente, industrieuse, et possédant des restes nombreux de l’époque de sa splendeur. Toute entourée de ces villes grecques abandonnées depuis les invasions de l’islam, mais restées debout, villes dans lesquelles on trouve encore aujourd’hui tous les éléments de notre architecture romane. Antioche devint une base d’opérations pour les Occidentaux, mais aussi un centre commercial, le point principal de réunion des religieux envoyés par les établissements monastiques de la France, lorsque les chrétiens se furent emparés de la Syrie. D’ailleurs, avec les premiers croisés, étaient partis de l’Occident, à la voix de Pierre l’Ermite, non-seulement des hommes de guerre, mais des gens de toutes sortes, ouvriers, marchands, aventuriers, qui bientôt, avec cette facilité qu’ont les Français principalement d’imiter les choses nouvelles qui attirent leur attention, se façonnèrent aux arts et métiers pratiqués dans ces riches cités de l’Orient. C’est en effet à dater des premières années du XIIe siècle que nous voyons l’art de la sculpture se transformer sur le sol de la France, mais avec des variétés qu’il faut signaler. Les monuments grecs des VIe et VIIe siècles qui remplissent les villes de Syrie, et notamment l’ancienne Cilicie, possèdent une ornementation sculptée d’un beau style, et qui rappelle celui des meilleurs temps de la Grèce antique[3], mais sont absolument dépourvus de statuaire. Cependant il y avait eu à Constantinople, avant et après les fureurs des iconoclastes, des écoles de sculpteurs statuaires, qui fabriquaient quantité de meubles en bois, en ivoire, en orfèvrerie, que les Vénitiens et les Génois répandaient en Occident. Nous possédons, dans nos musées et nos bibliothèques, bon nombre de ces objets antérieurs au XIIe siècle. Il ne paraît pas toutefois que les artistes byzantins se livrassent à la grande statuaire, et les exemples dont nous parlons ici sont, à tout prendre, de petite dimension et d’une exécution souvent barbare. Il n’en était pas de même pour la peinture : les Byzantins avaient produit dans cet art des œuvres tout à fait remarquables, et dont nous pouvons nous faire une idée par les peintures des églises de la Grèce[4] et par les vignettes des manuscrits de la Bibliothèque impériale.
Or, parmi ces croisés partis des différents points de l’extrême Occident, les uns rapportent, dès le commencement du XIIe siècle, de nombreux motifs de sculpture d’ornement d’un beau caractère, d’autres de l’ornementation et de la statuaire.
Nous voyons, par exemple, à cette époque, le Poitou, la Saintonge, la Normandie, l’Île-de-France, la Picardie, l’Auvergne, répandre sur leurs édifices, des rinceaux, des chapiteaux, des frises d’ornements d’un très-beau style, d’une bonne exécution, qui semblent copiés, ou du moins immédiatement inspirés par l’ornementation byzantine de la Syrie, tandis qu’à côté de ces ornements, la statuaire demeure à l’état barbare et ne semble pas faire un progrès sensible. Mais si nous nous transportons en Bourgogne, sur les bords de la Saône, dans le voisinage des principaux monastères clunisiens, c’est tout autre chose. La statuaire a fait, au commencement du XIIe siècle, un progrès aussi rapide que l’ornementation sculptée, et rappelle moins encore par son style les diptyques byzantins, que les peintures qui ornent les monuments et les manuscrits grecs. Ceci s’explique. Si des moines grossiers, si des ouvriers ignorants pouvaient reproduire les ornements grecs qui abondent sur les édifices de la Syrie septentrionale, ils ne pouvaient copier des statues ou bas-reliefs à sujets, qui n’existaient pas. Ils s’orientalisaient quant à la décoration sculptée, et restaient gaulois quant à la statuaire. Pour transposer dans les arts, il faut un certain degré d’instruction, de savoir, que les clunisiens seuls alors possédaient. Les clunisiens firent donc chez eux une renaissance de la statuaire, à l’aide de la peinture grecque. Cela est sensible pour quiconque est familier avec cet art. Si nous nous transportons, par exemple, devant le tympan de la grande porte de l’église abbatiale de Vézelay, ou même devant celui de la grande porte de la cathédrale d’Autun, qui lui est quelque peu postérieur, nous reconnaîtrons dans ces deux pages et particulièrement dans la première, une influence byzantine prononcée, incontestable, et cependant cette statuaire ne rappelle pas les diptyques byzantins, ni par la composition, ni par le faire, mais bien les peintures.
Autant la statuaire byzantine du vieux temps prend un caractère hiératique, autant elle est bornée dans les moyens, conventionnelle, autant la peinture se fait remarquer par une tendance dramatique, par la composition, par l’exactitude et la vivacité du geste[5]. Ces mêmes qualités se retrouvent à un haut degré dans les bas-reliefs que nous venons de signaler. De plus, dans ces bas-reliefs, les draperies sont traitées comme dans les peintures grecques, et non comme elles le sont sur les monuments byzantins sculptés. La composition des bas-reliefs de Vézelay, par la manière dont les personnages sont groupés, rappelle également les compositions des peintures grecques ; on y remarque plusieurs plans, des agencements de lignes, un mouvement dramatique très-prononcé. Mais par cela même que les clunisiens transposaient d’un art dans l’autre, tout en laissant voir la source d’où sortait la statuaire, ils étaient obligés de recourir, pour une foule de détails, à l’imitation des objets qui les entouraient. Aussi l’architecture, les meubles, les instruments, sont français, les habits mêmes, sauf ceux de certains personnages sacrés, qui sont évidemment copiés sur les peintures grecques, sont les habits portés en Occident, mais ils sont byzantinisés (qu’on nous pardonne le barbarisme) par la manière dont ils sont rendus dans les détails. Quant aux têtes, et cela est digne de fixer l’attention des archéologues et des artistes, elles ne rappellent nullement les types admis par les peintres grecs. Les sculpteurs occidentaux ont copié, aussi bien qu’ils ont pu le faire, les types qu’ils voyaient, et cela souvent avec une délicatesse d’observation et une ampleur très-remarquables.
Nous avons souvent entendu discuter ce point, de savoir si ces bas-reliefs de Vézelay, d’Autun, de Moissac, de Charlien, etc., étaient sculptés par des artistes envoyés d’Orient, ou s’ils étaient dus à des sculpteurs occidentaux travaillant sous une influence byzantine. Longtemps nous avons hésité devant ce problème; mais, après avoir examiné beaucoup de ces sculptures françaises, des sculptures et des peintures grecques, surtout des vignettes de manuscrits; après avoir réuni des dessins et des photographies en grand nombre pour établir des comparaisons immédiates, notre hésitation a dû cesser. D’ailleurs, si des artistes grecs avaient été appelés en France pour exécuter ces sculptures, ils auraient trahi leur origine sur quelques points, une inscription, un meuble, un ustensile. Rien de pareil ne se rencontre sur aucun de ces bas-reliefs. Tout est occidental, et encore une fois la sculpture des Byzantins à cette époque n’est pas traitée comme celle de ces bas-reliefs français.
Dans cette statuaire française que nous regardons comme dérivée de la peinture byzantine très-ancienne, — car certainement les vignettes de manuscrits servaient de types aux clunisiens, et ces manuscrits pouvaient être très-antérieurs au XIIe siècle, — une des qualités qui frappent le plus les personnes qui savent voir, c’est l’exactitude et la vérité saisissantes du geste. Or, quand on se rappelle à quel degré de barbarie était tombée la statuaire au Xe siècle, et combien cette qualité était oubliée alors, les artistes sortis des écoles de Cluny avaient dû recourir à des modèles d’une grande valeur, comme art, pour se former.
Mais il en est de ce fait historique comme de bien d’autres, il faut se garder d’établir un système sur un seul groupe d’observations. Ce qui est vrai ici peut être erroné là. Si les clunisiens sont parvenus, au commencement du XIIe siècle, à former une école de sculpteurs avec les éléments que nous venons d’indiquer, il est évident que sur les bords du Rhin, qu’en Provence et à Toulouse, l’influence byzantine s’était fait sentir dès avant les premières croisades, et avait permis de constituer des écoles de sculpture relativement florissantes. Sur les bords du Rhin, les efforts que Charlemagne avait fait pour faire renaître les arts avaient porté quelques fruits. Ce prince s’était entouré d’artistes byzantins, avait reçu de Byzance et de Syrie des présents considérables en objets d’art. Depuis son règne, les traditions introduites par les artistes orientaux, les objets réunis dans les monastères, dans les palais, avaient permis de former une école pseudo-byzantine, qui ne laissait pas d’avoir une certaine valeur relative. En Provence, dans une partie du Languedoc, et à Toulouse notamment, une autre école s’était constituée dès le XIe siècle, en s’appuyant sur les exemples si nombreux d’objets d’art rapportés d’Orient par le commerce de la Méditerranée.
Au Xe siècle, les Vénitiens avaient des comptoirs dans un certain nombre de villes du Midi et jusqu’à Limoges. Ces négociants fournissaient les provinces du Midi et du Centre d’étoffes de soie orientales, de bijoux, de coffrets et ustensiles d’ivoire et de métal fabriqués à Constantinople, à Damas, à Antioche, à Tyr. Il suffit de voir les sculptures du XIe siècle qui existent encore autour du chœur de Saint-Sernin de Toulouse, et dans le cloître de Moissac, pour reconnaître dans cette statuaire des copies grossières de ivoires byzantins. Voici (fig. 2) un de ces exemples provenant du cloître de Moissac.

Cette image de saint Pierre, de marbre, est très bas-relief. On retrouve là, non-seulement le caractère des sculptures de Byzance, mais le faire, le style hiératique maniéré, et jusqu’aux procédés pour indiquer les draperies. Il est certain que les artistes qui taillaient ces images ne regardaient ni la nature, ni même les nombreux fragments de l’antiquité romaine qui abondaient dans cette contrée, mais qu’ils n’avaient d’yeux que pour ces ouvrages byzantins d’ivoire, de cuivre ou d’argent repoussé qu’on exportait sans cesse de Constantinople. Tout dans cette sculpture est de convention ; on n’y retrouve que les traces effacées d’un art qui ne procède plus que par recettes. Mais de cette sculpture qui sent si fort la décadence, à celle qu’on fit un siècle plus tard à peine, dans les mêmes provinces, il y a toute une révolution ; car cette dernière a repris l’air de jeunesse qui appartient à un art naissant. Ce n’est plus la barbarie sénile, c’est le commencement d’un art qui va se développer. Des causes politiques empêchèrent cette école languedocienne de s’élever, ainsi que nous l’exposerons tout à l’heure ; mais ce que nous venons de dire explique les diverses natures des influences byzantines en France pendant le XIe siècle et les premières années du XIIe. Ces artistes de Provence, du Languedoc, du Rhin, par cela même qu’ils avaient entre les mains un grand nombre d’objets sculptés provenant de Byzance, n’avaient pas eu, comme les clunisiens, à transporter l’art de la peinture dans la statuaire ; aussi leurs produits n’ont pas cette originalité des œuvres de l’école clunisienne, qui, procédant de la peinture à la sculpture, devait mettre beaucoup du sien dans les imitations byzantines.
Voici donc, à la fin du XIe siècle, quel était l’état des écoles de sculpture dans les différentes provinces de la France actuelle. Les traditions romaines s’étaient éteintes à peu près partout, et ne laissaient plus voir que de faibles lueurs dans les villes du Midi. En Provence, les restes des monuments romains étaient assez nombreux pour que l’école de sculpture renaissante à cette époque s’inspirât principalement de la statuaire antique, tandis qu’elle allait chercher les ornements et les formes de l’architecture en Orient[6]. L’école de Toulouse avait abandonné toute tradition romaine, et s’inspirait, quant à la statuaire, des nombreux exemples sculptés rapportés de Byzance : l’ornementation était alors un compromis entre les traditions gallo-romaines et les exemples venus de Byzance. Dans les provinces rhénanes l’élément byzantin, mais altéré, dominait dans la statuaire et l’ornementation. Dans les provinces occidentales, le Périgord, la Saintonge, la statuaire était à peu près nulle, et l’ornementation, gallo-romaine, bien que Saint-Front eût été bâti sur un plan byzantin. À Limoges et les villes voisines, vers l’ouest et le sud, la proximité des comptoirs vénitiens avait donné naissance à une école assez florissante, appuyée sur les types byzantins. En Auvergne, le Nivernais et une partie du Berry, les traditions byzantines inspiraient la statuaire, tandis que l’ornementation conservait un caractère gallo-romain. Mais ces provinces étaient en rapport par Limoges avec les Vénitiens, et recevaient dès lors un grand nombre d’objets venus d’Orient. En Bourgogne, dans le Lyonnais, l’école clunisienne produisait seule des œuvres d’une valeur originale, et comme statuaire, et comme ornementation, par les motifs déduits plus hauts. Dans l’Île-de-France la statuaire n’avait nulle valeur, et l’ornementation, comme celle de la Normandie, s’inspirait des compositions byzantines, à cause de la grande quantité d’étoffes d’Orient qui pénétraient dans ces provinces par le commerce des Vénitiens et des Génois. En Poitou, la statuaire était également tombée dans la plus grossière barbarie, et l’ornementation, lourde, était un mélange de traditions gallo-romaines et d’influences byzantines fournies par les étoffes et les ustensiles d’Orient.
Si l’on consulte la carte que nous avons dressée pour accompagner l’article Clocher (fig. 6), on se rendra compte d’une partie de ces divisions d’écoles, bien que les arts de la sculpture n’aient pas exactement les mêmes foyers que ceux de l’architecture. Ainsi, il y a une école d’architecture normande au commencement du XIe siècle, et il n’y a pas, à proprement parler, d’école de sculpture normande. L’école de sculpture de l’Île-de-France ne commence à rayonner que vers la fin de la première moitié du XIIe siècle. Si l’influence de l’architecture rhénane se fait sentir au commencement du XIIe siècle jusqu’à Châlons-sur-Marne, la sculpture des bords du Rhin ne pénètre pas si loin vers l’ouest. Toulouse, qui n’a pas, à la fin du XIe siècle, une école d’architecture locale, possède déjà une puissante école de sculpture. L’architecture, développée au XIe siècle dans les provinces occidentales, ne possède des écoles de sculpture dignes de ce nom qu’au XIIe siècle. On peut donc compter vers 1100, en France, cinq écoles de statuaire : la plus ancienne, l’école rhénane ; l’école de Toulouse, l’école de Limoges, l’école provençale, et la dernière née, l’école clunisienne. Or, cette dernière allait promptement en former de nouvelles sur la surface du territoire, et renouveler entièrement la plupart de celles qui lui étaient antérieures, en les poussant en dehors de la voie hiératique, à la recherche du vrai, vers l’étude de la nature. Constatons d’abord que partout où résident les clunisiens au commencement du XIIe siècle, la sculpture acquiert une supériorité marquée, soit comme ornementation, soit comme statuaire. Le témoignage d’un contemporain, celui de saint Bernard, qui s’éleva si vivement contre ces écoles de sculptures clunisiennes et qui essaya de combattre leur influence, serait une preuve de l’importance qu’elles avaient acquise au XIIe siècle, si les monuments n’étaient pas là.
L’école clunisienne était la seule en effet qui pouvait se développer, parce qu’en prenant pour point de départ, pour enseignement, dirons-nous, l’art byzantin, elle observait la nature, et tendait à s’éloigner ainsi des types consacrés, à se soustraire peu à peu à l’hiératisme des arts grecs des bas temps, et qu’elle avait su prendre, dans ces arts, comme modèle, celui qui avait conservé les allures les plus libres, la peinture.
La peinture byzantine, en effet, n’excluait pas encore à cette époque l’individualisme, tandis que la sculpture semblait ne reproduire que des types uniformes consacrés. Les vignettes de manuscrits grecs du VIe au Xe siècle présentent, non-seulement des compositions empreintes d’une liberté que ne conservent pas les sculptures des ivoires et objets d’orfèvrerie, mais qui reproduisent évidemment des portraits. Ces vignettes tiennent compte de la perspective, de l’effet produit par des plans différents, par la lumière ; quelques-unes même sont profondément empreintes d’une intention dramatique[7].
Nous allons montrer comment les clunisiens avaient introduit dans la sculpture, imitée comme faire et comme style de l’école byzantine, ces éléments de liberté et l’observation de la nature soit par la reproduction vraie du geste, soit par l’étude des types qu’ils avaient sous les yeux. C’est la porte principale de l’église abbatiale de Vézelay, ouvrage d’une grande valeur pour l’époque, qui va nous fournir les exemples les plus remarquables de cette statuaire pseudo-byzantine des clunisiens, à la fin du XIe siècle ou pendant les premières années du XIIe
L’ensemble de cette œuvre est présentée dans l’article Porte (fig. 11). On remarquera, tout d’abord, qu’il y a dans cette composition un mouvement, une mise en scène, qui n’existent pas dans les compositions byzantines de la même époque ou antérieures. L’idée dramatique subsiste au milieu de ces groupes de personnages auxquels l’artiste a voulu donner la vie et le mouvement. Voyons les détails : voici fig. 3, deux des figures 3/4 nature, sculptées sur le pied-droit de droite ; c’est un saint Pierre qui discute avec un autre apôtre attentif et paraissant se disposer à donner la réplique.


On comprendra qu’il ne nous serait pas possible de fournir la quantité d’exemples que comporterait un pareil sujet qui demanderait, à lui seul, un ouvrage étendu. Nous devons nous borner à signaler quelques points saillants afin d’attirer l’attention des artistes, des archéologues, des anthropologistes, sur ces questions dont la valeur est trop dédaignée.
Nous avons parlé de l’école de Toulouse, toute byzantine au XIe siècle. Comme ses sœurs, au XIIe siècle cette école abandonne en partie l’hiératisme grec des bas temps pour chercher l’étude de la nature.
Le petit hôtel de ville de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne)[8] est un des plus jolis édifices du milieu du XIIe siècle, c’est-à-dire de 1140 environ. Il appartient à l’école de Toulouse. Sa sculpture est traitée avec un soin et une perfection rares.

Entre autres figures, sur l’un des chapiteaux de la galerie du premier étage de ce monument est sculpté un roi dont nous donnons ici le masque (fig. 6). S’il est un caractère de tête bien caractérisé, évidemment pris sur la nature, c’est celui-là. Ce front large, ces yeux bien fendus, grands, ces arcades sourcilières éloignées du globe de l’œil, ce nez fin, cambré, serré à la racine et près des narines, celles-ci étant minces, relevées ; ces lèvres fermes et nettement bordées ; cette barbe en longues mèches, ces oreilles écartées du crâne, ces cheveux longs et soyeux ne présentent-ils pas un de ces types slaves comme on en trouve en Hongrie et sur les bords du bas Danube[9]. À côté de cette tête il en est d’autres qui présentent un caractère absolument différent et qui se rapproche des types les plus fréquemment adoptés dans la statuaire de Toulouse.
Poursuivons cette revue avant de reprendre l’ordre que nous devons suivre dans cet article.
Transportons-nous à Chartres. Le portail occidental de la cathédrale présente une suite de statues d’une exécution très-soignée. Ce sont de grandes figures longues qui semblent emmaillotées dans leurs vêtements comme des momies dans leurs bandelettes et qui sont profondément pénétrées de la tradition byzantine comme faire, bien que les vêtements soient occidentaux. Les têtes de ces personnages ont l’aspect de portraits et de portraits exécutés par des maîtres. Nous prenons l’une d’elles, que connaissent toutes les personnes qui ont visité cette cathédrale[10] (fig. 7).


Si l’on demandait laquelle de ces deux femmes est la maîtresse, laquelle la servante, personne ne s’y tromperait ; il y a dans la tête de la reine A, de Corbeil, une distinction, un sentiment de dignité, une gravité intelligente qui ne se trouvent pas dans la tête B, de Chartres. Mais si nous mettons en parallèle la tête de femme de Chartres avec celle de l’homme (fig. 7), ces deux types appartiennent bien à la même race ; si nous voyons ensemble les têtes du roi et de la reine de Notre-Dame de Corbeil, il est évident que ces personnages appartiennent tous deux aussi à une même race. Ce qu’il y a de railleur et d’amer dans la bouche de l’homme de Chartres se traduit dans le masque de la femme par une expression de bonhomie malicieuse. Les yeux de ces deux masques sont fendus de même, les paupières couvrent en partie le globe ; le nez est large à la base et la mâchoire développée. Les personnages de Corbeil ont tous deux les yeux bien ouverts, les arcades sourcilières semblables, la bouche identique, la mâchoire fine, le nez délicat[11].
Entrons dans une autre province ; en Poitou vers la même époque, c’est-à-dire de 1120 à 1140, la statuaire abonde sur les monuments. Cette statuaire est fortement empreinte du style byzantin, mais cependant l’individualisme, l’étude de la nature se fait sentir.

Voici (fig. 10) la tête d’une femme faisant partie d’un relief représentant la naissance du Sauveur, sur la façade de Notre-Dame-la-Grande, Poitiers. Qui ne reconnaîtrait là un de ces types si fréquents dans le Poitou ? L’angle externe de l’œil est abaissé, le nez est fort, droit, formant avec le front une ligne continue, le front est bien fait mais bas, la partie supérieure du crâne plate, la bouche près du nez et les lèvres charnues, la mâchoire ronde et développée, les joues grandes, les cheveux lisses. Mais nous devons limiter cet examen de l’observation des types humains à quelques exemples et reprendre l’historique des diverses écoles de sculpture du sol français.
Les influences byzantines n’ont pas été les seules qui aient permis à l’art de la sculpture de se relever de l’état de barbarie absolue où il était tombé.
Il est certain que des éléments d’art, très-peu développés il est vrai, avaient été introduits par les envahisseurs des Ve et VIe siècles. Les Burgondes, entre tous ces barbares venus du nord-est, semblent avoir apporté avec eux quelques-uns de ces éléments tout à fait étrangers aux arts de la Rome antique et même de Byzance.
Il existe dans les cryptes de l’ancienne rotonde de Saint-Bénigne, à Dijon, rebâtie en 1001 par l’abbé Guillaume, des fragments de l’édifice du VIe siècle. Ces fragments consistent en débris de moulures et de sculptures, lesquels ont à nos yeux un intérêt particulier. L’un des chapiteaux retrouvés dans les massifs du commencement du XIe siècle et qui par conséquent ne peuvent avoir appartenu qu’à un monument plus ancien, n’a rien qui rappelle le style gallo-romain. Cette étrange sculpture dont nous donnons (fig. 11) un dessin, se rapprocherait plutôt de certains types d’ornementation de l’Inde.

C’est un entrelacement d’êtres monstrueux parmi lesquels on distingue des serpents. Certaines sculptures anciennes de Scandinavie et d’Islande ont avec ce chapiteau des rapports de parenté non contestables. On y retrouve cette abondance de monstres, ce travail par intailles, ces ornements en forme de palmettes, ces entrelacs.
« La conquête des provinces méridionales et orientales de la Gaule par les Visigoths et les Burgondes fut loin d’être aussi violente que celle du Nord par les Francs. Étrangers à la religion que les Scandinaves propageaient autour d’eux, ces peuples avaient émigré par nécessité avec femmes et enfants sur le territoire romain.
« C’était par des négociations réitérées plutôt que par la force des armes qu’ils avaient obtenu leurs nouvelles demeures. À leur entrée en Gaule ils étaient chrétiens comme les Gaulois, quoique de la secte arienne, et se montraient en général tolérants, surtout les Burgondes. Il paraît que cette bonhomie, qui est un des caractères actuels de la race germanique, se montra de bonne heure chez ce peuple. Avant leur établissement à l’ouest du Jura presque tous les Bourgondes étaient gens de métiers, ouvriers en charpente ou en menuiserie. Ils gagnaient leur vie à ce travail dans les intervalles de la paix et étaient ainsi étrangers à ce double orgueil du guerrier et du propriétaire civil, qui nourrissait l’insolence des autres conquérants barbares »[12].
C’est en effet dans les provinces de la Gaule romaine où s’établirent les Burgondes et les Visigoths que nous pouvons signaler un sentiment d’art étranger aux traditions gallo-romaines. C’est dans ces provinces de l’est conquises par les Burgondes et dans l’Aquitaine, occupée par les Visigoths, que les écoles de sculpture se développent plus particulièrement avant le XIIe siècle, tandis que les provinces occupées par les Francs demeurent attachées aux traditions gallo-romaines jusqu’au moment des premières croisades. Les Normands ne laissèrent pas d’apporter avec eux quelques ferments d’art, mais cela se bornait à ces ornements qu’on retrouve chez les peuples scandinaves et ne concernait point la statuaire qui semble leur avoir été tout à fait étrangère. Si les monuments normands les plus anciens, c’est-à-dire du XIe siècle, conservent quelques traces de sculptures, celles-ci se bornent à des entrelacs grossiers, à des imbrications et des intailles ; mais la figure n’y apparaît qu’à l’état monstrueux ; encore est-elle rare.
Les invasions scandinaves qui eurent lieu dès le VIe siècle sur les côtes de l’ouest avaient-elles aussi déposé quelques germes de cette ornementation d’entrelacs et de monstres tordus que l’on rencontre encore au XIe siècle sur les monuments du bas Poitou et de la Saintonge ? C’est ce que nous ne saurions décider. Quoi qu’il en soit, cette ornementation ne conserve plus le caractère gallo-romain abâtardi que l’on trouve encore entier dans le Périgord, le Limousin et une bonne partie de l’Auvergne pendant le XIe siècle et qui ne cessa de se reproduire en Provence jusques au XIIIe.
Nous avons montré par un exemple (fig. 2) ce qu’était devenue la statuaire au XIe siècle dans les villes d’Aquitaine ayant conservé des écoles d’art. Elle n’était plus qu’un pastiche grossier des ivoires byzantins répandus par les négociants en Occident. Cependant cette province, comme celles du Nord et de l’Est, fait au commencement du XIIe siècle un effort pour abandonner les types hiératiques ; elle aussi cherche le dramatique, l’expression vraie du geste, et elle ne dédaigne plus l’étude de la nature. Le musée de Toulouse et l’église de Saint-Sernin nous offrent de très-beaux spécimens de ce passage de l’imitation plate des types rapportés de Byzance à un art très-développé bien qu’empreint encore des données grecques byzantines.


Voici (fig. 13) un fragment d’un de ces chapiteaux représentant Salomé, la fille d’Hérodiade, au moment où elle obtient d’Hérode, pendant un festin et en dansant devant lui, la tête de saint Jean-Baptiste. Les gestes de ces deux personnages sont exprimés avec délicatesse, indiquent le sujet non sans une certaine grâce maniérée. Les draperies, les détails des vêtements, d’une extrême richesse, sont rendus avec une précision, une vivacité et un style que l’on ne rencontre plus à cette époque dans la sculpture engourdie des Byzantins.
Ces belles écoles toulousaines du XIIe siècle dont il nous reste de si remarquables fragments, s’éteignent pendant les cruelles guerres contre les Albigeois. Cependant si l’on considère leurs œuvres à Toulouse, à Moissac, à Saint-Antonin, à Saint-Hylaire[13], à Saint-Bertrand de Comminge[14], on peut admettre qu’elles eussent pu rivaliser avec les meilleures écoles du Nord pendant le XIIe siècle. Faire sortir un art libre, poursuivant le progrès par l’étude de la nature, en prenant un art hiératique comme point de départ, c’est ce que firent avec un incomparable succès les Athéniens de l’antiquité. Des sculptures dites éginétiques, c’est-à-dire empreintes encore profondément d’un caractère hiératique, aux sculptures de Phidias, il y a vingt-cinq ou trente ans. Or nous voyons en France le même phénomène se produire. Des statues de Chartres, de Corbeil, de Châlons-sur-Marne, de Notre-Dame de Paris[15], de Saint-Loup (Seine-et-Marne), à la statuaire du portail occidental de la cathédrale de Paris il y a un intervalle de cinquante ans environ et le pas franchi est immense. Dans cette statuaire des premières années du XIIIe siècle il n’y a plus rien qui rappelle les données byzantines pas plus qu’on ne retrouve de traces de la statuaire éginétique, toute empreinte de l’hiératisme de l’Asie, dans les sculptures du temple de Thésée ou du Parthénon.
Cela, si nous envisageons l’art à un point de vue philosophique, mérite une sérieuse attention et tendrait à détruire une opinion généralement répandue, savoir : que l’art ne saurait se développer dans le sens du progrès s’il prend pour point de départ un art à son déclin enfermé dans des formules hiératiques. Les Hellènes cependant se saisirent des arts déjà engourdis de l’Asie et de l’Égypte comme on se saisit d’un langage. En peu de temps avec ces éléments, desquels jusqu’à eux on ne savait tirer qu’un certain nombre d’idées formulées de la même manière, ils surent tout exprimer.
Comment ce phénomène put-il se produire ? C’est qu’ils n’avaient considéré l’art hiératique que comme un moyen quasi-élémentaire d’enseignement, un moyen d’obtenir d’abord une certaine perfection d’exécution, un degré déjà franchi au-dessous duquel il était inutile de redescendre. Quand leurs artistes eurent appris le métier à l’aide de ces arts, très-développés au point de vue de l’exécution matérielle, quand ils furent assurés de l’habilité de leur main, quand (pour nous servir encore de la comparaison de tout à l’heure) ils eurent une parfaite connaissance de la grammaire, alors seulement ils cherchèrent à manifester leurs propres idées à l’aide de ce langage qu’ils savaient bien. Une fois certains de ne pas tomber dans une exécution matérielle inférieure à celle des arts asiatiques, ils n’essayèrent plus d’en reproduire les types, mais se tournant du côté de la nature, étudiant ses ressorts physiologiques et psychologiques avec une finesse incomparable, ils s’élancèrent à la recherche de l’idéal ou plutôt de la nature idéalisée. Comment cela ? D’abord, de la reproduction plus ou moins fidèle des types hiératiques qui leur servent de modèles, ils en viennent à chercher l’imitation des types vivants qui les entourent. Cet effort est visible dans les sculptures doriennes de la Sicile, de la grande Grèce et dans celles de l’Hellade les plus anciennes. Comme chez les Égyptiens et les Assyriens, le portrait sinon de l’individu, de la race au moins, apparaît dans la statuaire dorienne immédiatement après des essais informes.
Mais au lieu de faire comme l’artiste assyrien et égyptien qui, perpétuant ces reproductions de types, arrivait à les exprimer d’une manière absolument conventionnelle ; qui possédait des formules, des poncifs pour faire un Lybien, un Nubien, un Ionien, un Mède ou un Carien, le Grec réunit peu à peu ces types divers d’individus et même de races ; il leur fait subir une sorte de gestation dans son cerveau, pour produire un être idéal, l’humain par excellence. Ce n’est pas le Mède ou le Macédonien, le Sémite pur ou l’Égyptien, le Syrien ou le Scythe, c’est l’homme. Cherchant une abstraction parfaite il ne saurait s’arrêter ; il retouche sans cesse ce modèle abstrait qui est une création éternellement remise dans le moule, et par cela même qu’il cherche toujours, qu’il va devant lui, étant monté aussi haut que l’artiste peut atteindre, il doit redescendre. C’est ainsi que le Grec tourne le dos à l’hiératisme oriental.
Ce phénomène dans l’histoire de l’art se reproduit identiquement à la fin du XIIe siècle sur une grande partie du territoire français. Si les éléments sont moins purs, les résultats moins considérables, la marche est la même.
Les statuaires du XIIe siècle en France commencent par aller à l’école des Byzantins ; il faut avant tout apprendre le métier, c’est à l’aide des modèles byzantins que se fait ce premier enseignement. Cependant l’artiste occidental ne pouvant s’astreindre à la reproduction hiératique dès qu’il sait son métier, regarde autour de lui. Les physionomies le frappent ; il commence par copier des types de têtes, tout en conservant le faire byzantin dans les draperies, dans les nus, dans les accessoires. Bientôt de tous ces types divers, il prétend faire sortir un idéal, le beau, il y parvient. Que ce beau, que cet idéal ne soit pas le beau et l’idéal trouvé par le Grec, cela doit être, puisque jamais dans ce monde des causes semblables ne produisent deux fois des effets identiques ; que cet idéal soit inférieur à celui rêvé et trouvé par le Grec, en considérant le beau absolu, nous le reconnaissons ; mais ce mouvement d’art n’en est pas moins un des faits les plus remarquables des temps modernes.
Les conditions faites à l’art du statuaire par le christianisme étaient-elles d’ailleurs aussi favorables au développement de cet art que l’avait été l’état social de la Grèce ? Non. Chez les Grecs, la religion, les habitudes, les mœurs, tout semblait concourir au développement de l’art du statuaire. Si les Athéniens ne se promenaient pas tout nus dans les rues, le gymnase, les jeux, mettaient sans cesse en relief, aux yeux du peuple, les avantages corporels de l’homme et les habitants des villes grecques pouvaient distinguer la beauté physique du corps humain, comme de nos jours le peuple de nos villes distingue à première vue un homme bien mis et portant son vêtement avec aisance, d’un malotru. L’art ne pouvant plus se développer en observant et reproduisant avec distinction le côté plastique du corps humain devait se faire jour d’une autre manière. Il s’attacha donc à étudier les reflets de l’âme sur les traits du visage, dans les gestes, dans la façon de porter les vêtements, de les draper. Et ainsi limité, il atteignit encore une grande élévation.
Si donc nous voulons considérer l’art de la statuaire dans les temps antiques et dans le moyen âge du côté historique et en oubliant les redites de l’école moderne, nous serons amenés à cette conclusion, savoir : que les habitudes introduites par le christianisme étant admises, les statuaires du moyen âge en ont tiré le meilleur parti et ont su développer leur art dans le sens possible et vrai. Au lieu de chercher, comme nous le voyons faire aujourd’hui, à reproduire des modèles de l’antiquité grecque, ils ont pris leur temps tel qu’il était et ont trouvé pour lui un art intelligible, vivant, propre à instruire et à élever l’esprit du peuple. Un pareil résultat mérite bien qu’on s’y arrête, surtout si dans des données aussi étroites, ces artistes ont atteint le beau, l’idéal. S’en prendre à eux s’ils ne sculptaient point le Christ et la sainte Vierge nus comme Apollon et Vénus c’est leur faire une singulière querelle, d’autant que les Grecs eux-mêmes ne se sont pris d’amour qu’assez tard pour la beauté plastique dépouillée de tout voile. Mais la nécessité de vêtir la statuaire étant une affaire de mœurs, savoir donner au visage de beaux traits, une expression très-élevée, aux gestes un sentiment vrai et toujours simple, aux draperies un style plein de grandeur, c’était là un véritable mouvement d’art, neuf, original et certes plus sérieux que ne saurait l’être l’imitation éternelle des types de l’antiquité. Ces imitations de chic, le plus souvent, et dont on a tant abusé n’ont pu faire, il est vrai, descendre d’un degré les chefs-d’œuvre des beaux temps de la Grèce dans l’esprit des amants de l’art et c’est ce qui fait ressortir l’inappréciable valeur de ces ouvrages ; mais cela ne saurait les faire estimer davantage de la foule, aussi la statuaire de nos jours est-elle devenue affaire de luxe entretenue par les gouvernements, ne répondant à aucun besoin, à aucun penchant de l’intelligence du public ; or nous ne pensons pas qu’un art soit, s’il n’est compris et aimé de tous.
À Athènes toute la ville se passionnait pour une statue. À Rome, au contraire, les objets d’art étaient la jouissance de quelques-uns ; aussi la Rome impériale n’a pas un art qui lui soit propre, au moins quant à la statuaire. Pendant les beaux temps du moyen âge l’art de la statuaire était compris, c’était un livre ouvert où chacun lisait. La prodigieuse quantité d’œuvres de statuaire que l’on fit à cette époque prouve combien cet art était entré dans les mœurs. Il faut considérer d’ailleurs que si toutes ces sculptures ne sont pas des chefs-d’œuvre, il n’en est pas une qui soit vulgaire ; l’exécution est plus ou moins parfaite, mais le style, la pensée, ne font jamais défaut. La statuaire remplit un objet, signifie quelque chose, sait ce qu’elle veut dire et le dit toujours. Et l’on pourrait mettre au défi de trouver dans un monument du moyen âge une figure, une seule, occupant une place sans autre raison, comme cela se fait tous les jours au XIXe siècle, que de loger quelque part une statue achetée par l’État à M. X…
Un statuaire dans son atelier fait une statue pour une exposition publique ; cette statue était il y a trente ans un Cincinnatus, ou un Solon, ou une nymphe ; aujourd’hui c’est un jeune pâtre, ou une idée métaphysique, l’Espérance, l’Attente, le Désespoir. Deux ou trois particuliers en France, ou l’État, peuvent seuls acheter cette œuvre… Acquise, où la place-t-on ? Dans un jardin ?.. Dans un musée de province ? Dans la niche vide de tel ou tel édifice ? Dans une chapelle ou dans le vestibule d’un palais ?
Or, comment une statue conçue dans un atelier, sans savoir quelle sera sa destination, si elle sera éclairée par les rayons du soleil ou par un jour intérieur, comment cette statue, achetée par des personnes qui ne l’ont point demandée pour un objet et qui ne savent où la placer, comment cette statue, disons-nous, produirait-elle une impression sur le public ? Excepté quelques amateurs qui pourront apprécier certaines qualités d’exécution, qui s’en occupera ? Qui la regardera ?
Si des Athéniens voyaient ces niches vides dans nos édifices, attendant des statues inconnues, et ces statues dans des ateliers demandant des places qui n’existent pas, nous croyons qu’ils nous trouveraient de singulières idées sur les arts, et qu’en allant regarder les portails de Chartres, de Paris, d’Amiens ou de Reims, ils nous demanderaient quel était le peuple, dispersé aujourd’hui, auteur de ces œuvres. Mais si nous leur répondions, ainsi que de raison, que ces maîtres passés étaient nos ancêtres, nos ancêtres barbares… et que nous, gens civilisés, nous pratiquons l’art de la statuaire pour cinq ou six cents amateurs en France ou prétendus tels ; que d’ailleurs la multitude n’est pas faite pour comprendre ces produits académiques développés à grand’peine, en serre chaude, les Athéniens nous riraient au nez.
Le grand malentendu, c’est de supposer que le beau, parce qu’il est un est attaché à une seule forme ; or, la forme que revêt le beau et l’essence du beau ce sont deux choses aussi distinctes que peuvent l’être une pensée et la façon de l’exprimer, le principe créateur et la créature. L’erreur moderne des statuaires est de croire qu’en reproduisant l’enveloppe ils reproduisent l’être ; qu’en copiant l’instrument ils donnent l’idée de la mélodie.
L’idéal plastique du Grec possède l’agent, l’âme, le souffle qui l’a fait composer, parce que l’artiste grec a cherché logiquement une forme qui rendît sa pensée et l’a trouvée ; mais faire l’opération inverse, prendre l’imitation plastique seulement, puisque nous ne pouvons avoir ni les idées, ni les aspirations intellectuelles qui guidaient l’artiste, et croire que dans ce cadavre va venir se loger un souffle, c’est une illusion aussi étrange que serait celle du fabricant de fleurs artificielles attendant l’épanouissement d’un bouton de rose façonné par lui avec une rare perfection. Le merveilleux, c’est de nous entendre accuser de matérialisme en fait d’art, par ceux qui ne voient dans l’art de la statuaire que la reproduction indéfinie d’un type reconnu beau, mais auquel nous sommes impuissants à rendre l’âme qui l’a fait naître ! Nous avons la prétention de nous croire spiritualistes au contraire lorsque nous disons : « Ou ayez sur les forces de la nature, sur les émanations de la divinité les idées des Grecs, vivez dans leur milieu, si vous voulez essayer de faire de la statuaire comme celle qu’ils nous ont laissée, ou si vous ne pouvez retrouver ces conditions, cherchez autre chose. » Certes il n’est pas nécessaire d’être croyant pour exprimer, par les arts plastiques, des sentiments qui impressionnent des croyants, il est fort possible que Phidias ne fut nullement dévôt, mais il faut vivre dans un milieu d’idées ayant cours pour pouvoir leur donner une valeur compréhensible et pour pouvoir animer le bloc de marbre ou de pierre. Un athée payen pouvait être saisi de respect devant la statue de Jupiter d’Olympie, de Phidias, parce que cet homme, tout athée qu’il fût, se rendait compte de l’idée élevée que le Grec attachait au Zeus et vivait au milieu de gens qui l’adoraient. L’intelligence se séparait en lui de l’incrédulité. Mais aussi est-ce bien plutôt, le dirons-nous encore, l’intelligence que le sentiment qui permet à l’artiste de produire une impression, de donner le souffle à sa création. — Il est entendu que nous prenons ici l’intelligence, comme intellect, faculté de s’approprier et de rendre des idées, même ne vous appartenant pas. — Il en est de cela comme de l’acteur qui généralement produit d’autant plus d’effet sur le public qu’il comprend les sentiments qu’il exprime, non parce qu’il en est ému et qu’ils émanent de lui, mais parce qu’il a observé comment se comportent ceux qui les éprouvent. Or, nous est-il possible aujourd’hui de croire que nous faisons des statues pour des Grecs du temps de Périclès ? Peut-il y avoir entre le public et nous cette communauté d’idées — admettant que nous soyons, nous, mythologues savants — qui existait entre Phidias et son public ? Cette communauté d’idées n’existant pas, ces figures que nous faisons en imitant la statuaire grecque peuvent-elles avoir une âme, émaner d’une pensée compréhensible pour la foule ? Certes non, dès lors ces œuvres sont purement matérielles. Ne portons donc pas l’accusation de matérialistes à ceux qui cherchent autre chose dans la statuaire qu’une reproduction de types qui n’ont plus de vie au milieu de notre société et qui croient que la première condition d’un art c’est l’idée qui le crée.
Nous allons voir comment l’idée se dégage pendant le moyen âge, des tentatives faites par les écoles de statuaires du XIIe siècle. Nous avons essayé de faire sentir comment ces statuaires instruits par les méthodes byzantines, avaient peu à peu laissé de côté l’hiératisme byzantin et avaient cherché l’individualisme, c’est-à-dire s’étaient mis à copier fidèlement des types qu’ils avaient sous les yeux. Toutes les écoles cependant ne procédaient pas de la même manière ; pendant que celles du Nord passaient de l’hiératisme au réalisme ou plutôt mêlaient les traditions, les méthodes et le faire du byzantin à une imitation scrupuleuse dans les nus, les têtes, les pieds, les mains, d’autres écoles manifestaient d’autres tendances. La belle école de Toulouse penchait vers une exécution de plus en plus délicate, étudiait avec scrupule le geste, les draperies, l’expression dramatique. L’école provençale, sous l’influence de la sculpture gallo-romaine se dégageait bien difficilement de ces modèles si nombreux sur le sol. Une autre école faisait des efforts pour épurer les méthodes byzantines sans chercher la préciosité de l’école toulousaine ni pencher vers le réalisme des écoles du Nord.
Cette école a laissé des traces d’Angoulême à Cahors et occupe un demi-cercle dont une branche naît dans la Charente, se développant vers Angoulême, Limoges, Uzerche, Tulle, Brives, Souillac et Cahors. Sur ce point, elle joint à Moissac l’école de Toulouse. On sait que dès une époque fort reculée du moyen âge il y avait à Limoges des comptoirs vénitiens. Il ne serait donc pas surprenant que les villes que nous venons de signaler eussent eu des rapports très-étendus et fréquents avec l’Orient. Aussi la statuaire dans ces contrées prend un caractère de grandeur et de noblesse qu’elle n’a point à Toulouse. Il semblerait que l’influence byzantine fût plus pure ou du moins qu’ayant commencé plutôt, elle eût donné le temps aux artistes locaux de se développer avant la réaction de la fin du XIIe siècle. En effet, à Cahors, sur le tympan de la porte septentrionale de la cathédrale qui paraît appartenir au commencement du XIIe siècle, il existe un grand bas-relief d’une beauté de style laissant assez loin les sculptures de la même époque que l’on voit à Toulouse et dans les provinces de l’Ouest. De ce bas-relief nous donnons le Christ (fig. 14) qui en occupe le centre dans une auréole allongée.
En effet, la sculpture ne peut être considérée comme un art que du jour où elle se met à la recherche de l’idéal. Le XIIe siècle est une époque de préparation ; les artistes sont occupés à apprendre leur état, mais — grâce à cette liberté d’allure qui, en France, finit toujours par prendre le dessus, — tentent de se soustraire à l’hiératisme byzantin, d’abord en cherchant dans la peinture grecque les éléments dramatiques qui lui manquent dans la statuaire, puis en recourant à la nature.
Cette évolution de l’art français coïncide avec un fait historique important ; le développement de l’esprit communal, l’affaissement de l’état monastique et l’aurore de l’unité politique se manifestant sous une influence prépondérante prise par le pouvoir royal. L’art de la statuaire appartient aux laïques ; il s’émancipe dans ces belles écoles qui s’affranchissent, vers la fin du XIIe siècle, de la tutelle monastique.
Il y a ici des questions complexes qui ne semblent pas avoir été suffisamment appréciées. Les historiens sont peu familiers avec l’étude et la pratique des arts plastiques et les artistes ne vont guère chercher les causes d’un développement ou d’un affaissement des arts dans un état particulier de la société. Aussi vivons-nous sous l’empire d’un certain nombre d’opinions banales dont personne ne songe à contrôler la valeur. Pour que les arts arrivent à une sorte de floraison rapide, comme chez les Athéniens, comme au commencement du XIIIe siècle chez nous comme dans certaines villes italiennes pendant le XIVe et le XVe siècle, il faut qu’il s’établisse un milieu social particulier, milieu social que nous nommerons, faute d’un autre nom, état municipal. Lorsque par suite de circonstances politiques, des cités sont entraînées à faire leurs affaires elles-mêmes, qu’elles ont, comme Athènes, mis de côté des tyrans ; qu’elles ont, comme nos villes du nord de la France, pu obtenir une indépendance relative entre des pouvoirs également forts et rivaux, en donnant leur appui tantôt aux uns, tantôt aux autres ; comme les républiques italiennes en s’enrichissant par l’industrie et le commerce ; ces cités forment très-rapidement un noyau compact, vivant dans une communion intime d’idées, d’intérêts se développant dans un sens favorable aux expressions de l’art. Alors la nécessité politique d’existence forme des associations solidaires, des corporations que les pouvoirs ne peuvent dissoudre et qu’ils cherchent au contraire à s’attacher. Ces corporations, si elles sont comme en France, en présence d’une organisation féodale luttant contre une puissance monarchique qui cherche à se constituer, obtiennent bientôt les privilèges qui assurent leur existence. L’émulation, le désir de prendre un rang important dans la cité, de marcher en avant, de dépasser les villes voisines, non-seulement en influence mais en richesse de manifester extérieurement ce progrès, deviennent un stimulant très-propre à ouvrir aux artistes une large carrière. Il ne s’agit plus alors de copier dans des cellules de moines des œuvres traditionnelles, sans s’enquérir de ce qui se passe au dehors, mais au contraire de rivaliser d’efforts et d’intelligence pour faire de cette société urbaine un centre assez puissant, riche et composé d’éléments habiles pour que, quoiqu’il advienne, il faille compter avec lui.
Au commencement du XIIIe siècle, les moines ne sont plus maîtres ès-arts, ils sont débordés par une société d’artistes laïques que peut-être ils ont élevés, mais qui ont laissé de côté leurs méthodes surannées. La cour n’existe pas encore, et ne peut imposer ou avoir la prétention d’imposer un goût, comme cela s’est fait depuis le XVIe siècle. La féodalité toute occupée de ses luttes intestines, de combattre les empiètements du haut clergé, des établissements monastiques, et du pouvoir royal, ne songe guère à gêner le travail qui se fait dans les grandes cités qu’elle n’aime guère et où elle réside le moins possible. On conçoit donc que dans un semblable état une classe comme celle des artistes jouisse d’une liberté intellectuelle très-étendue ; elle n’est pas sous la tutelle d’une académie ; elle n’a pas affaire à de prétendus connaisseurs, ou à plaire à une cour ; ce qu’elle considère comme le progrès sérieux de l’art l’inquiète seul et dirige sa marche.
L’attitude que les évêques avait prise à cette époque vis-à-vis de la féodalité laïque et des établissements religieux, en s’appuyant sur l’esprit communal tendant à s’organiser, était favorable à ce progrès des arts, définitivement tombés dans les mains des laïques. Ces prélats pensant un moment établir une sorte de théocratie municipale, ainsi que cela avait eu lieu à la chute de l’Empire romain, et, une fois devenus magistrats suprêmes des grandes cités, n’avoir plus à compter avec toute la hiérarchie féodale, avaient puissamment aidé à ce développement des arts par l’érection de ces vastes cathédrales que nous voyons encore aujourd’hui.
Ces monuments, qui rivalisaient de splendeur furent, de 1160 à 1240, l’école active des architectes, imagiers, peintres, sculpteurs, qui trouvaient là un chantier ouvert dans chaque cité et sur lequel ils conservaient toute leur indépendance ; car les prélats, désireux avant tout d’élever des édifices qui fussent la marque perpétuelle de leur protection sur le peuple des villes, qui pussent consacrer le pouvoir auquel ils aspiraient, se gardaient de gêner les tendances de ces artistes. Loin de là, la cathédrale devait être, avant tout, le monument de la cité, sa chose, son bien, sa garantie, sorte d’arche d’alliance entre le pouvoir épiscopal et la commune ; c’était donc à la population laïque à l’élever, et moins la cathédrale ressemblait à une église conventuelle et plus l’évêque devait se flatter de voir s’établir entre la commune et lui cette alliance qu’il considérait comme le seul moyen d’assurer sa suprématie au centre de la féodalité. Le rôle que joue la statuaire dans ces cathédrales est considérable. Si l’on visite celles de Paris, de Reims, de Bourges, d’Amiens, de Chartres, on est émerveillé, ne fût-ce que du nombre prodigieux de statues et bas-reliefs qui complètent leur décoration.
À dater des dernières années du XIIe siècle, l’école laïque, non-seulement a rompu avec les traditions byzantines conservées dans les monastères, mais elle manifeste une tendance nouvelle dans le choix des sujets, et la manière de les exprimer.
Au lieu de s’en tenir presque exclusivement aux reproductions de sujets légendaires dans la statuaire, comme cela se faisait dans les églises conventuelles, elle ouvre l’Ancien et le Nouveau Testament, se passionne pour les encyclopédies, et cherche à rendre saisissables pour la foule certaines idées métaphysiques. Il ne semble pas que l’on ait pris garde à ce mouvement d’art du commencement du XIIIe siècle, l’un des faits intellectuels les plus intéressants de notre histoire. Qu’il ait été aidé par l’épiscopat, ce n’est guère douteux ; mais qu’il émane de l’esprit laïque ce l’est encore moins. Aussi qu’arrive-t-il ? les chroniqueurs d’abbayes, empressés, avant cette époque, de vanter les moindres travaux dus aux moines, qui relatent avec un soin minutieux et une exagération naïve, les embellissements de leurs églises ; qui voient du marbre et de l’or là où l’on emploie de la pierre ou du plomb doré, se taisent tout à coup et n’écrivent plus un mot touchant les constructions dorénavant confiées aux laïques, même dans les monastères. Ils subissent le talent de ces nouveaux venus dans la pratique des arts, ils acceptent l’œuvre, mais quant à la vanter ou à mettre en lumière son auteur, ils n’ont garde. Pour les cathédrales, si la chronique parle de leur construction, elle montre des populations entières mues par un souffle religieux amenant les pierres et les élevant comme par l’effet d’une grâce toute spéciale. Or imagine-t-on des populations urbaines concevant, traçant, taillant et dressant des édifices comme la cathédrale de Chartres, comme celles de Paris ou de Reims, et ces mêmes citadins prenant le ciseau pour sculpter ces myriades de figures ? C’est cependant sur ces graves niaiseries que beaucoup jugent ces arts ; comme s’il était du ressort de la foi, si pure qu’elle fût, d’enseigner la géométrie, le trait, la pratique de la construction, l’art de modeler la terre ou de sculpter la pierre.
Dans les églises clunisiennes du XIe et du XIIe siècle, la statuaire ne reproduit guère que des sujets empruntés aux légendes de saint Antoine, de saint Benoît, de sainte Madeleine, ou même de personnages moins considérables, et il faut reconnaître que dans ces légendes les imagiers, qui certes alors travaillaient dans les couvents s’ils n’étaient moines eux-mêmes, choisissaient les sujets les plus étranges. Pour des portails, on reproduisait les grandes scènes du Jugement. On faisait les honneurs du lieu saint aux personnages divins et aux apôtres, mais partout ailleurs les scènes de l’Ancien ou du Nouveau Testament ne prenaient qu’une petite place. Saint Bernard en s’élevant contre cette abondance de représentations sculptées qu’il considère comme des fables grossières mises sous les yeux du peuple, sut interdire l’art de la statuaire à l’ordre institué par lui. Les cisterciens du XIIe siècle sont de véritables iconoclastes. Soit que le blâme amer de saint Bernard ait porté coup sur les esprits, soit que l’épiscopat partageât en partie ses idées à ce sujet, soit qu’un esprit philosophique eût déjà pénétré les populations des grands centres, toujours est-il que lorsqu’on élève les cathédrales, de 1180 à 1230, l’iconographie de ces édifices prend un caractère différent de celle admise jusqu’alors dans les églises monastiques. Les sujets empruntés aux légendes disparaissent presque entièrement. La sculpture va chercher ses inspirations dans l’Ancien et le Nouveau Testament, puis elle adopte tout un système iconographique sans précédents. Elle devient une encyclopédie représentée. Si les scènes principales indiquées dans le Nouveau Testament prennent la place importante, si le Christ assiste au Jugement, si le royaume du ciel est figuré, si l’histoire de la sainte Vierge se développe largement, si la hiérarchie céleste entoure le Sauveur ressuscité, à côté de ces scènes purement religieuses apparaissent, l’histoire de la Création, le combat des Vertus et des Vices, des figures symboliques, la Synagogue, l’Église personnifiées, les Vierges sages et folles, la Terre, la Mer, les productions terrestres, les Arts libéraux. Puis les prophéties qui annoncent la venue du Messie, les ancêtres du Christ, le cycle davidique commençant à Jessé.
Il y a donc dans cette statuaire de nos grandes cathédrales un ordre, et un ordre très-vraisemblablement établi par les évêques, suivant un système étranger à celui qui avait été admis dans les églises conventuelles. Mais à côté de cet ordre, il y a l’exécution qui, elle, appartient à l’école laïque. Or, c’est dans cette exécution qu’apparaît un esprit d’indépendance tout nouveau alors, mais qui pour cela n’en est pas moins vif. Dans les représentations des vices condamnés à la géhenne éternelle, les rois, les seigneurs, ni les prélats ne font défaut. Les vertus ne sont plus représentés par des moines, comme sur les chapiteaux de quelques portails d’abbayes, mais par des femmes couronnées : l’idée symbolique s’est élevée ; parmi ces vertus apparaît, comme à Chartres, la Liberté (Libertas). L’Avarice figurée sur les portails des églises abbatiales de Saint-Sernin de Toulouse et de Sainte-Madeleine de Vézelay, par un homme portant au cou une énorme sacoche et tourmenté par deux démons hideux, est représentée au portail de la cathédrale de Sens par une femme les cheveux en désordre, assise sur un coffre qu’elle ferme avec un mouvement plein d’énergie. L’artiste remplace la représentation matérielle par une pensée philosophique. Plus de ces scènes repoussantes, si fréquentes dans les églises abbatiales du commencement du XIIe siècle. Le statuaire du XIIIe siècle, ainsi que l’artiste grec, a sa pudeur, et s’il figure l’Enfer comme à la grande porte occidentale de Notre-Dame de Paris, c’est par la combinaison tourmentée des lignes, par les expressions de terreur données aux personnages, par leurs mouvements étranges, qu’il prétend décrire la scène et non par des détails de supplices repoussants ou ridicules. Le côté de damnés sur les voussures de la porte principale de Notre-Dame de Paris est empreint d’un caractère farouche et désordonné qui contraste singulièrement avec le style calme de la partie réservée aux élus. Toutes ces figures des élus expriment une placidité, une douceur quelque peu mélancolique qui fait songer et qu’on ne trouve pas dans la statuaire du XIIe siècle, ni même dans celle de l’antiquité.
C’est maintenant que nous devons parler de l’expression des sentiments moraux, si vivement sentie par ces artistes du XIIIe siècle et qui les classent au premier rang. Nos lecteurs voudront bien croire que nous n’allons pas répéter ici ce que des admirateurs plutôt passionnés qu’observateurs de l’art gothique ont dit sur cette belle statuaire, en prétendant la mettre en parallèle et même au-dessus de la statuaire de la bonne époque grecque, en refusant à cette dernière l’expression des sentiments de l’âme ou plutôt d’un état moral. Non ; nous nous garderons de tomber dans ces exagérations qui ne prouvent qu’une chose, c’est qu’on n’a ni vu, ni étudié les œuvres dont on parle. Les artistes qui, au XVIIe siècle, prétendaient faire de la statuaire expressive, étaient aussi éloignés de l’art du moyen âge que de l’art antique, et le Puget, malgré tout son mérite, n’est qu’un artiste maniéré à l’excès, prenant la fureur pour l’expression de la force, les grimaces pour l’expression de la passion, le théâtral pour le dramatique. De toutes les figures de Michel-Ange, à nos yeux la plus belle est celle du Laurent de Médicis dans la chapelle de San-Lorenzo, à Florence. Mais cette statue est bien loin encore des plus belles œuvres grecques et ne dépasse pas certaines productions du moyen âge. Expliquons-nous. La statuaire n’est pas un art se bornant à reproduire en terre ou en marbre une académie, c’est-à-dire un modèle plus ou moins heureusement choisi, car ce ne serait alors qu’un métier, une sorte de mise au point. Tout le monde est, pensons-nous, d’accord sur ce chapitre ; tout le monde (sauf peut-être quelques réalistes fanatiques) admet qu’il est nécessaire d’idéaliser la nature. Comment les Grecs ont-ils idéalisé la nature ? C’est en formant un type d’une réunion d’individus. De même que, dans un poëme, un auteur peut réunir toutes les vertus qui se trouvent éparses chez un grand nombre d’hommes, mais dont chacun, en particulier, a la conscience sans les pratiquer à la fois ; de même sur un bloc de marbre ou avec un peu de terre, le statuaire grec a su réunir toutes les beautés empruntées à un certain nombre d’individus choisis. La conséquence morale et physique de cette opération de l’artiste, c’est d’obtenir une pondération parfaite, pondération dans l’expression intellectuelle. Par conséquent, si violente que soit l’action à laquelle se livre ce type, si vifs que soient ses sentiments, du moment que l’idéal est admis (c’est-à-dire le beau par excellence, c’est-à-dire la pondération), la grimace, soit par le geste, soit par l’expression des traits, est exclue. Les Lapithes, qui combattent si bien les Centaures sur les métopes du Parthénon, expriment parfaitement leur action, mais ce n’est ni par des grimaces, ni par l’exagération du geste, ni par un jeu outré des muscles. Le geste est largement vrai dans son ensemble, finement observé dans les détails, mais ces hommes ne font point des contorsions à la manière des personnages de Michel-Ange. Si les traits de leurs visages paraissent conserver une sorte d’impassibilité, le mouvement des têtes, un léger froncement de sourcil, expriment la lutte bien mieux que ne l’aurait fait une décomposition des lignes de la face. On ne saurait prétendre que les têtes, malheureusement trop rares, des statues de la belle époque grecque, soient dépourvues d’expression ; elles ne sont jamais grimaçantes, d’accord ; il ne faut pas plus les regarder après avoir vu celles du Puget qu’il ne faut goûter un mets délicat après s’être brûlé le palais avec une venaison pimentée. Mais pour retrouver cette expression si fine des types de têtes grecques, il ne s’agit pas de les copier niaisement et de nous encombrer d’un amas de pastiches plats ; mieux vaut alors tomber dans le réalisme brutal et copier le premier modèle venu, voire le mouler, ce qui est plus simple. Est-ce à dire que ces types du beau, trouvés par les Grecs, fussent d’ailleurs identiques, qu’ils aient exclu l’individualité ? Sur les quatre ou cinq têtes de Vénus, réparties dans les musées de l’Europe et qui datent de la belle époque, bien que l’on ne puisse se méprendre sur leur qualité divine, y en a-t-il deux qui se ressemblent ? Parmi ces têtes qui semblent appartenir à une race d’une perfection physique et intellectuelle supérieures, l’une possède une expression de bonté insoucieuse, l’autre laisse deviner, à travers ses traits si purs, une sorte d’inflexibilité jalouse, une troisième sera dédaigneuse, etc. ; mais toutes, comme pour conserver un cachet appartenant à l’antiquité, font songer à la fatalité inexorable, qui jette sur leur front comme un voile de sérénité pensive et grave. Retrouvons-nous ce milieu qui nous permette de reproduire ces expressions si délicates ? Voyons-nous autour de nous des gens subissant ces influences de la société antique ? Les cerveaux d’aujourd’hui songent-ils aux mêmes choses ? Non, certes. Mais nos physionomies ne disent-elles rien ? N’est-il pas possible aux statuaires de procéder au milieu de notre société comme les Athéniens ont procédé chez eux ? Ne peut-on extraire et de ces formes physiques et de ces sentiments moraux dominants, des types beaux qui, dans deux mille cinq cents ans, produiraient sur les générations futures l’effet profond qu’exercent sur nous les œuvres grecques ? Cela doit être possible, puisque cela s’est fait déjà au milieu d’une société qui n’avait nuls rapports avec la société grecque.
Cette école du XIIIe siècle qui n’avait certes pas étudié l’art grec en Occident et qui en soupçonnait à peine la valeur, se développe comme l’école grecque. Après avoir appris la pratique du métier, ainsi que nous l’avons démontré plus haut, elle ne s’arrête pas à la perfection purement matérielle de l’exécution et cherche un type de beauté. Va-t-elle le saisir de seconde main, d’après un enseignement académique ? Non ; elle le compose en regardant autour d’elle. Nous verrons que pour la sculpture d’ornement cette école procède de la même manière, c’est-à-dire qu’elle abandonne entièrement des errements admis, pour recourir à la nature comme à une forme toujours vivifiante. Apprendre le métier, le conduire jusqu’à une grande perfection en se faisant le disciple soumis d’une tradition, quitter peu à peu ce guide pour étudier matériellement la nature, puis un jour se lancer à la recherche de l’idéal quand on se sent des ailes assez fortes, c’est ce qu’ont fait les Grecs, c’est ce qu’ont fait les écoles du XIIIe siècle. Et de ces écoles, la plus pure, la plus élevée est, sans contredit, l’école de l’Île-de-France. Celle de Champagne la suit de près, puis l’école picarde. Quant à l’école rhénane, nous en parlerons en dernier lieu, parce qu’en effet elle se développa plus tardivement.
Dès les premières années du XIIIe siècle, la façade occidentale de Notre-Dame de Paris s’élevait. À la mort de Philippe-Auguste, c’est-à-dire en 1223, elle était construite jusqu’au-dessus de la rose. Donc — toutes les sculptures et failles étant terminées avant la pose — les trois portes de cette façade étaient montées en 1220. Celle de droite, dite de Sainte-Anne, est en grande partie refaite avec des sculptures du XIIe siècle, mais celle de gauche, dite porte de la Vierge, est une composition complète et l’une des meilleures de cette époque[16]. Il est évident pour tout observateur attentif et non prévenu — car beaucoup d’artistes, bien convaincus que cette sculpture est sans valeur n’ont jamais pris la peine de la regarder[17] — que les statuaires auteurs de ces nombreuses figures ont abandonné entièrement les traditions byzantines, dans la conception comme dans les détails et le faire, qu’ils ont soigneusement étudié la nature et qu’ils atteignent un idéal leur appartenant en propre. Voici (fig. 15) une tête d’un des rois, petite nature, qui garnissent l’une des voussures de cette porte.
Si nous nous attachons à l’exécution de cette statuaire, nous trouvons ce faire large, simple, presque insaisissable des belles œuvres grecques ; c’est la même sobriété de moyens, le même sacrifice des détails, la même souplesse et la même fermeté à la fois dans la façon de modeler les nus. D’ailleurs ces figures sont taillées dans une pierre dont la dureté égale presque celle du marbre de Paros. C’est du liais cliquart, le plus serré et le mieux choisi.
Nous avons décrit à l’article Porte cette statuaire, la plus remarquable du portail de Notre-Dame de Paris. Ce n’est pas seulement par l’expression noble des têtes qu’elle se recommande ; au point de vue de la composition elle accuse un art très-profondément étudié et senti. Le bas-relief de la mort de la Vierge est une scène admirablement entendue comme effet dramatique, comme agencement de lignes. Celle du couronnement de la Mère du Christ, dont nous présentons figure 16 un tracé bien insuffisant, fait assez connaître que ces artistes savaient composer, agencer les lignes d’un groupe et rendre une action par les mouvements et par l’expression du geste ; les têtes des deux personnages sont admirablement belles par la simplicité des attitudes et la pureté de l’expression.

C’est ici le cas de faire une observation. On parle beaucoup, lorsqu’il est question de cette statuaire du XIIIe siècle, de ce qu’on appelle le sentiment religieux et l’on est assez disposé à croire que ces artistes étaient des personnages vivant dans les cloîtres et tout attachés aux plus étroites pratiques religieuses. Mais sans prétendre que ces artistes fussent des croyants tièdes, il serait assez étrange cependant que ce sentiment religieux se fût manifesté d’une manière tout à fait remarquable dans l’art de la statuaire, précisément au moment où les arts ne furent plus guère pratiqués que par des laïques et sur ces cathédrales pour la construction desquelles les évêques se gardaient bien de s’adresser aux établissements religieux. Il ne serait pas moins étrange que l’art de la statuaire, pendant tout le temps qu’il resta confiné dans les cloîtres, ne produisit que des œuvres possédant certaines qualités entre lesquelles ce qu’on peut appeler le sentiment religieux n’apparaît guère que sous une forme purement traditionnelle, ainsi que des exemples précédents ont pu le faire voir.
Voici le vrai. Tant que les arts ne furent pratiqués que par des moines, la tradition dominait, et la tradition n’était qu’une inspiration plus ou moins rapprochée de l’art byzantin. Si les moines apportaient quelques progrès à cet état de choses, ce n’était que par une imitation plus exacte de la nature. La pensée était pour ainsi dire dogmatisée sous certaines formes ; c’était un art hiératique tendant à s’émanciper par le côté purement matériel. Mais lorsque l’art franchit les limites du cloître pour entrer dans l’atelier du laïque, celui-ci s’en saisit comme d’un moyen d’exprimer ses aspirations longtemps contenues, ses désirs et ses espérances. L’art, dans la société des villes devint, au milieu d’un état politique très-imparfait, — qu’on nous passe l’expression, — une sorte de liberté de la presse, un exutoire pour les intelligences toujours prêtes à réagir contre les abus de l’état féodal. La société civile vit dans l’art un registre ouvert où elle pouvait jeter hardiment ses pensées sous le manteau de la religion ; que cela fut réfléchi, nous ne le prétendons pas, mais c’était un instinct. L’instinct qui pousse une foule manquant d’air vers une porte ouverte. Les évêques, au sein des villes du Nord qui avaient dès longtemps manifesté le besoin de s’affranchir des pouvoirs féodaux, dans ce qu’ils crurent être l’intérêt de leur domination, poussèrent activement à ce développement des arts, sans s’apercevoir que les arts, une fois entre les mains laïques, allaient devenir un moyen d’affranchissement, de critique intellectuelle dont ils ne seraient bientôt plus les maîtres. Si l’on examine avec une attention profonde cette sculpture laïque du XIIIe siècle, si on l’étudie dans ses moindres détails, on y découvre bien autre chose que ce qu’on appelle le sentiment religieux ; ce qu’on y voit, c’est avant tout un sentiment démocratique prononcé dans la manière de traiter les programmes donnés, une haine de l’oppression qui se fait jour partout, et ce qui est plus noble et ce qui en fait un art digne de ce nom, le dégagement de l’intelligence des langes théocratiques et féodaux. Considérez ces têtes des personnages qui garnissent les portails de Notre-Dame, qu’y trouvez-vous ? L’empreinte de l’intelligence, de la puissance morale, sous toutes les formes. Celle-ci est pensive et sévère ; cette autre laisse percer une pointe d’ironie entre ses lèvres serrées. Là sont ces prophètes du linteau de la Vierge, dont la physionomie méditative et intelligente finit, si on les considère de près et pendant un certain temps, par vous embarrasser comme un problème. Plusieurs, animés d’une foi sans mélange, ont les traits d’illuminés ; mais combien plus expriment un doute, posent une question et la méditent ? Aussi nous expliquons-nous aujourd’hui les dédains et les colères même qu’excite, dans certains esprits, l’admiration que nous professons pour ces œuvres, surtout si nous les déclarons françaises. Au fond, cette protestation est raisonnée. Longtemps nous avons pensé — car tout artiste possède une dose de naïveté — qu’il y avait, dans cette opposition à notre admiration, ignorance des œuvres, présomptions ou préjugés qu’un examen sincère pourrait vaincre à la longue. Nous nous abusions complètement. La question, c’est qu’il ne faut pas que cet art puisse passer pour beau, et il ne faut pas que cet art soit admis comme beau, parce qu’il est une marque profonde de ce que peut obtenir l’affranchissement des intelligences et des développements que cet affranchissement peut prendre. Une école qui, élevée sous des cloîtres, dans des traditions respectées, s’en éloigne brusquement, pour aller demander la lumière à sa propre intelligence, à sa raison et à son examen, pour réagir contre un dogmatisme séculaire et courir dans la voie de l’émancipation en toute chose ! Quel dangereux exemple qu’on ne saurait trop repousser ! Toutes les débauches nous seront permises en fait d’art et de goût, plutôt que l’admiration pour la seule époque de notre histoire où les artistes affranchis ont su trouver, en architecture, des méthodes et des formes toutes nouvelles, ont su élever une école de sculpteurs qui ne sont ni grecs, ni byzantins, ni romans, ni italiens, ni quoique ce soit qui ait paru dans le champ des arts depuis le siècle de Périclès, qui puisent dans leur propre fond en détournant les yeux du dogmatisme en fait d’art. Pour qui prétend maintenir en tutelle l’intelligence humaine comme une mineure trop prompte à s’émanciper, il est clair qu’un tel précédent intellectuel dans l’histoire d’un peuple doit être présenté sous le jour le plus sombre ; cela est logique. Mais il est plus difficile d’expliquer pourquoi beaucoup de personnes en France, dévouées aux idées d’émancipation et qui prétendent en protéger l’expression, ne voient dans ces productions du XIIIe siècle qu’un état maladif, étouffé sous un ordre social oppressif, qu’un signe d’asservissement moral. Asservissement à quoi ? On ne le dit pas. Foulez les cendres refroidies de la féodalité et de la théocratie, si bon vous semble ; il n’y a pas grand péril, car vous savez qu’elles ne sauraient se réchauffer, mais pourquoi écraser du même talon le système oppressif et ceux qui ont su les premiers s’en affranchir en réagissant contre l’énervement intellectuel au moyen âge ? Cela est-il équitable, courageux et habile ?
Le monument religieux était à peu près le seul où l’artiste pouvait exprimer ses idées, ses sentiments, il le fait d’une façon indépendante, hardie même. Il repousse l’hiératisme qui s’attache toujours à une société gouvernée par un despotisme quelconque, théocratique ou monarchique. Pourquoi lui refuseriez-vous ce rôle de précurseur dans la voie de l’émancipation de l’intelligence ?
On peut reconnaître les qualités d’un art en considérant quels sont ses détracteurs. Les admirations n’apprennent pas grand’chose, mais la critique de parti pris et le côté d’où elle vient, sont un enseignement précieux. Si vous voyez un siècle tout entier s’élever contre un art d’un temps antérieur, vous pouvez être assuré que les idées qui ont dominé dans cet art vilipendé sont en contradiction manifeste avec les idées de la société qui le repousse. Si vous voyez un corps, une association, une coterie d’artistes rejeter un art, vous pouvez être assuré que les qualités de cet art sont en opposition directe avec les méthodes et les façons d’être de ce corps. Si une école se signale par la médiocrité ou la platitude de ses productions, vous pouvez être assuré que l’école rejetée amèrement par elle se distinguait par l’originalité, la recherche du progrès et l’examen. Dans la république des arts, ce qu’on redoute le plus, ce n’est pas la critique contemporaine, pouvant toujours être soupçonnée de partialité, c’est la protestation silencieuse, mais cruelle, persistante, d’un art qui se recommande par les qualités qu’on ne possède plus. Dans un temps comme le siècle de Louis XIV où l’artiste n’était plus guère qu’un commensal de quelque grand seigneur, pensionné par le roi, subissant tous les caprices d’une cour, disposé à toutes les concessions pour plaire, à toutes les flatteries pour vivre (car on flatte avec le ciseau comme avec la plume), il n’est pas surprenant que la statuaire du XIIIe siècle avec son caractère individuel, indépendant, dût paraître barbare. Placez un de ces beaux bronzes étrusques comme le Musée britannique en possède tant, sur la cheminée d’une dame à la mode, au milieu de chinoiseries, de biscuits, de vieux Sèvres, de ces mièvreries tant recherchées de la fin du dernier siècle, et voyez quelle figure fera le bronze antique ? Il était naturel que les critiques du dernier siècle qui mettaient, par exemple, le tombeau du maréchal de Saxe au niveau des plus belles productions de l’antiquité, trouvassent importunes les sculptures hardies des beaux temps du moyen âge. Le clergé lui-même mit un acharnement particulier à détruire ces dénonciateurs permanents de l’état d’avilissement où tombait l’art. Ceux dont le devoir serait de lutter contre l’affaiblissement d’une société et qui, loin d’en avoir le courage et la force, profitent de ce relâchement moral, s’attaquent habituellement à tout ce qui fait un contraste avec l’état de décadence où tombe cette société. Quand les chapitres, quand les abbés du dernier siècle jetaient bas les œuvres d’art des beaux moments du moyen âge, ils rendaient à ces œuvres le seul hommage qu’ils fussent désormais en état de leur rendre ; ils ne pouvaient souffrir qu’elles fussent les témoins des platitudes dont on remplissait alors les édifices religieux. C’était la pudeur instinctive de l’homme qui, livré à la débauche, raille et cherche à disperser la société des honnêtes gens. Les statues pensives et graves de nos portails n’étaient bonnes qu’à envoyer de mauvais rêves aux petits abbés de salon ou à ces chanoines qui, afin d’augmenter leurs revenus, vendaient les enceintes de leurs cathédrales pour bâtir des échoppes. Aujourd’hui encore une partie du clergé français ne voit qu’avec défiance se manifester l’admiration pour la bonne sculpture du moyen âge. Il y a là dedans des hardiesses, des tendances indépendantes fâcheuses ; ces figures de pierre ont l’air trop méditatives. On aime mieux les saints à l’air évaporé, aux gestes théâtrals, ou les vierges ressemblant à des bonnes décentes, ces anges affadis et toutes ces pauvretés auxquelles l’art est à peu près étranger, mais qui, ne disant rien, ne compromettent rien. Beaucoup de personnages respectables — et nous plaçant à leur point de vue, nous comprenons parfaitement l’esprit qui les guide — n’ont pas vu sans une certaine appréhension ce mouvement archéologique qui poussait les intelligences vers l’étude des arts du moyen âge si soigneusement tenus sous le boisseau ; ils ont senti que la critique, entrant sur ce terrain du passé, allait remettre en lumière toute une série d’idées qui ébranleraient plusieurs temples ; celui de la religion facile élevé avec tant de soin depuis le XVIIe siècle ; celui de l’art officiel, commode, qui, n’admettant qu’une forme, rejette bien loin toute pensée, tout travail intellectuel comme une hérésie.
Tout s’enchaîne dans une société, et quand on y regarde de près aucun fait n’est isolé. La société qui au milieu d’elle admettait qu’une compagnie puissante condamnât l’esprit humain à un abandon absolu de toute personnalité, à une soumission aveugle, à une direction morale dont on ne devait même pas chercher le sens et la raison, cette société devait bientôt voir s’élever comme corollaire, dans le domaine de l’art, un principe semblable, ennemi acharné de tout ce qui pouvait signaler l’individualisme, l’examen, l’indépendance de l’artiste, le respect de l’art avant le respect pour le dogme qui prétend le diriger.
Ce qui frappe toujours dans les œuvres grecques, c’est que l’artiste d’abord respecte son art. On subit la même impression lorsqu’on examine les bonnes productions du XIIIe siècle ; que l’artiste soit religieux ou non, cela nous importe peu ; mais il est évidemment croyant à son art, et il manifeste toute la liberté d’un croyant, dont le plus grand soin est de ne pas mentir à sa conscience.
Nous avouons que, pour notre part, dans toute production d’art, ce qui nous saisit et nous attache, c’est presque autant l’empreinte de l’homme qui l’a créée que la valeur intrinsèque de l’objet. La sculpture grecque nous charme tant que nous entrevoyons l’artiste à travers son œuvre, que nous pouvons, sur le marbre qu’il a laissé, suivre ses penchants, ses désirs, l’expression de son vouloir, mais quand ces productions n’ont plus d’autre mérite que celui d’une exécution d’atelier, quand le praticien s’est substitué à l’artiste, l’ennui nous saisit. Ce que nous aimons par-dessus tout dans la statuaire du moyen âge, même la plus ordinaire, c’est l’empreinte individuelle de l’artiste toujours ou presque toujours profondément gravée sur la pierre. Dans ces figures innombrables du XIIIe siècle, on retrouve les joies, les espérances, les amertumes et les déceptions de la vie. L’artiste a sculpté comme il pensait, c’est son esprit qui a dirigé son ciseau ; et comme pour l’homme il n’est qu’un sujet toujours neuf, c’est celui qui traduit les sentiments et les passions de l’homme, on ne sera pas surpris si, en devinant l’artiste derrière son œuvre, nous sommes plus touchés que si l’œuvre n’est qu’un solide revêtissant une belle forme.
C’est là la question pour nous, au XIXe siècle. Devons-nous considérer le beau, suivant un canon admis, ou le beau est-il une essence se développant de différentes manières suivant des lois aussi variables que sont celles de l’esprit humain ? Au point de vue philosophique, la réponse ne saurait être douteuse ; le beau ne peut être que l’émanation d’un principe et non l’apparence d’une forme. Le beau naît et réside dans l’âme de l’artiste et doit se traduire d’après les mouvements de cette âme qui s’est habituée à concevoir le beau, la vérité. Ce n’est pas nous qui disons cela, mais un Grec. Et à ce propos qu’il nous soit permis de faire ressortir une de ces contradictions entre tant d’autres, quand il est question de l’esthétique. Nos philosophes modernes, nos écrivains, ne sont point artistes, nos artistes ne sont rien moins que philosophes ; de sorte que ces deux expressions de l’esprit humain chez nous, l’art et la philosophie, s’en vont chacune de leur côté et se trompent réciproquement ou trompent le public sur l’influence qu’elles ont pu exercer l’une sur l’autre. Il est évident que Socrate était fort sensible à la beauté plastique ; il avait quelque peu pratiqué la sculpture. Il vivait dans un milieu — que jamais il ne voulut quitter, même pour échapper à la mort, — où la beauté de la forme semblait subjuguer tous les esprits, et cependant c’est ainsi qu’il s’exprime quelque part[18] : « La philosophie, recevant l’âme liée véritablement et, pour ainsi dire, collée au corps, est forcée de considérer les choses non par elle-même, mais par l’intermédiaire des organes comme à travers les murs d’un cachot et dans une obscurité absolue, reconnaissant que toute la force du cachot vient des passions qui font que le prisonnier aide lui-même à serrer sa chaîne ; la philosophie, dis-je recevant l’âme en cet état, l’exhorte doucement et travaille à la délivrer ; et pour cela elle lui montre que le témoignage des yeux du corps est plein d’illusions comme celui des oreilles, comme celui des autres sens ; elle l’engage à se séparer d’eux, autant qu’il est en elle ; elle lui conseille de se recueillir et de se concentrer en elle-même, de ne croire qu’à elle-même, après avoir examiné au dedans d’elle et avec l’essence même de sa pensée ce que chaque chose est en son essence, et de tenir pour faux tout ce qu’elle apprend par un autre qu’elle-même, tout ce qui varie selon la différence des intermédiaires : elle lui enseigne que ce qu’elle voit ainsi c’est le sensible et le visible ; ce qu’elle voit par elle-même, c’est l’intelligible et l’immatériel… » Et avant Socrate le poëte Épicharme n’avait-il pas dit :
« C’est l’esprit qui voit, c’est l’esprit qui entend :
L’œil est aveugle, l’oreille est sourde. »
Donc ces Grecs qu’on nous représente (lorsqu’il est question des arts) comme absolument dévoués au culte de la beauté extérieure, de la forme, possédaient au milieu d’eux, dès avant Phidias, des poëtes, des philosophes qui chantaient et professaient quoi ? L’illusion des sens, le détachement de l’âme du corps, de ses appétits et de ses passions, l’asservissement de l’enveloppe matérielle à l’esprit. On avouera que sous ce rapport le christianisme n’a rien inventé. Mais si les Athéniens, tout en écoutant Socrate, taillaient les marbres du Parthénon et du temple de Thésée, ils alliaient difficilement les théories du philosophe avec cette importance merveilleuse donnée à la beauté extérieure… Socrate fut condamné à mort. Phidias fut exilé ; ce qui tendrait à prouver qu’à ce moment de la civilisation athénienne une lutte sourde commençait entre ces deux principes, de la prépondérance de la matière sur l’âme, de l’âme sur la matière. Et en effet Phidias n’est pas plutôt à Olympie qu’il façonne cette statue de Zeus, d’une si étrange beauté, si l’on en croit ceux qui l’ont vue, en ce qu’elle reflétait, sur une admirable forme, la pensée la plus profonde. Déjà donc, à l’apogée de la splendeur plastique de l’art grec s’élève la réaction, non contre la beauté plastique, mais contre la suprématie de cette beauté sur l’intelligence, sur ce que Socrate lui-même appelle la vérité née de la raison humaine. Qu’ont donc fait ces statuaires de notre belle école laïque primitive, si ce n’est de suivre cette voie ouverte par les Grecs eux-mêmes et de chercher, non point par une imitation plastique, mais dans leur pensée, tous les éléments de l’art dont ils nous ont laissé de si beaux exemples ?
Les statuaires du XIIIe siècle ne pouvaient avoir les idées, les sentiments des statuaires du temps de Périclès ; ayant d’autres idées, d’autres sentiments, il était naturel qu’ils cherchassent, pour les rendre, des moyens différents de ceux employés par les artistes grecs et en cela ils étaient d’accord avec les principes émis par les Grecs, si nous en croyons Platon. Mais, objectera-t-on : « nous ne contestons pas cela ; nous n’accusons pas les artistes du moyen âge de n’avoir pas produit des œuvres aussi bonnes que le permettait le milieu social où ils vivaient. Nous tenons à constater seulement que leurs œuvres ne sont pas et ne pouvaient être aussi belles que celles de l’époque grecque, et que par conséquent il est bon d’étudier celles-ci, funeste d’étudier celles-là. » Nous sommes d’accord, sauf sur la conclusion en ce qu’elle a au moins d’absolu. Nous répondrons : « Il est utile d’étudier la statuaire grecque et de s’enquérir en même temps de l’état social au milieu duquel elle s’est développée, parce que cet art est en harmonie avec cet état social et que sa forme sensible est parfaitement belle ; mais notre état social moderne étant différent de celui des Grecs, il est utile de savoir comment à d’autres époques, dans des conditions nouvelles étrangères à celles de la société grecque, des artistes ont su aussi développer un art sans imiter les Grecs et en conservant leur caractère propre ; parce qu’il est utile toujours de connaître les moyens sincères qu’emploie l’intelligence humaine pour se manifester. » Nier que l’état social et religieux de la Grèce n’ait pas été le milieu le plus favorable au développement des arts plastiques qui ait jamais existé, ce serait nier la lumière en plein midi ; mais prétendre que ce milieu puisse être le seul, ou plutôt que ce qu’il a produit doive sans cesse être reproduit, même dans d’autres milieux, c’est nier le développement de l’esprit humain, si bien préconisé par les Grecs eux-mêmes, et considérer les aspirations vers des horizons nouveaux comme les bouffées d’une sotte vanité. Nous accordons qu’on ne saurait dépasser la beauté plastique de la statuaire grecque, alors la conclusion devrait être de chercher une autre face non développée de la beauté. C’est dans ce sens que les efforts des statuaires du XIIIe siècle se sont dirigés. Dans leurs ouvrages la beauté purement plastique est certainement fort au-dessous de ce que nous a laissé la Grèce ; mais un nouvel élément intervient, c’est l’élément intellectuel que les Grecs les premiers ont fait surgir. La statuaire n’est plus seulement une admirable forme extérieure, une sublime apparence matérielle, elle devient un être révélant toute une suite d’idées, de sentiments. Toutes les statues grecques regardent dans leur présent — et c’est pour cela qu’il est si ridicule de les copier aujourd’hui que ce passé est bien loin — tandis que les statues du moyen âge des bons temps manifestent une pensée qui est de l’humanité tout entière et semblent vouloir deviner l’inconnu. C’est ce qui nous faisait dire tout à l’heure que beaucoup d’entre elles expriment le doute, non le doute mélancolique et découragé, mais le doute audacieux, investigateur ; ce doute qui, à tout prendre, conduit au grand développement des sociétés modernes, ce doute qui a formé les Bacon, les Galilée, les Pascal, les Newton, les Descartes. La statuaire des Grecs est sœur de la poésie ; celle du moyen âge pénètre dans le domaine de la psychologie et de la philosophie. Est-ce un malheur ? Qu’y faire ? si ce n’est en prendre résolûment son parti et profiter du fait au lieu d’essayer de le cacher. La plupart de nos statuaires ne sont-ils pas un peu comme des scribes s’amusant à recopier sans cesse des manuscrits enluminés et refusant de reconnaître l’invention de l’imprimerie ?
Il ne faudrait pas croire cependant que ces statuaires du XIIIe siècle n’ont pas pu, quand ils l’ont voulu, exprimer cette sérénité brillante et glorieuse qui est le propre de la foi. À Paris, à Reims, bon nombre de figures sont empreintes de ces sentiments de noble béatitude, que l’imagination prête aux êtres supérieurs à l’humanité. Les anges ont été pour eux un motif de compositions remarquables, soit comme ensemble, soit dans l’expression des têtes.
On peut voir dans les voussures de la porte principale de Notre-Dame de Paris deux zones d’anges à mi-corps dont les gestes et les expressions sont d’une grâce ravissante. La cathédrale de Reims a conservé une grande quantité de ces représentations d’êtres supérieurs, traitées avec un rare mérite. Les anges posés sur les grands contreforts et qui sont de dimensions colossales sont presque tous des œuvres magistrales. D’autres, d’une époque un peu plus ancienne, c’est-à-dire qui ont dû être sculptés vers l’année 1225 et qui sont adossés aux angles des chapelles absidales, sous la corniche, ont des qualités qui les mettent presqu’en parallèle, comme faire, avec la statuaire grecque du bon temps. Nous donnons (fig. 17) la tête d’un de ces anges.
Si cette tête d’ange est belle, intelligente, cette beauté ressemble-t-elle à celle des beautés grecques ? Nullement. Le front est haut et large, les yeux longs, à peine enfoncés sous les arcades sourcilières, le nez est petit, le crâne large aux tempes, le menton fin. C’est un type de jeune Champenois idéalisé, qui n’a rien de commun avec le type grec. Ce n’est pas là un tort, à nos yeux, mais une qualité. Idéaliser les éléments que l’on possède autour de soi, c’est là le véritable rôle du statuaire plutôt que de reproduire cent fois la tête de la Vénus de Milo, en lui enlevant, à chaque reproduction, quelque chose de sa fleur de beauté originale[20]. Nous n’avons pas suffisamment insisté sur les conditions dans lesquelles le beau se développait chez les Athéniens entre tous les Grecs. Si élevée que soit la doctrine de Platon, si merveilleux que soit le Phédon, comme grandeur et sérénité de la pensée, il ressort évidemment de l’argumentation de Socrate que la fin de l’homme c’est lui, c’est le perfectionnement de son esprit, le détachement de son âme des choses matérielles. Il y a dans le Phédon et dans le Criton particulièrement, une des plus belles définitions du devoir que l’on ait jamais faite. Mais il n’est question que du devoir envers la patrie ; l’humanité n’entre pour rien dans les pensées exprimées par Socrate. C’est à l’homme à s’élever par la recherche de la sagesse et par cette recherche il se détache autant du prochain que de son propre corps. La recherche de la beauté dans les arts, suivant les Athéniens, procédait de la même manière ; l’homme est sublime, l’humanité n’existe pas. C’est pourquoi tant de personnes, jugeant des choses d’art avec leur instinct seulement, tout en admirant une statue grecque, lui reprochent le défaut d’expression, ce qui n’est pas exact, mais plutôt le défaut de sensibilité humaine, ce qui serait plus près de la vérité. Tout individu-statue, plus il est parfait chez l’Athénien et plus il se rapproche d’un mythe-homme, complet, mais indépendant du reste de l’humanité, détaché, absolu dans sa perfection, Aussi, voyez la pente : de l’homme supérieur, le Grec fait un héros ; du héros, un dieu. Certes il y a là un véhicule puissant pour arriver à la beauté, mais est-ce à dire que ce véhicule soit le seul et surtout qu’il soit applicable aux sociétés modernes ? Et cela est particulièrement propre aux Athéniens, non point à toute la civilisation grecque. Les découvertes faites en dehors de l’Attique nous démontrent qu’on s’est fait chez nous, sur l’art grec, des idées trop absolues. Les Grecs pris en bloc ont été des artistes bien plus romantiques qu’on ne le veut croire. Il suffit, pour s’en convaincre, d’aller visiter le Musée britannique, mieux fourni de productions de la statuaire grecque que le Musée du Louvre. Ce qui ressort de cet examen, c’est l’extrême liberté des artistes. Les fragments du tombeau de Mausole, par exemple, qui certes datent d’un bon temps et qui sont très-beaux, ressemblent plus à de la statuaire de Reims qu’à celle du Parthénon. Nous en sommes désolés pour les classiques qui se sont fait un petit art grec commode pour leur usage particulier et celui de leurs prosélytes ; c’est d’un déplorable exemple, mais c’est grec et bien grec ; et ce monument était fort prisé par les Grecs, puisqu’il fut considéré comme la septième merveille des arts. Pouvons-nous admettre que les Grecs ne s’y connaissaient pas ?
La statue du roi de Carie est presque entièrement conservée, compris la tête ; et tout le personnage rappelle singulièrement une des statues du portail de Reims que nous donnons ici (fig. 18), en engageant les sculpteurs à aller la voir.
Ce qu’il est important de maintenir, c’est qu’avant le XVIe siècle, toute reproduction d’art en France n’était qu’un essai grossier, barbare. Que l’Italie a eu l’heureuse destinée de nous éclairer, que certains artistes assez adroits, au XVIe siècle, en France, sous l’influence de la cour de François Ier, se sont dégrossis au contact des Italiens et ont produit des œuvres qui ne manquent pas de charme. Mais qu’au XVIIe siècle seul, c’est-à-dire à l’académie qui en est une incarnation, il était réservé de coordonner tous ces éléments et d’en faire un corps de doctrine d’où la lumière, à tout jamais, doit jaillir. Si on laisse entrevoir que la France a possédé un art avant cette inoculation italienne du XVIe siècle, si bien réglée par l’académie, tout cet échafaudage scellé, dressé avec tant de soins et à l’aide de mensonges historiques s’écroule et nous nous retrouvons en face de nous-mêmes, c’est-à-dire de nos œuvres à nous. Nous reconnaissons qu’on a pu faire des chefs-d’œuvre sans école des Beaux-Arts et sans villa Medici. Nous n’avons plus, en fait de protecteurs des arts, que notre talent, notre étude, notre génie propre et notre courage. Il n’y a plus de gouvernement possible dans l’art avec ces éléments seuls, tout est perdu pour les gouvernants comme pour une bonne partie des gouvernés et surtout pour la classe des censeurs, n’ayant jamais tenu ni l’ébauchoir, ni le compas, ni le pinceau, mais vivant de l’art comme le lierre vit du chêne en l’étouffant sous son plantureux feuillage.
Si l’on eût dit à ces artistes, pardon, à ces imagiers du XIIIe siècle : « Bonnes gens, qui faites de la sculpture comme nulle part on n’en fait de votre temps, qui formez l’école mère où l’on vient étudier, qui envoyez des artistes partout, qui pratiquez votre art avec la foi en vos œuvres et une parfaite connaissance des moyens matériels, qui couvrez notre pays d’un monde de statues égal, au moins, au monde de statues des villes grecques ; il arrivera un moment en France, à Paris, là où vous placez le centre de vos écoles, où des hommes, Français comme vous, nieront votre mérite, — cela vous importe peu, — mais essayeront de faire croire que vous n’avez pas existé, que vos œuvres ne sont pas de vous, qu’elles sont dues à un hasard protecteur, et donneront, comme preuve, que vous n’avez pas signé vos statues… » les bonnes gens n’auraient pas ajouté foi à la prédiction. Cependant le prophète eût bien prophétisé.
Nous ne demanderions pas mieux ici que de nous occuper seulement de nos arts anciens ; mais il est bien difficile d’éviter les parallèles, les comparaisons, si l’on prétend être intelligible. La statuaire est un art qui possède plus qu’aucun autre le privilège de l’unité. Elle n’est point comme l’architecture forcée de se soumettre aux besoins du moment, comme la peinture dont les ressources sont tellement variées, infinies, qu’entre une fresque des catacombes et un tableau de l’école hollandaise il y a mille routes, mille sentiers, mille expressions diverses et mille manières différentes de les employer. Faire l’histoire de la statuaire d’une époque, c’est entrer forcément dans toutes les écoles qui ont marqué. Qu’on veuille donc bien nous pardonner ces excursions répétées soit dans l’antiquité, soit chez nos statuaires modernes. Pourrions-nous faire saisir la qualité que nous appelons dramatique, dans la statuaire du moyen âge, sans chercher jusqu’à quel point les anciens l’ont admise et ce que nous en avons fait aujourd’hui ?
Il est nécessaire d’abord d’expliquer ce que nous considérons comme l’élément dramatique dans la statuaire. C’est le moyen d’imprimer dans l’esprit du spectateur, non pas seulement la représentation matérielle d’un personnage, d’un mythe, à un acte, d’une scène, mais tout un ordre d’idées qui se rattachent à cette représentation. Ainsi une statue parfaitement calme dans son geste, dans l’expression même de ses traits, peut posséder des qualités dramatiques et une scène violente n’en posséder aucune. Telle statue antique, comme l’Agrippine du Musée de Naples, par exemple (admettant même qu’on ne sût pas quel personnage elle représente), est éminemment dramatique, en ce sens que dans sa pose affaissée, dans l’ensemble profondément triste et pensif de la figure, on devine tout une histoire funeste, tandis que le groupe de Laocoon est bien loin d’émouvoir l’esprit et de développer un drame. Ce sont des modèles, et les serpents ne sont-ils qu’un prétexte pour obtenir des effets de pose et de muscles. Nous choisissons exprès ces deux exemples dans une période de la statuaire où l’on cherchait précisément cette qualité dramatique, et où on ne l’obtenait que quand on ne la cherchait pas, c’est-à-dire dans quelques portraits. Bien que dans la statuaire la beauté de l’exécution soit plus nécessaire que dans tout autre art, cependant l’élément dramatique n’est pas essentiellement dépendant de cette exécution. Tel bas-relief des métopes de Sélinonte, quoique d’une exécution primitive, roide, telle sculpture du XIIe siècle qui présente les mêmes imperfections, sont profondément empreints de l’idée dramatique, en ce que ces sculptures transportent l’esprit du spectateur bien au delà du champ restreint rempli par l’artiste. Il est à remarquer d’ailleurs que la qualité dramatique dans la statuaire semble s’affaiblir à mesure que la perfection d’exécution matérielle se développe. Dans les monuments égyptiens de la haute antiquité, l’impression dramatique est souvent d’autant plus profonde que l’exécution est plus rude[22].
Dans les arts du dessin et dans la sculpture particulièrement, l’impression dramatique ne se communique au spectateur que si elle émane d’une idée simple et que si cette idée se traduit, non par l’apparence matérielle du fait, mais par une sorte de traduction idéale ou poétique, ou par l’expression d’un sentiment parallèle, dirons-nous. Ainsi, donner à un héros des dimensions supérieures à celles des personnages qu’il combat, c’est rentrer dans la première condition. Donner à ce héros une physionomie impassible pendant une action violente, c’est rentrer dans la seconde. Représenter un personnage colossal lançant du haut de son char, entraîné par des chevaux au galop, des traits sur une foule de petits ennemis renversés et suppliants, c’est une traduction idéale ou poétique d’un fait ; donner aux traits de ce personnage une expression impassible, de telle sorte qu’il semble ne jeter sur ces vaincus qu’un regard vague, exempt de passion ou de colère, c’est graver dans l’esprit du spectateur une impression de grandeur morale qui produit instinctivement l’effet voulu.
Nous ne possédons malheureusement qu’un très-petit nombre de grandes compositions de la statuaire grecque et il serait difficile de suivre la filiation du dramatique dans cet art. La composition des frontons du temple d’Égine obtenue au moyen de statues représentant, dans diverses poses, un fait matériel, n’a rien de dramatique. Mais cependant le sentiment du dramatique est profondément gravé dans l’art grec dès une assez haute antiquité, si l’on en juge par certains fragments du temple de Sélinonte déjà indiqués, et par les peintures des vases. Le sentiment dramatique (la vérité du geste mise à part) est très-développé dans la statuaire du Parthénon et du temple de Thésée, mais développé dans le sens purement matériel. C’est beaucoup d’émouvoir par la beauté extérieure, et c’est peut-être ce qu’avant tout doit chercher le statuaire, mais ce n’est pas tout, croyons-nous. Il est d’autres cordes que l’art peut faire vibrer et la difficulté est de réunir dans un même objet et la beauté plastique qui saisit l’esprit par les yeux et ce reflet d’une pensée qui transporte l’esprit au delà de la représentation matérielle. Rarement ces deux résultats sont atteints dans l’antiquité ; plus rarement encore dans l’art du moyen âge. Le sens dramatique, si profond souvent dans la statuaire du moyen âge, semble gêner le développement du beau plastique et le statuaire, tout pénétré de son idée, l’exprime sans songer à la beauté de la forme. Il n’en faut pas moins distinguer ces qualités et en tenir compte.
Quelques bas-reliefs de la fin du XIIe siècle de l’école de l’Île-de-France sont très-fortement empreints du sentiment dramatique. Nous citerons entre autres celui qui sur le tympan de la porte centrale de la cathédrale de Senlis représente la mort de la Vierge, et là l’exécution est belle. Dans cette scène, à laquelle assistent des anges, il y a une pensée rendue avec une grandeur magistrale. L’événement émeut les esprits célestes plus peut-être que les apôtres, et dans cette émotion des anges, il y a comme un air de triomphe qui remue le cœur, en enlevant à cette scène toute apparence d’une mort vulgaire. Ce n’est plus la mère du Christ s’éteignant au milieu des apôtres qui expriment leur douleur, c’est une âme dégagée des liens terrestres et dont la venue prochaine réjouit le ciel. L’idée, dans des sujets semblables, de placer le Christ parmi les apôtres, recevant dans ses bras, sous la figure d’un enfant, l’âme de sa mère, est déjà l’expression très-dramatique d’un sentiment élevé, touchant, et cette idée a souvent été rendue avec bonheur par les artistes du commencement du XIIIe siècle. L’école rhénane manifeste aussi des tendances dramatiques dès le XIIe siècle, mais avec une certaine recherche qui fait pressentir les défauts de cette école inclinant vers le maniéré.
La clôture du chœur oriental de la cathédrale de Bamberg représente, sous une arcature, des apôtres groupés deux par deux qui accusent bien les tendances de cette école rhénane si intéressante à étudier. La figure 19 donne l’un de ces groupes.

Il ne faudrait pas croire cependant que dans leurs œuvres l’exécution matérielle ne tînt pas une grande place. Il ne s’agit pas ici de cette perfection mécanique qui consiste à tailler et ciseler adroitement la pierre, le marbre ou le bois ; ils ont prouvé que, sous ce rapport, ils ne le cédaient à aucune école, y compris celles de l’antiquité, mais il s’agit de cette exécution si rarement comprise de nos jours, et qui tient à l’objet, à sa place, à sa destination. Les sculpteurs du moyen âge ont composé de très-petits bas-reliefs et des colosses. Si nous nous reportons à la belle antiquité grecque, nous observerons que les infiniment petits en sculpture sont traités comme les œuvres d’une dimension extra-naturelle. Les procédés admis pour le modelé d’une figure d’un centimètre ou deux de hauteur sur une pierre intaillée grecque, sont les mêmes que ceux appliqués à un colosse. En effet, pour qu’un colosse paraisse grand, il ne suffit pas de lui donner une dimension extra-naturelle ; il faut sacrifier quantité de détails, exagérer les masses, faire ressortir certaines parties. Il en est de même si l’on cherche l’infiniment petit. L’échelle alors vous oblige à sacrifier les détails, à faire valoir les masses principales. Aussi les pierres gravées grecques donnent-elles l’idée d’une grande chose ; et si l’on voulait faire un colosse avec une de ces figures de 2 centimètres de hauteur, il n’y aurait qu’à la grandir en observant exactement les procédés de l’artiste. Les Égyptiens dans la haute antiquité, avant les Ptolémées, ont mieux qu’aucun peuple compris cette loi ; leurs colosses, dont ils ne sont point avares, sont traités en raison de la dimension ; c’est-à-dire que plus ils sont grands et plus les détails sont sacrifiés, plus les points saillants de la forme générale sont sentis, prononcés. Aussi les colosses égyptiens paraissent-ils plus grands encore qu’ils ne le sont réellement, tandis que les grandes statues que nous faisons aujourd’hui ne donnent guère l’idée que de la dimension naturelle.
Les artistes de la première moitié du XIIIe siècle ont sculpté quantité de colosses et en les sculptant ils ont observé cette loi si bien pratiquée dans l’antiquité, d’obtenir une exécution d’autant plus simple que l’objet est plus grand et d’insister sur certaines parties qu’il s’agit de faire valoir.
Voyons, par exemple, comme sont traitées les statues colossales de la galerie des rois de la cathédrale d’Amiens. La plupart de ces statues sont assez médiocres, mais toutes produisent leur effet de grandeur par la manière dont elles sont traitées ; quelques-unes sont très-bonnes. Les draperies sont d’une simplicité extrême, les détails sacrifiés, mais les mouvements nettement accusés, accusés même souvent à l’aide d’outrages faits à la forme réelle. D’ailleurs tout, dans l’exécution, est traité en vue de la place occupée par ces statues qui sont posées à 30 mètres du sol. Prenons une tête de l’un de ces colosses (fig 21) ;

on observera comme les traits sont coupés en vue de la hauteur à laquelle sont placées ces statues. L’œil se détache profondément de la racine du nez comme dans certains colosses de la haute Égypte. Il est incliné vers le sol. Le nez est taillé hardiment avec exagération des saillies à la racine. La liaison du front avec le sourcil est vive ; la bouche est coupée nettement ; les cheveux traités par grandes masses bien détachées ; les joues aplaties sous les pommettes, afin de laisser la lumière accuser vivement les points saillants du visage. Les mêmes procédés sont employés pour les draperies, pour les nus ; sacrifice des détails, simplicité de moyens, exagération des parties qui peuvent faire ressortir l’ossature de la figure. Très-fréquemment voit-on dans les monuments de la première moitié du XIIIe siècle des statues qui produisent un effet excellent à leur place et qui moulées, posées dans un musée, sont défectueuses. Le contraire a trop souvent lieu aujourd’hui ; des statues satisfaisantes dans l’atelier de l’artiste sont défectueuses une fois mises en place. La question se borne à savoir s’il convient de faire de la statuaire pour la satisfaction de l’artiste et de quelques amis qui la voient dans l’atelier, ou s’il est préférable dans l’exécution de songer à cette place définitive. Les sculpteurs du moyen âge n’avaient point d’expositions annuelles où ils envoyaient leurs œuvres pour les faire voir isolées, sous un aspect qui n’est pas l’aspect définitif. Ils pensaient avant tout à la destination des figures qu’ils sculptaient, à l’effet qu’elles devaient produire en raison de cette destination. Ils se permettaient ainsi des irrégularités ou des exagérations que l’effet en place justifie pleinement, mais qui les feraient condamner dans une salle d’exposition aujourd’hui.
À notre avis, l’exposition d’une statue, en dehors de la place à laquelle on la destine, est un piège pour l’artiste. Ou il travaille en vue de cette exhibition isolée, partielle, et alors il ne tient pas compte de l’emplacement, du milieu définitif ; ou il satisfait à ces dernières conditions et il ne saurait contenter les amateurs qui vont voir sa statue comme on regarde un meuble ou un ustensile dont la place n’est point marquée. On peut produire une œuvre de statuaire charmante, possédant en elle-même sa valeur, et plusieurs de nos statuaires modernes ont prouvé que cela était possible encore aujourd’hui. Mais s’il s’agit de la statuaire appliquée à l’architecture, il est des conditions particulières auxquelles on doit satisfaire, conditions d’effet, d’emplacement, souvent opposées à celles qui peuvent pleinement satisfaire dans l’atelier. Or, les sculpteurs du moyen âge avaient acquis une grande expérience de ces effets, en raison de la place et de l’entourage, de la hauteur, de la dimension vraie ou relative. On pourrait même soutenir que sous ce rapport les statuaires du moyen âge sont allés bien au delà des Grecs, soit parce qu’ils plaçaient dans les édifices un nombre beaucoup plus considérable de figures, soit parce que ces édifices étant de dimensions incomparablement plus grandes, ils devaient tenir compte de ces dimensions lorsqu’il s’agissait de produire certains effets que l’éloignement, la perspective tendaient à détruire.
Il est évident, par exemple, que les Parques du fronton du Parthénon, ces incomparables statues, ont été faites bien plutôt pour être vues dans un atelier que sur le larmier du temple de Minerve. À cette place, la plupart des détails n’étaient vues que des hirondelles, et les figures assises devaient presque entièrement être masquées par la saillie de la corniche. Dans le même monument, les bas-reliefs de la frise sous le portique, éclairés de reflet, pouvaient difficilement être appréciés, bien que le sculpteur, par la manière dont sont traités les figures, ait évidemment pensé à leur éclairage. Mais comme dimension, qu’est-ce que le Parthénon comparé à la cathédrale de Reims ? C’est dans ce dernier édifice où l’on peut constater plus particulièrement la science expérimentale des statuaires du moyen âge. Les statues qui garnissent les grands pinacles des contreforts et qui ont plus de 4 mètres de hauteur produisent un effet complétement satisfaisant, vues d’en bas ; si nous les examinons de près, toutes ont les bras trop courts, le col trop long, les épaules basses, les jambes courtes, le sommet de la tête développé en largeur et en hauteur. Cependant la pratique la plus ordinaire de la perspective fait reconnaître que ces défauts sont calculés pour obtenir un effet satisfaisant du point où l’on peut voir ces statues. On ne saurait donner géométriquement les règles que dans des cas pareils les statuaires doivent observer ; c’est là une affaire d’expérience et de tact, car ces règles se modifient suivant, par exemple, que les statues sont encadrées, qu’elles se détachent sur des fonds clairs ou obscurs, sur un nu ou sur le ciel, qu’elles sont isolées ou accompagnées d’autres figures. Ce n’est donc pas à nous à dédaigner les œuvres de ces maîtres qui avaient su acquérir une si parfaite connaissance des effets de la statuaire monumentale et qui ont tant produit dans des genres si divers.
Il est admis que les statuaires du moyen âge n’ont su faire que des figures allongées, sortes de gaines drapées en tuyaux d’orgues, corps grêles sans vie et sans mouvement, terminés par des têtes à l’expression ascétique et maladive.
Un critique, un jour, après avoir vu les longues figures du XIIe siècle de Notre-Dame de Chartres, a fait sur ce thème quelques phrases et la foule de les répéter, car observons qu’en fait d’appréciation des œuvres d’art, rien n’est plus commode que ces opinions toutes faites qui dispensent de s’enquérir par soi-même, cette enquête ne dut-elle demander qu’une heure. Nous avons donné déjà, dans cet article, un assez grand nombre d’exemples de statues qui ne ressemblent nullement à des gaines et de têtes qui n’ont rien moins qu’une expression extatique ou maladive. Que les artistes du moyen âge aient cherché à faire prédominer l’expression, le sentiment moral sur la forme plastique, ce n’est pas douteux et c’est en grande partie ce qui constitue leur originalité, mais ce sentiment moral, empreint sur les physionomies, dans les gestes, est plutôt énergique que maladif, plutôt indépendant et ferme qu’humble ou contrit. On ne saurait nier, par exemple, que les statues qui décorent la façade de la maison des Musiciens, à Reims[24], statues forte nature, n’aient toute la vie que comporte un pareil sujet.

Cependant, comme il arrive toujours au sein d’une école de statuaire déjà développée, on inclinait à admettre un canon du beau. Ce canon qui était loin d’avoir la valeur de ceux admis par les artistes de la belle antiquité grecque, avait un mérite, il nous appartenait ; il était établi sur l’observation des types français, il possédait son originalité native. Aussi est-il aisé de reconnaître, à première vue, une statue appartenant à l’école de l’Île-de-France du milieu du XIIIe siècle entre mille autres. Ces types ont un charme ; leur exacte observation, après tout, donne des résultats supérieurs à ceux que peut produire l’imitation de seconde main d’une nature physique qui nous est devenue étrangère. Nous l’avons dit déjà ; le beau n’est pas heureusement limité dans une certaine forme. La nature a su répartir le beau partout ; c’est à l’artiste à le distinguer du vulgaire, à l’extraire par une sorte d’opération intellectuelle d’affinage, du milieu d’éléments grossiers, abâtardis où il existe à l’état parcellaire. Les statuaires grecs n’ont pas fait autre chose, mais de ce que la Vénus de Milo est belle, on ne saurait admettre que toutes les femmes qui ne ressemblent pas à la Vénus de Milo sont laides. Le beau, loin d’être rivé à une certaine forme, se traduit dans toute créature par une harmonie, une pondération, qui ne dépendent pas essentiellement de la forme. Il nous est arrivé à tous, devant un geste vrai, une certaine liaison parfaite entre le sentiment de la personne et son apparence extérieure, d’être vivement touchés. C’est à rendre cette harmonie entre l’intelligence et son enveloppe que la belle école du moyen âge s’est particulièrement attachée. Dans les traits du visage, comme dans les formes et les mouvements du corps, on retrouve l’individu moral. Chaque statue possède son caractère personnel, qui reste gravé dans la mémoire comme le souvenir d’un être vivant que l’on a connu. Il est entendu que nous ne parlons ici que des œuvres ayant une valeur au point de vue de l’art, œuvres qui d’ailleurs sont nombreuses. Une grande partie des statues des porches de Notre-Dame de Chartres, des portails des cathédrales d’Amiens et de Reims possèdent ces qualités individuelles, et c’est ce qui explique pourquoi ces statues produisent sur la foule une si vive impression, si bien qu’elle les nomme, les connaît et attache à chacune d’elles une idée, souvent même une légende. Telle est, entre autres, la belle statue de la Vierge de la porte Nord du transsept de Notre-Dame de Paris. Comme attitude, comme composition, agencement de draperies, cette figure est un modèle de noblesse vraie ; comme expression, la tête dévoile une intelligence ferme et sûre, une fierté délicate, des qualités de grandeur morale qui rejettent dans les bas-fonds de l’art cette statuaire prétendue religieuse dont on remplit aujourd’hui nos églises ; pauvres figures aux gestes de convention, à l’expression d’une doucereuse fadeur, cherchant le joli pour plaire à une petite église de boudoir.
La statuaire qui mérite le nom d’art s’est retirée de nos temples, par suite des tendances du clergé français depuis le XVIIe siècle. Il ne s’agissait plus dès lors de tremper l’esprit des fidèles dans ces hardiesses, quelquefois sauvages de l’art, dans cette verdeur juvénile d’œuvres empreintes de passions ou de sentiments robustes, mais de l’assouplir au contraire par un régime doux et facile à suivre.

Cette Vierge du portail Nord de Notre-Dame de Paris, dont nous donnons la tête (fig. 24), est une femme de bonne maison, une noble dame. L’intelligence, l’énergie tempérée par la finesse des traits, ressortent sur cette figure délicatement modelée. À coup sûr, rien dans cette tête ne rappelle la statuaire grecque comme type. C’est une physionomie toute française, qui respire la franchise, la grâce audacieuse et la netteté de jugement. L’auteur inconnu de cette statue voyait juste et bien, savait tirer parti de ce qu’il voyait et cherchait son idéal dans ce qui l’entourait. D’ailleurs, habile praticien, — car rien ne surpasse l’exécution des bonnes figures de cette époque — son ciseau docile savait atteindre les délicatesses du modelé le plus savant.
Si impuissante que soit une gravure sur bois à rendre ces délicatesses, nous espérons néanmoins que cette copie très-imparfaite engagera les statuaires à jeter en passant les yeux sur l’original.
Nous trouvons toutes ces qualités dans les bas-reliefs du portail Sud de Notre-Dame de Paris qui représentent la légende de saint Étienne et qui datent de la même époque (1257). La composition et l’exécution de ces bas-reliefs les placent parmi les meilleures œuvres du milieu du XIIIe siècle.
Il faut citer encore parmi les bons ouvrages de statuaire du milieu du XIIIe siècle, quelques figures tombales des églises abbatiales de Saint-Denis[25], de Royaumont ; les apôtres de la Sainte-Chapelle du Palais à Paris ; certaines statues du portail occidental de Notre-Dame de Reims et des porches de Notre-Dame de Chartres[26]. Il résulte toutefois de cet examen qu’alors, sous le règne de saint Louis, la meilleure école de statuaire était celle de l’Île-de-France. On ne trouve pas une figure médiocre dans la statuaire de Notre-Dame de Paris, tandis qu’à Amiens, à Chartres, à Reims, au milieu d’œuvres hors ligne, on en rencontre qui sont très-inférieures, soit comme style, soit comme exécution. À Reims particulièrement, les ébrasements des portes du nord sont décorés de statues du plus mauvais travail ; sauf deux ou trois qui sont bonnes. L’école de l’Île-de-France tenait la tête alors et la ville de Paris était la capitale des travaux intellectuels et d’art, comme elle était déjà la capitale politique. Ce n’est pas à dire que les autres écoles n’eussent pas leur valeur ; l’école champenoise, l’école picarde et l’école bourguignonne fournissaient alors une belle carrière, possédaient leur caractère particulier. L’école rhénane qui avait jeté déjà au XIIe siècle un vif éclat, se distinguait entre les précédentes par une tendance prononcée vers la manière, l’exagération, la recherche. Moins pénétré du beau idéal, elle inclinait vers un réalisme souvent près de la laideur. Cette disposition de l’école rhénane a eu sur les opinions que l’on se fait de la statuaire du moyen âge une fâcheuse influence. Comme nous sommes naturellement portés en France à considérer les œuvres d’art en raison directe de la distance où elles se trouvent de notre centre, beaucoup de personnes qui n’avaient jamais jeté les yeux sur la statuaire des cathédrales de Paris, d’Amiens ou de Chartres, ne voulant pas que leurs frais de déplacement fussent perdus, ont regardé avec quelque attention la statuaire de Strasbourg ou de Fribourg. N’ayant donc regardé que celle-là, elles en ont conclu que la statuaire du moyen âge inclinait vers la recherche du laid, ou tout au moins était maniérée, maigre, dépourvue de grandeur. Ce jugement est cependant téméraire, même sur les bords du Rhin. Il est quelques statues de la cathédrale de Strasbourg qui sont des œuvres capitales ; les deux statues de l’Église et de la Synagogue placées à la porte Sud et qui sont du commencement du XIIIe siècle sont remarquablement belles. Plusieurs des statues des vierges sages et folles de la porte droite de la façade occidentale, datant de la fin du XIIIe siècle, sont des chefs-d’œuvre. On en pourra juger par l’exemple que nous donnons ici (fig. 25).

Que de fois des critiques, peu familiers avec la pratique de l’art, ont établi des jugements, voire des théories ou des systèmes, sur des œuvres de sculpture qui ne sont que de faibles copies ou des pastiches maladroits. Il en est de la statuaire du moyen âge comme de la statuaire grecque ; il est bien des ouvrages mal restaurés ou refaits, bien des copies qu’il ne faut pas confondre avec les œuvres originales. Que d’amateurs s’extasient sur de faux antiques, les supposant de bon aloi ! Combien d’autres mettent sur le compte de l’art du moyen âge les défauts grossiers de mauvais pastiches et jugent ainsi toute une école, d’après un exemple dû à quelque ciseau maladroit, à quelque pauvre praticien ignorant. Il est une qualité de cette statuaire du moyen âge du bon temps qui se fait toujours reconnaître, même dans les œuvres de second ordre, c’est la fermeté du modelé, la simplicité des moyens, l’observation fine du geste, de la physionomie, du jet des draperies. Cette qualité ne s’acquiert qu’après de longues études, aussi ne la trouve-t-on pas dans les pastiches, surtout lorsque ceux-ci ont été faits par des artistes qui, prétendant ne trouver dans cet art qu’une naïveté grossière, se faisaient plus maladroits qu’ils ne l’étaient réellement, afin, supposaient-ils, de se rapprocher de la simplicité de cet art. Simplicité d’aspect seulement, car lorsqu’on étudie les œuvres de la statuaire du moyen âge on reconnaît bientôt que ces imagiers ne sont rien moins que naïfs. On n’atteint la simplicité dans tous les arts et particulièrement dans la sculpture, qu’après une longue pratique, une longue expérience et une observation scrupuleuse de principes définis. N’oublions pas que dans les choses de la vie, la simplicité est la marque d’un goût sûr, d’un esprit droit et cultivé ; il en est de même dans la pratique des arts et l’on ne nous persuadera jamais que les artistes qui ont conçu et exécuté les bonnes statues de notre XIIIe siècle, remarquables par la distinction et la simplicité de leur port, de leur physionomie, de leur ajustement, fussent de pauvres diables, ignorants, superstitieux, grossiers. Tant vaut l’homme, tant vaut l’œuvre d’art qu’il met au jour ; et jamais d’un esprit borné, d’un caractère vulgaire, il ne sortira qu’une œuvre plate. Pour faire des artistes, faites des hommes d’abord. Que les artistes français du moyen âge aient très-rarement signé leurs œuvres, cela ne prouve pas qu’ils fussent de pauvres machines obéissantes ; cela prouve seulement qu’ils pensaient, non sans quelque fondement, qu’un nom, au bas d’une statue, n’ajouterait rien à sa valeur réelle aux yeux des gens de goût ; ceux-ci n’ayant pas besoin d’un certificat ou d’un titre pour juger une œuvre. En cela ils étaient simples, comme les gens qui comptent plus sur leur bonne mine et leur façon de se présenter pour être bien reçus partout, que sur les décorations dont ils pourraient orner leur boutonnière. Nous avons changé tout cela, et aujourd’hui, à l’imitation des Italiens, de tous temps grands tambourineurs de réputation, c’est l’attache du nom de l’artiste auquel, à tort ou à raison on a fait une célébrité, qui donne de la valeur à l’œuvre. Mais qu’est-ce que l’art a gagné à cela ?
Quelques-uns veulent voir dans cette rareté de noms d’artistes sur notre statuaire une marque d’humilité chrétienne ; mais les œuvres d’art sur lesquelles on trouve le plus de noms sont des sculptures romanes, dues à des artistes moines, ou sur d’assez médiocres ouvrages. Comment donc les meilleurs artistes et les artistes laïques eussent-ils pu montrer plus d’humilité chrétienne que des moines et de pauvres imagiers de petites villes ? Non, ces consciencieux artistes du XIIIe siècle voyaient dans l’œuvre d’art, l’art, et non point leur personne, ou plutôt leur personnalité passait dans leurs ouvrages. Ils s’animaient peut-être en songeant que la postérité, pendant des siècles, admireraient leurs statues, et n’avaient point la vanité de croire qu’elle se soucierait de savoir si ceux qui les avaient sculptées s’appelaient Jacques ou Guillaume.
D’ailleurs que voulaient-ils ? Concourir à un ensemble ; ni le sculpteur, ni le peintre, ni le verrier, ne se séparaient de l’édifice. Ils n’étaient pas gens à aller regarder leur statue, ou leur vitrail, ou leur peinture, indépendamment du monument auquel s’attachaient ces ouvrages. Ils se considéraient comme les parties d’un tout, sorte de chœur dans lequel chacun s’évertuait non pas à crier plus fort ou sur un autre ton que son voisin, mais à produire un ensemble harmonieux et complet. Mais nous expliquerons plus loin les motifs de cette absence de noms sur les œuvres d’art du XIIIe siècle.
Nous n’avons guère donné jusqu’à présent que des exemples isolés tirés de ces grands ensembles, afin de faire apprécier leur valeur absolue. Il est temps de montrer comme la statuaire sait se réunir à sa sœur, l’architecture, dans ces édifices du moyen âge. C’est au XIIIe siècle que cette réunion est la plus intime, et ce n’est pas un des moindres mérites de l’art de cette époque.
Dans les monuments de l’antiquité grecque qui conservent les traces de la statuaire qui les décorait, celle-ci ne se lie pas absolument avec l’architecture. L’architecture l’encadre, lui laisse certaines places, mais ne se mêle point avec elle. Ce sont des métopes, des frises d’entablements, des tympans de frontons, des couronnements ou amortissements, pris entre des moulures formant autour d’eux comme une sorte de sertissure. L’architecture romaine, plus somptueuse, laisse en outre, dans ses édifices, des niches pour des statues, de larges espaces pour des bas-reliefs, comme dans les arcs de triomphe par exemple. Mais à la rigueur, ces sculptures peuvent disparaître sans que l’aspect général du monument perde ses lignes.
L’alliance entre les deux arts est bien plus intime pendant le moyen âge. Il ne serait pas possible, par exemple, d’enlever des porches de la cathédrale de Chartres, la statuaire, sans supprimer du même coup l’architecture. Dans des portails comme ceux de Paris, d’Amiens, de Reims, il serait bien difficile de savoir où finit l’œuvre de l’architecte et où commence celle du statuaire et du sculpteur d’ornements. Ce principe se retrouve même dans les détails. Ainsi, compose-t-on un riche soubassement sous des rangées de statues d’un portail (lesquelles sont elles-mêmes adhérentes aux colonnes, et forment, pour ainsi dire, corps avec elles) ; ce soubassement sera comme une brillante tapisserie ou les compartiments géométriques de l’architecture, où la sculpture d’ornement et la statuaire seront liés ensemble comme un tissu sorti de la même main. C’est ainsi que sont composés les soubassements du grand portail de Notre-Dame d’Amiens, tels sont ceux des ébrasements des portes de l’ancienne cathédrale d’Auxerre qui datent de la fin du XIIIe siècle, et beaucoup d’autres encore qu’il serait trop long d’énumérer. Entre ces soubassements, ceux d’Auxerre sont des plus remarquables. Les sujets sculptés sont pris dans l’Ancien et le Nouveau Testament. On y voit la Création, l’histoire de Joseph, la parabole de l’Enfant prodigue. Ce sont des bas-reliefs ayant peu de saillie, très-habilement agencés dans un réseau géométrique de moulures et d’ornements. L’aspect général, par le peu de relief, est solide, brillant, vivement senti ; les sujets sont traités avec une verve sans égale.
La figure 26 est un fragment de soubassement tapisserie, représentant l’histoire de l’Enfant prodigue. Dans les compartiments en quatre lobes A, on voit l’Enfant prodigue au milieu de femmes, se baignant et banquetant.
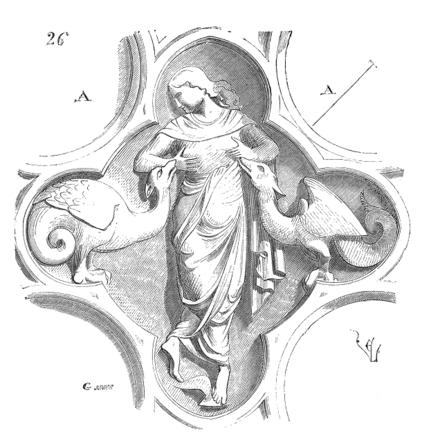
Le médaillon 26 est la moralité de ces passe-temps profanes. Une femme allaite deux dragons. Cette figure n’a guère que 40 centimètres de hauteur, d’un style charmant, d’une exécution excellente ; elle a été passablement mutilée, comme tous ces bas-reliefs de soubassements, par les enfants, que jusqu’à ce jour on laisse faire avec une parfaite indifférence, bien qu’il y ait des lois punissant la mutilation des édifices publics[27].
Mais, tout à l’heure, nous parlions des porches de la cathédrale de Chartres comme réunissant d’une manière plus intime l’architecture et la sculpture. En effet, les piles qui portent les voussures de ces porches appartiennent plutôt à la statuaire qu’aux formes architectoniques. Le porche du nord présente un des exemples les plus complets de cette alliance intime des deux arts. Il suffit pour le reconnaître de feuilleter la monographie de cette cathédrale publiée par Lassus et les planches de l’ouvrage de M. Gailhabaud[28]. Les supports des statues, celles-ci et les colonnes qui leur servent de dossier, forment un tout dont la silhouette est des plus heureuses, et dont les détails sont du meilleur style. L’originalité de ces compositions, qui datent de 1230 à 1240, est d’autant plus remarquable, qu’à cette époque déjà les maîtres des œuvres, séduits par les combinaisons géométriques, tendaient à restreindre le champ du statuaire.
Dès les premières années du XIIIe siècle, il s’était fait dans l’art de la sculpture d’ornement une révolution qui tendait d’ailleurs à faciliter l’alliance de la statuaire avec l’architecture. La sculpture d’ornement servait alors de lien, de transition naturelle entre les formes géométriques et celles de la figure humaine, en ce que déjà elle recourait à la flore des bois et des champs pour trouver ses motifs, au lieu de s’en tenir aux traditions des arts romains et byzantins. Il nous faut ici revenir un peu en arrière afin de faire connaître par quelles phases les différentes écoles françaises avaient fait passer la sculpture d’ornement, tout en s’occupant de développer la statuaire. Jusqu’au XIe siècle, sauf de rares exceptions, telles que celle présentée figure 11, la sculpture d’ornement reproduisait d’une manière barbare et maladroite les restes de la sculpture gallo-romaine. Nous n’avons fait qu’indiquer les influences dues aux Visigoths, aux Burgondes, aux Scandinaves (Normands), parce qu’il est difficile d’apprécier l’étendue et l’importance de ces influences faute de monuments assez nombreux. Mais, au moment des premières croisades, la sculpture d’ornement se développe, nous l’avons dit déjà, avec une abondance telle que bientôt les modèles orientaux qui avaient servi de point de départ sont dépassés quant à la variété et à l’exécution. Ces modèles, les croisés occidentaux les avaient trouvés dans les villes de la Syrie centrale et à Constantinople. Mais cette sculpture gréco-romaine est plate, un peu maigre, découpée, et sa composition pèche par la monotonie. C’est un art de convention qui n’empruntait que bien peu à la nature. Le bel ouvrage sur les églises de Constantinople, par M. Salzenberg[29] ; le Recueil d’architecture civile et religieuse de la Syrie centrale, publié par M. le comte Melchior de Vogüé avec les dessins de M. Duthoit[30], nous font assez connaître que déjà, au Ve siècle, il existait dans toute cette partie de l’Orient, visitée plus tard par les croisés, une quantité de monuments dans lesquels la sculpture d’ornement prend un caractère particulier, évidemment issu de l’antique art grec, mais profondément modifié par les influences romaines et asiatiques. Aussi dans son Avant-propos, M. le comte Melchior de Vogüé, reconnaissant combien notre art du XIIe siècle se rapproche de cet art gréco-romain de Syrie, termine-t-il par ce passage : « Tandis qu’en Occident le sentiment de l’art s’éteignait peu à peu, sous la rude étreinte des barbares, en Orient, en Syrie du moins, il existait une école intelligente qui maintenait les bonnes traditions et les rajeunissait par d’heureuses innovations. Dans quelles limites s’exerça l’influence de cette école ? Dans quelle mesure ses enseignements ou ses exemples contribuèrent-ils à la renaissance occidentale du XIe siècle ? Quelle part enfin l’Orient byzantin eut-il dans la formation de notre art français du moyen âge ?… »
M. le comte Melchior de Vogüé nous fournit une partie des pièces nécessaires à la solution de ces questions, en ce qui touche à l’architecture et à la sculpture. Celle-ci ne se compose que d’une ornementation toujours adroitement composée, mais sèche et plate ; la figure humaine et les animaux font absolument défaut, sauf deux ou trois exemples, un agneau, des paons, très-naïvement traités. Ce sont presque toujours des feuilles dentelées, découpées vivement, cannelées dans les pleins de manière à obtenir une suite d’ombres et de clairs sans modelé. Du IVe au VIe siècle, ce genre d’ornementation varie à peine. À cette ornementation empruntée à une flore toute de convention se mêlent parfois — surtout dans les édifices les plus éloignés de la chute du paganisme — des combinaisons géométriques, des entrelacs obtenus par des pénétrations de cercles ou de lignes droites suivant certains angles. En examinant ces jolis monuments, si habilement entendus comme structure, conçus si sagement en vue du besoin et de l’emploi des matériaux, toujours d’une heureuse proportion, qui présentent un si grand nombre de dispositions originales, on est surpris de trouver dans l’ornementation cette sécheresse, ce défaut d’imagination, cette pauvreté de ressources. Les églises, couvents, villas, bains, maisons, qui témoignent d’un état de civilisation très-parfait, présentent à peu près la même ornementation pendant l’espace de trois siècles, et cette ornementation ne s’élève pas au-dessus du métier. Elle n’est qu’un poncif tracé sur la pierre, enfoncé de quelques millimètres dans les intervalles des feuilles ou brindilles, des fruits ou rosettes, et uniformément modelés à l’aide de ce coup de ciseau en creux vif. D’ailleurs, les anciennes sculptures de l’église de Sainte-Sophie présentent le même faire, avec un peu plus de recherche dans les détails. Les artistes occidentaux, à dater des premières croisades, s’inspirent évidemment de cet art. Nous avons fait ressortir à l’article Profil, comment ils copient les moulures, mais ils ne se bornent pas à cet emprunt : ils prennent aussi des procédés de structure, des dispositions de détails et cette ornementation sèche et découpée. Ces Occidentaux cependant ne sont pas tous pourvus des mêmes goûts, des mêmes aptitudes. Ce sont des Provençaux, des Languedociens, des Poitevins, des Bourguignons, des Normands, des Auvergnats, des Berrichons. En allant à l’école d’art de la Syrie, ils voient ces monuments à travers des traditions fort appauvries, mais assez vivaces encore pour que, revenus chez eux, les traductions auxquelles ils se livrent prennent des caractères différents. Les uns, comme les Provençaux, copient presque littéralement cette ornementation des édifices syriaques et la placent à côté d’ornements gallo-romains ; d’autres, comme les Normands, inclinent à choisir dans ces décorations les combinaisons géométriques : d’autres encore, comme les Berrichons, font un mélange de ces ornements syriaques et de ceux que les Gallo-Romains ont laissé sur le sol. Les Poitevins, en les imitant, leur donnent une ampleur particulière. Mais toutes ces écoles, sans exception, mêlent bientôt la figure à ces imitations d’ornements byzantins. Cela tient au génie occidental de cette époque ; et, si grossiers que soient ses premiers essais, ils ne tardent guère à se développer d’une manière tout à fait remarquable. L’Italie, beaucoup plus byzantinisée, n’arrive que plus tard à ces compositions d’ornement, dans lesquelles la figure joue un rôle important.
Voyons donc comment procèdent les principales écoles françaises lorsqu’elles prennent pour point de départ les arts de l’Orient, après les grossiers tâtonnements des Xe et XIe siècles.
C’est en Provence que l’imitation de l’ornementation byzantine, bien que partielle, est d’abord sensible. Il est tel édifice de cette contrée dont les bandeaux, les frises, les chapiteaux mêmes, pourraient figurer sur l’un de ces bâtiments de la Syrie centrale. Pour s’en assurer, il n’y a qu’à consulter l’ouvrage que M. Revoil publie sur l’architecture du midi de la France[31]. Nous en donnons ici même un exemple frappant, figure 27, tiré d’une corniche de la petite église de Sainte-Croix, à Montmajour près Arles.
Tout autre est l’école de Toulouse ; celle-là abandonne franchement, au XIIe siècle, l’imitation de la sculpture d’ornement gallo-romaine ; mais en s’inspirant de l’art byzantin, en lui empruntant ses hardiesses, ses combinaisons géométriques, ses compositions, elle conserve un caractère local, dû très-vraisemblablement aux émigrations qui se répandirent dans le Languedoc à la chute de l’Empire romain. Cette école s’émancipe et produit des ouvrages très-supérieurs à ceux de l’école provençale. Il faut reconnaître qu’indépendamment de son caractère propre, l’école de Toulouse n’est pas en contact direct avec l’Orient ; ce qui l’inspire, ce sont moins les monuments de Syrie ou de Constantinople que la vue d’objets provenant du Levant ; ivoires, bois sculptés, objets d’orfèvrerie, étoffes ; tout lui est bon, tout devient pour elle un motif d’ornement sculpté. Les Byzantins ne représentent, dans leur sculpture monumentale, ni des animaux, ni des figures humaines ; en revanche leurs étoffes en sont amplement remplies ; beaucoup d’ornements de l’école de Toulouse reproduisent, au milieu d’entrelacs de branches, des animaux affrontés, ou se répétant sur une frise comme ils se répètent sur un galon fait au métier. Le musée de Toulouse est rempli de ces bandeaux ressemblant fort à de la passementerie byzantine, d’une finesse d’exécution toute particulière et de ces entrelacs rectilignes ou curvilignes, de ces rinceaux perlés empruntés à des menus objets rapportés d’Orient et aussi au génie local qui, par les émigrations des Visigoths, a bien quelques rapports avec celui des peuplades indo-européennes du Nord.

Les figures 28, 28 bis et 28 ter donnent des exemples de ces ornements où le byzantin se mêle à cet art que nos voisins d’Angleterre appellent saxon et dont nous aurons tout à l’heure l’occasion de parler.



Mais il est nécessaire, avant d’arriver à la grande transformation due aux artistes de la fin du XIIe siècle, de suivre notre revue des diverses écoles au moment où l’influence byzantine se fait sentir à la suite des premières expéditions en Orient. Cette influence est très-puissante en Languedoc, partielle en Provence ; elle prend un caractère particulier au centre des établissements de Cluny. La sculpture d’ornement de l’église de Vézelay n’a plus rien de romain comme celle de la Provence ; elle n’est pas byzantinisée, soit par l’influence des monuments de Syrie, soit par l’imitation d’objets et d’étoffes apportés d’Orient, comme celle du Languedoc ; elle s’inspire évidemment de l’art romano-grec, mais elle éclôt sur un sol si bien préparé que, dès ses premiers essais, elle atteint l’originalité. Nous avons cru voir, à la naissance de la statuaire clunisienne, une transposition de l’art de la peinture grecque ; il nous serait plus difficile d’expliquer comment la sculpture d’ornement byzantine atteint, du premier jet, presque à la hauteur d’un art original dans les grandes abbayes de Cluny. La peinture grecque n’a plus là d’influence, car la sculpture clunisienne du commencement du XIIe siècle ne la rappelle pas. L’ornementation romane du XIe siècle des provinces du centre et de l’est n’a rien préparé pour cette école clunisienne. L’influence byzantine, reconnaissable, semble être comme une graine semée dans une terre vierge, et produisant, par cela même, un végétal d’un aspect nouveau, plus grandiose, mieux développé et surtout d’une beauté de formes inconnue. Malheureusement les premiers essais de cette transformation nous manquent, puisque les parties les plus anciennes de l’église mère de Cluny ont été démolies. Nous ne pouvons la saisir que dans son entier développement, c’est-à-dire de 1095 à 1110, époque de la construction de la nef de l’église de Vézelay. Est-il une composition d’ornements mieux entendue, par exemple, que celle de ce triple chapiteau du trumeau de la porte centrale de cette église[33] ; chapiteau destiné à soutenir deux piédroits et un pilastre décorés de statues, figure 31 (voyez Trumeau ).


Il y avait donc au centre des établissements de Cluny une forte école de statuaire et d’ornementation dès le commencement du XIIe siècle, école qui ne fit que croître jusqu’au XIIIe siècle, ainsi que nous le verrons, école qui se recommandait par l’ampleur de ses œuvres, la variété incroyable de ses compositions, la beauté relative de l’exécution. Le peu d’exemples qu’il nous est possible de donner fait assez voir cependant que cette école clunisienne du XIIe siècle sur les confins de la Bourgogne, n’avait aucun rapport avec celle de Provence et celle du Languedoc à la même époque, bien que toutes trois se fussent inspirées des arts romano-grecs de l’Orient.
Si nous pénétrons dans les provinces de l’ouest, nous reconnaîtrons encore la présence d’une quatrième école d’ornementation dont le caractère est tout local. Là évidemment aussi, l’influence byzantine due aux premières croisades se fait jour sur quelques points, mais cette influence est sans grande importance, au moins jusqu’au milieu du XIIe siècle. Quelques localités de cette partie du territoire français possédaient des monuments gallo-romains en grand nombre, comme Périgueux, entre autres. Là l’ornementation se traîne dans une imitation grossière de l’art antique, et le renouvellement par l’apport byzantin n’est guère sensible. Mais en Saintonge, en Poitou, des influences qui ne sont dues ni aux traditions romaines, ni aux voyages d’outre-mer, apparaissent. Ces influences, nous les croyons, en partie, dues aux rapports forcés que ces contrées auraient eu, dès le Xe siècle, avec ces hordes que l’on désigne sous le nom de Normands, et qui ne cessèrent, pendant près de deux siècles, d’infester les côtes occidentales de la France. Ces Normands étaient certes de terribles gens, grands pillards, brûleurs de villes et de villas, mais il est difficile d’admettre qu’une peuplade qui procède dans son système d’invasion avec cette suite, cette méthode, qui s’établit temporairement dans les îles des fleuves, sur des promontoires, qui sait s’y maintenir, qui possède une marine relativement supérieure, qui déploie une sagacité remarquable dans ses rapports politiques, n’ait pas atteint un certain degré de civilisation, n’ait pas des arts, ou tout au moins des industries. Ces peuplades ont laissé en Islande quelques débris d’art fort curieux ; elles venaient du Danemark, des bords de la mer du Nord, de la Scandinavie, où l’on retrouve encore aujourd’hui des ustensiles d’un grand intérêt, en ce qu’ils ont avec l’ornementation hindoue des rapports frappants d’origine. Or, les manuscrits dits saxons qui existent à Londres et qui datent des Xe, XIe et XIIe siècles, manuscrits fort beaux pour la plupart, présentent un grand nombre de vignettes dont l’ornementation ressemble fort, comme style et composition, à ces fragments de sculpture dont nous parlons. Ces hommes du Nord, ces Saxons, hommes aux longs couteaux, paraissent appartenir à la dernière émigration partie des plateaux situés au nord de l’Inde. Qu’on les nomme Saxons, Normands, Indo-Germains, à tout prendre, ils sortent d’une même souche, de la grande souche aryenne. Les objets qu’ils ont laissés dans le nord de l’Europe, dans les Gaules, en Danemark, et qu’on retrouve en si grand nombre dans leurs sépultures, attestent tous la même forme, la même ornementation, et cette ornementation est, on n’en peut guère douter, d’origine nord-orientale. Or, les manuscrits dits saxons, exécutés avec une rare perfection, nous présentent encore cette ornementation étrange, entrelacement d’animaux qui se mordent, de filets, le tout peint des plus vives et des plus harmonieuses couleurs. Comme exemple, nous donnons ici (fig. 33), une copie de deux fragments de ces vignettes[34].

Dans cette province, comme dans les autres qui composent la France actuelle, l’art de la sculpture ne se réveille qu’à la fin du XIe siècle. Le Poitou, la Saintonge, les provinces de l’ouest sont entraînées dans le mouvement général provoqué par les premières croisades, seulement leurs artistes ont chez eux un art à l’état d’embryon, et ils le développent. Comme la Provence mêle à ses imitations de l’art gréco-romain de Syrie, les traditions gallo-romaines locales, les Poitevins, en apprenant leur métier de sculpteurs à l’école gréco-romaine, utilisent les éléments indo-européens qu’ils ont reçus du Nord, et même, les éléments gallo-romains. De tout cela ils composent des mélanges dans lesquels parfois l’un de ces éléments domine. D’ailleurs, entre les traditions qu’ils avaient pu recevoir du nord de l’Europe et les arts qu’ils recueillaient en Orient, il existe des points de contact, certaines relations d’origines, évidentes. L’alliage entre l’art romano-grec ou le byzantin et ces rudiments d’art introduits au nord et à l’ouest de la France pendant les premiers siècles du moyen âge, par les derniers venus entre les grandes émigrations aryennes, était plus facile à opérer qu’entre cet art byzantin et l’art gallo-romain. Aussi, dans les monuments du Poitou et même de la Normandie, le byzantin s’empreint souvent de cet art que nos voisins appellent saxon, tandis qu’il ne conserve que de bien faibles traces de l’art romain local. La fusion entre ces deux premiers éléments se fait de manière à composer presque un art original.

En commençant cet article, nous avons dit combien il est périlleux, en archéologie, de prétendre classer d’une manière absolue les divers styles d’une même époque. Les enfantements du travail humain procèdent par transitions, et, s’il est possible de saisir quelques types bien caractérisés qui indiquent nettement des centres, des écoles, il existe une quantité de points intermédiaires où se rencontrent et se mêlent, à diverses doses, plusieurs influences. Dans l’article Clocher, nous avons eu l’occasion de signaler ces points de contact où plusieurs écoles se réunissent et forment des composés qu’il est difficile de classer d’une manière absolue. Il n’en est pas moins très-important de constater les noyaux, les types, quitte à reconnaître quelques-uns des points de jonction ou des mélanges se produisant et qui déroutent souvent l’analyse. Ainsi, à Toulouse, nous avons une école ; à Poitiers, nous en voyons une autre ; or, sur le parcours entre ces deux centres, quantité de monuments possèdent des sculptures qui inclinent tantôt vers l’une de ces écoles, tantôt vers l’autre, ou qui mélangent leurs produits de telle façon qu’il est difficile de faire la part de chacune des deux influences. Cela s’explique. Telle abbaye d’une province établissait une fille dans une province voisine. Elle y envoyait ses architectes, peut-être quelques artistes, mais elle prenait aussi les ouvriers ou artisans de la localité, élevés à une autre école que celle de l’abbaye mère. De là des mélanges de style. Ici un chapiteau toulousain, là un chapiteau poitevin ou saintongeois. Un bas-relief à figures d’une école et l’ornementation d’une autre. On comprend donc quels scrupules, quelle circonspection il faut apporter dans l’examen de ces œuvres du XIIe siècle, si l’on prétend les classer et découvrir sous quelles influences elles se sont produites. Depuis vingt-cinq ans, il a été beaucoup écrit sur l’archéologie monumentale de la France, on n’est pas encore parvenu à s’entendre sur ce qui constitue la dernière période de l’art roman, jusqu’à quel point agit l’influence byzantine, comment et pourquoi elle agit. Plusieurs archéologues en prenant quelques exemples pour le tout, ont prétendu que cet art roman est tout inspiré du byzantin, c’est-à-dire de l’art romano-grec à son déclin. Ceux ci, s’appuyant sur d’autres monuments, ont déclaré que le roman était aborigène, c’est-à-dire né sur le sol français, comme poussent des champignons après la pluie, quelques-uns, considérant, par exemple, certains édifices de la Provence, ont soutenu que le roman n’était que l’art gallo-romain repris et brassé par des mains nouvelles. Ces opinions différentes, en leur enlevant ce qu’elles ont d’absolu, sont justes si l’on n’examine qu’un point de la question, fausses si l’on envisage l’ensemble. Notre roman nous appartient sans nul doute, mais partout il a un père étranger. Ici romain, là byzantin, plus loin nord-hindou. Nous l’avons élevé, nous l’avons fait ce qu’il est, mais à l’aide d’éléments qui viennent tous, sauf le romain, de l’Orient. Et le romain lui-même, d’où est-il venu ? Nous avons vu parfois quelques personnes s’émerveiller de ce que certains chapiteaux du XIIe siècle avaient des rapports de ressemblance frappants avec l’ornementation des chapitaux égyptiens des dernières dynasties. Cependant il n’y a rien là qui soit contraire à la logique des faits. Ces arts partent tous d’une même source commune aux grandes races qui ont peuplé une partie de l’Asie et de l’Europe, et il n’y a rien d’extraordinaire qu’un ornement sorti de l’Inde pour aller s’implanter en Égypte ressemble à un ornement sorti de l’Inde pour aller s’implanter dans l’ouest de l’Europe. Lorsque l’histoire des grandes émigrations aryennes sera bien connue depuis les plus anciennes jusqu’aux plus récentes, si l’on peut s’émerveiller, c’est qu’il n’y ait pas encore plus de similitudes entre toutes les productions d’art de ces peuplades sorties d’un même noyau et pourvues du même génie, c’est qu’on ait fait intervenir à travers ce grand courant une race latine et qu’on ait englobé, Celtes, Kimris, Belges, Normands, Burgondes, Visigoths, Francs, tous Indo-Européens, dans cette race dite latine, c’est-à-dire confinée sur quelques hectares de l’Italie centrale. On aurait beaucoup simplifié les questions historiques d’art, si l’on n’avait pas prétendu les faire marcher avec l’histoire politique des peuples. Une conquête, un traité, une délimitation de frontières, n’ont une action sur les habitudes et les mœurs d’un peuple, et par conséquent sur ses arts, qu’autant qu’il existe en dehors de ces faits purement politiques, des affinités de races ou tout au moins des relations d’intérêt. Les Romains ont possédé la Gaule pendant trois siècles, ils ont couvert ses provinces de monuments ; or, dès que le trouble des grandes invasions est passé, est-ce aux arts romains que le Gaulois recoure ? non, il va chercher ailleurs ses inspirations, ou plutôt il les retrouve dans son propre génie ravivé par un apport puissant de peuplades sorties du même berceau que lui.
On nous dit : « La langue française est dérivée du latin, donc nous sommes Latins. » D’abord, il faut reconnaître que nous avons passablement modifié ce latin ; que le génie de la langue française diffère essentiellement du génie de la langue latine ; puis, après une possession non contestée pendant trois siècles, le Romain avait eu le temps d’imposer sa langue, puisqu’il avait en main le gouvernement et l’administration. Le latin étant admis comme langue usuelle sur la surface des Gaules, on ne cessait pas de parler, ne fut-ce que pour se plaindre, dans ces contrées ravagées par des invasions, mais on cessait de bâtir, et surtout de sculpter et de peindre ; du Ve au VIIIe siècle on eut le temps d’oublier la pratique des arts. Cependant lorsqu’un état social passablement stable succède à ce chaos, lorsqu’on peut songer à bâtir des palais, des églises, des monastères et des maisons, lorsqu’on prétend les décorer, pourquoi donc ces populations gauloises ne prennent-elles pas tout simplement l’art romain où on l’avait laissé ? Pourquoi (surtout dans les choses purement d’art comme la sculpture) vont-elles s’inspirer d’autres éléments ? C’est donc qu’il y avait un génie local, à l’état latent, renouvelé encore, comme nous le disions tout à l’heure, par des courants de même origine, et que ce génie, à la première occasion, cherchait à se développer suivant sa nature. Ce n’est pas là une question d’ignorance ou de barbarie, comme on l’a si souvent répété, mais une question de tempérament.
Par instinct, sinon par calcul, ces artistes romans n’ont pas voulu se ressouder à l’art romain, ou du moins à l’art gallo-romain. Il serait étrange, en effet, que ces architectes et sculpteurs romans du commencement du XIIe siècle qui avaient autour d’eux, sur le sol gaulois, quantité de monuments gallo-romains, les aient négligés pour s’emparer avec avidité de l’art gréco-romain ou byzantin de l’Orient, dès qu’ils l’entrevoient, s’ils ne s’étaient pas sentis comme une sorte de répulsion instinctive pour le romain bâtard de la Gaule et une affinité pour le romain grécisé de l’Orient. C’était donc cet appoint grec qui les séduisait, qui leur était sympathique ? Avaient-ils tort ? Et le XVIIe siècle a-t-il eu raison en nous romanisant de nouveau par des motifs fort étrangers à l’art ? Qu’un souverain absolu comme Louis XIV ait trouvé commode d’étouffer le génie particulier à notre pays pour assurer, croyait-il, le pouvoir monarchique en France, on le conçoit sans peine, mais que le pays lui-même se rendit complice de cette prétention, voilà ce qui ne pouvait être. Louis XIV était cependant un grand roi, sinon un grand homme, et il sut si bien combiner tous les rouages de son mécanisme de romanisation que nous en trouvons encore à chaque pas des pièces entières fonctionnant tant bien que mal, comme la vieille machine de Marly. Parmi ces rouages, les arts furent un des mieux constitués, monopole académique, protection immédiate du gouvernement sur les artistes, art officiel, centralisation des ouvrages d’art de toute la France entre les mains d’un surintendant, rien ne faillit à ce mécanisme que l’élément vital qui développe les arts, la liberté, l’affinité avec les goûts et les sentiments d’un peuple.
Au commencement du XIIe siècle, il n’y avait ni roi, ni seigneur, ni prélats qui pussent prendre ce pouvoir exhorbitant de confisquer le génie d’une nation au profit d’un organisme politique. Chaque province se développait suivant ses traditions, ses penchants, son esprit, acceptait les influences extérieures dans la mesure qui convenait à ses goût ou à ses sentiments ; et si dur qu’on veuille montrer le régime féodal, jamais il n’eût la prétention de contraindre les artistes à se soumettre à telle ou telle école d’art. La marque de cette indépendance de l’artiste se trouve sur les monuments mêmes ; n’est-ce pas à cela qu’ils empruntent leur charme le plus puissant ? Si, comme à l’époque gallo-romaine, nous voyons sur toute la surface du territoire français, sur mille monuments divers, le même chapiteau, la même composition décorative, le même principe de statuaire ou de sculpture d’ornement, la fatigue et l’ennui ne sont-ils pas la conséquence de cet état de choses ? On luttera de richesse, nous le voulons bien ; si l’on a mis sur tel édifice de Lyon pour 100 000 francs de sculpture, on en mettra pour 200 000 à Marseille. Nous aurons pour 200 000 fr. d’ennui au lieu d’en avoir pour 100 000 francs. Le moindre grain d’originalité ferait mieux notre affaire. Or, n’y a-t-il pas un grand charme à retrouver la trace des goûts de ces provinces diversement pourvues de traditions et d’aptitudes ? N’est-ce pas un plaisir très-vif, en parcourant les contrées habitées ou colonisées par les races grecques, de découvrir en Attique, dans le Péloponnèse, en Sicile, en Carie, en Ionie, en Macédoine et en Thrace, des expressions très-diverses de l’art grec ? N’est-ce pas une vraie satisfaction pour l’esprit en quittant les édifices romans du Berri, de trouver en Poitou, en Normandie ou en Languedoc des styles différents, des écoles variées, reflétant, pour ainsi dire, les génies divers de ces peuples. Dans chaque monument même, les masses contentées, ces chapiteaux de compositions diverses n’offrent-ils pas plus d’intérêt pour l’esprit et les yeux que ces longues files de chapiteaux romains, tous copiés sur le même moule. La symétrie, la majesté, l’unité, objectera-t-on, commandent cette répétition d’une même note. Pour l’unité, elle n’exclut nullement la variété, il n’y a pas, à proprement parler, d’unité sans variété ; quant à la symétrie et à la majesté, que nous importent ces qualités, purement de convention, si elles nous fatiguent et nous ennuient. L’ennui majestueux ou l’ennui tout court, c’est tout un.
Les Grecs des bas temps pensaient ainsi, car dans ces monuments de Syrie qu’ils nous ont laissés, à Sainte-Sophie de Constantinople, ils admettent la variété dans la composition des chapiteaux d’un même ordre, dans les ornements des linteaux, des tympans et frises d’un même monument. Bien entendu, nos artistes occidentaux suivirent en cela leur exemple, et se gardèrent de recourir à la majestueuse monotonie de l’ornementation des monuments gallo-romains, lorsqu’ils reprirent en main la pratique des arts.
Avant de passer outre, il nous paraît utile de définir, s’il est possible, cet art byzantin auquel nous faisons appel à chaque instant ; comment, en effet, observer la nature de son influence si nous n’en connaissons ni les éléments divers, ni le caractère propre ? Nous serions heureux de recourir à l’ouvrage d’art ou d’archéologie qui aurait nettement défini ce qu’on entend par le style byzantin, et de partir de ce point acquis à la science. Mais c’est en vain que nous avons cherché ce résumé clair, précis. Tous les documents épars que nous pouvons consulter ne montrent qu’une face de la question, ne considèrent qu’un détail ; quant au faisceau groupant ces travaux, nous ne pensons pas qu’il existe. Essayons donc de le constituer, car les arts byzantins connus, les conséquences que nous pouvons tirer de leurs influences sur l’art occidental, sur le nôtre en particulier, sembleront naturelles. N’oublions pas qu’il s’agit ici de la sculpture.
Voir dans l’art de Byzance un compromis entre le style adopté par les Romains du bas-empire et quelques traditions de l’art grec, ce n’est certes pas se tromper, mais c’est considérer d’une manière un peu trop sommaire un phénomène complexe. Il faudrait, — l’art admis par les Romains bien connu, — savoir ce qu’étaient ces traditions de l’art grec sur le Bosphore au IVe siècle. Cet art grec était romanisé déjà avant l’établissement de la capitale de l’Empire à Constantinople ; mais il s’était romanisé en passant par des filières diverses. Or, comme les Romains, en fait de sculpture, n’avaient point un art qui leur fût propre, ils trouvaient à Constantinople l’art grec modifié par l’élément latin et tel, à tout prendre, qu’ils l’avaient admis partout où ils pouvaient employer des artistes grecs. Les Romains apportaient donc à Byzance leur génie organisateur en fait de grands travaux publics, leur structure, leur goût pour le faste et la grandeur, mais ils n’ajoutaient rien à l’élément artiste du Grec. Mais ces Grecs de l’Asie qu’étaient-ils au IVe siècle ? Avaient-ils suivi rigoureusement les belles traditions de l’Attique ou même celles des colonies ioniennes, cariennes ? rappelaient-ils par quelques côtés ces petites républiques de l’Attique et du Péloponnèse qui considéraient comme des barbares tous les étrangers ? non certes ; ces populations, au milieu desquelles s’implantait la capitale de l’Empire, étaient un mélange connus d’éléments qui, pendant des siècles, avaient été divisés et même ennemis, mais qui avaient fini par se fondre. Le génie grec dominait encore, au sein de ce mélange assez pour l’utiliser, pas assez pour l’épurer.
D’ailleurs pourquoi l’empire romain transportait-il son centre à Byzance ? Dorénavant maître de l’Occident borné par l’Océan, tranquille du côté du Nord (le croyait-il du moins) depuis les guerres de Trajan, et depuis qu’il avait organisé comme une sorte de ligue germanique dévouée à Rome ; du côté de l’Orient, il trouvait un continent profond, inconnu en grande partie, dans lequel ses armées pénétraient en rencontrant chaque jour, et des obstacles naturels et des populations guerrières innombrables. Byzance était (la situation de l’Empire admise au commencement du IVe siècle) la base d’opérations la mieux choisie, tant pour conserver les anciennes conquêtes que pour en préparer de nouvelles. C’était aussi, et c’est là ce qui nous intéresse ici, le nœud de tout le commerce du monde connu alors. Or, il est inutile de dire que l’Empire prétendait accaparer tous les produits du globe et l’industrie des nations, depuis l’ivoire jusqu’au bois de charpente, depuis les perles jusqu’aux métaux vulgaires, depuis les épices jusqu’aux étoffes précieuses. Bien avant l’établissement de Constantin à Byzance, cette ville, ou plutôt les villes du Bosphore, étaient le rendez-vous des caravanes venant du nord-est par le Pont, de l’est par l’Arménie, de l’Inde et de la Perse par le Tigre et l’Euphrate. Avec ces caravanes arrivaient non-seulement des objets d’art fabriqués dans ces contrées éloignées, mais aussi des artisans, cherchant fortune et attirés par la consommation prodigieuse que l’Empire faisait de tous les produits de l’Orient. Il était donc naturel que l’élément grec qui existait et avait pu dominer sur les bords du Bosphore fût influencé et modifié profondément par ces appoints perses, assyriens, indiens même, que ces caravanes faisaient affluer sans cesse vers Byzance.
Constantinople devint plus encore, après l’établissement de l’Empire dans ses murs, une ville orientale cosmopolite. Le luxe de la cour des empereurs, le commerce étendu qui se faisait dans cette capitale si admirablement située, donna aux arts que nous appelons byzantins un caractère qui, bien qu’empreint encore du génie grec, offre un mélange des plus curieux à étudier de l’art grec proprement dit avec les arts des Perses et même de l’Inde. Comme preuve, nous présenterions les ouvrages de M. le comte Melchior de Vogüé, que nous avons cité déjà souvent, sur les villes du Haouran, et celui de M. W. Salzemberg sur les plus anciennes églises de Constantinople, Sainte-Sophie comprise.
Les monuments du Haouran, c’est-à-dire renfermés dans ces petites villes qui, entre Alep et Antioche, n’étaient guère que des étapes pour les caravanes qui venaient du golfe Persique par l’Euphrate, monuments auxquels nous avons donné la qualification de gréco-romains, datent du IVe au VIe siècle. Leur sculpture est fortement empreinte de style grec, sans représentations humaines, sans influences persiques, les dernières en date seulement présentent quelques réminiscences des sculptures arsacides et sassanides. Mais il n’en est pas ainsi pour la sculpture de Constantinople qui date des Ve et VIe siècles[35], celle-ci est bien plus persique, quant au style, que grecque ou gréco-romaine. Les arts des Perses avaient profondément pénétré la sculpture d’ornement de Byzance, à ce point que certains chapiteaux ou certaines frises de Sainte-Sophie, par exemple, semblent arrachés à des monuments de la Perse et même de l’Assyrie. On comprend parfaitement, en effet, comment des villes comme celle du Haouran, qui ne servaient que de lieux de repos, que d’étapes pour les caravanes se dirigeant sur Antioche, ne pouvaient pas recevoir de ces caravanes quantité de produits ou d’objets devant être livrés aux négociants à destination. En un mot, et pour employer une expression vulgaire, ces caravanes ne déballaient qu’à Antioche et ce qu’elles laissaient en chemin ne pouvait être que des objets de peu d’importance propres à être échangés contre la nourriture et le logement qu’elles trouvaient dans ces villes. Mais Constantinople était un entrepôt où venaient s’amasser tous les objets les plus précieux qu’apportaient du golfe Persique les caravanes qui remontaient le Tigre, passaient par la petite Arménie, par la Cappadoce, la Galatie et la Bithynie. À Constantinople, ces objets étaient vus de tous ; des artisans ou artistes perses s’y établissaient, l’art grec proprement dit, si vivace encore dans le Haouran, c’est-à-dire dans le voisinage de ces anciens centres grecs de Lycie, de Carie, de Cilicie, l’art grec, à Byzance, loin d’ailleurs de ses foyers primitifs, était étouffé sous l’apport constant de tous ces éléments persiques.
Ainsi donc, si nous entendons par art byzantin l’art de Constantinople au VIe siècle, nous devons, — en ce qui regarde la sculpture, — considérer cet art comme un mélange dans lequel l’élément persique domine essentiellement, non-seulement l’élément persique des Sassanides, mais celui même des Arsacides, et dans lequel l’élément grec est presque entièrement étouffé. Si, au contraire, nous entendons par art byzantin l’art de la Syrie du IVe au VIe siècle, nous admettrons que l’élément grec domine, surtout si nous prenons la Syrie centrale.
Les croisés, à la fin du XIe siècle et au commencement du XIIe, s’étant répandus en Orient depuis Constantinople jusqu’en Arménie, en Syrie et en Mésopotamie, il ne faut point être surpris si dans les éléments d’art qu’ils ont pu rapporter de ces contrées, on trouve et des influences grecques prononcées, et des influences persiques, et des influences produites par des mélanges de ces arts déjà effectués antérieurement. Si bien, par exemple, que certaines sculptures romanes de France rappellent le faire, le style même de quelques bas-reliefs de Persépolis, d’autres des villes du Haouran, d’autres encore de Palestine et même d’Égypte ; non que les croisés aient été jusqu’en Perse, mais parce qu’ils avaient eu sous les yeux des objets, des monuments même, peut-être, qui étaient inspirés de l’antiquité persique.
Reprenons l’examen de nos écoles françaises. L’école de sculpture d’ornement du Poitou et de la Saintonge étend ses rameaux jusqu’à Bordeaux, mais en remontant la Garonne elle ne va pas au delà du Mas d’Agen. Encore, dans cette dernière ville, cette école subit l’influence du centre toulousain. L’église du Mas d’Agen nous montre de beaux chapiteaux, les uns appartiennent à l’école de Saintonge, d’autres donnent un mélange des deux écoles, et se rapprochent de celle de Toulouse. Tel est par exemple celui-ci (fig. 36). L’ornementation du tailloir appartient au roman empreint des arts gréco-romains. Les figures d’un meilleur style que celles du Poitou et de la Saintonge[36] rappellent la statuaire de Toulouse.

Cahors présente également, au XIIe siècle, en ornementation comme en statuaire, un mélange d’influences dues aux provinces occidentales et méridionales. Mais où ce mélange est bien marqué, c’est à l’abbaye de Souillac, sur l’ancienne route de Brives à Cahors. Les bas-reliefs et sculptures qui décorent l’intérieur de la porte de cette église ont un caractère qui tient à la fois du génie nord-hindou dont nous avons trouvé des traces à Poitiers et des arts byzantins. Dans la composition bizarre du pilier de gauche tenant à la porte de l’église abbatiale de Souillac (fig. 37), on peut

À Moissac, on retrouve, sur le trumeau de la grande porte de l’église, des réminiscences de cet art nord-européen ou nord-hindou, dans ces lions entrelacés, superposés, compris entre deux dentelures curvilignes.
Ainsi donc l’école de sculpture de Toulouse venait se mélanger à Moissac, à Souillac, avec l’école des côtes occidentales de la France ; or, celle-ci semble avoir reçu des éléments orientaux d’une assez haute antiquité par des expéditions scandinaves ou normandes, tandis que l’école de Toulouse n’obéissait qu’à des traditions gallo-romaines profondément modifiées par un apport byzantin.
Il est loin de notre pensée de vouloir établir des systèmes ou des classifications absolues, et nous nous garderons, dans une question aussi complexe, de laisser de côté des exemples qui tendraient à modifier ces aperçus généraux sur les origines des arts français du moyen âge. Il reste peu de fragments d’architecture romane à Limoges. Cependant, par suite de l’établissement des comptoirs vénitiens dans cette ville, un mouvement d’art avait dû se produire dès le Xe siècle. Au point de vue de l’architecture, Saint-Front de Périgueux en est la preuve. Mais en ne considérant que la sculpture d’ornement, dans les villes du Limousin, on retrouve quelques traces d’un art qui n’est ni le roman de l’ouest, ni celui de Toulouse. Cet art décoratif paraît plus qu’aucun autre inspiré par la vue et l’étude de cette quantité d’objets, d’étoffes, de bijoux que les Vénitiens rapportaient, non-seulement de Constantinople, mais de Damas, de Tyr, d’Antioche et des côtes de l’Asie Mineure. Nous en trouvons une trace évidente dans un édifice de la fin du XIIe siècle, Saint-Martin de Brives ; les chapiteaux de la porte occidentale présentent cette composition d’ornements (fig. 38), qui rappelle fort les chapiteaux, non plus byzantins, mais arabes, d’une époque reculée[37].

L’église Saint-Martin de Brives est d’ailleurs un édifice remarquable. Ses parties les plus anciennes datent des premières années du XIIe siècle, mais la nef et la porte, dont proviennent les chapiteaux (fig. 38), ont été construites vers 1180. Le vaisseau principal et ses deux collatéraux sont voûtés à la même hauteur. Des colonnes cylindriques très-élancées portent ces voûtes. Un passage relevé règne intérieurement au niveau des appuis des fenêtres des bas-côtés. La sculpture, sobre d’ailleurs, affecte, dans ces constructions de la fin du XIIe siècle, un caractère oriental très-prononcé.
Les monuments du XIIe siècle dans le Limousin, ou plutôt dans cette contrée qu’occupent aujourd’hui les départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze, sont rares. Ceux qui restent debout sont d’une telle sobriété d’ornementation, — les plus riches ayant été détruits lors des guerres de religion, — qu’il serait difficile de bien définir si là il existait un centre d’art, une école de sculpture au XIIe siècle, comme en Languedoc et en Poitou. Si, au contraire, nous nous rapprochons du centre, si nous entrons en Auvergne et dans le Vélay, nous trouvons les nombreuses traces d’un art qui n’est ni celui de Toulouse, ni celui du Poitou, ni celui du Limousin. Là, jusque vers le commencement du XIIe siècle, le gallo-romain règne en maître[38]. Les chapiteaux de la partie la plus ancienne du cloître de la cathédrale du Puy, qui datent de la première moitié du XIe siècle, sont des sculptures romaines mal copiées ; mais vers 1130, un nouvel art, fin, recherché, souple, se développe.
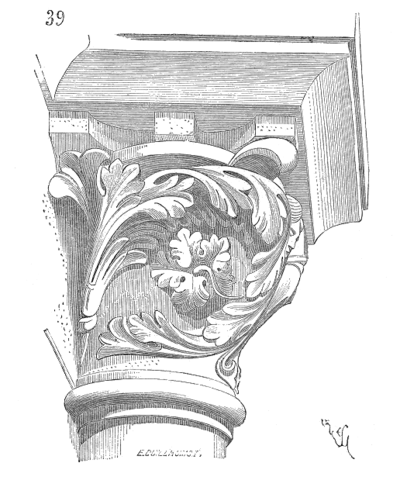
On en pourra juger par ce chapiteau (fig. 39)[39], qui n’est plus gallo-romain, mais qui n’est byzantin, ni par la composition, ni surtout par le faire. À côté de ce morceau, des portions de corniches de la même époque (fig. 40), accusent, au contraire, l’influence orientale, soit par la présence de ces objets du Levant apportés par les Vénitiens, soit par la vue des monuments de l’époque des Sassanides, car cette ornementation de palmettes arrondies et perlées, entremêlées d’animaux, est plutôt persane que byzantine.


Par sa situation géographique même, l’école de sculpture de l’Auvergne reste indécise entre ses voisines puissamment établies. Elle reflète tantôt l’une, tantôt l’autre, et plus elle s’avance vers la fin du XIIe siècle, moins elle sait prendre un parti entre ces influences différentes. Elle rachète, il est vrai, cette incertitude par la finesse d’exécution, par une recherche des détails, mais elle ne parvient pas à constituer un style propre. Aussi, quand s’éteignent les belles écoles du Midi, à la fin du XIIe siècle, les sculpteurs de l’Auvergne, dépourvus de guides, ne laissent rien, ne reproduisent rien par eux-mêmes, et ce n’est qu’à la fin du XIIIe siècle que l’art de la sculpture se relève dans cette province, avec l’importation des arts du Nord.
Il n’en fut pas ainsi dans le Berri. Cette province centrale est une de celles qui, à côté de traditions gallo-romaines assez puissantes, admit certains éléments byzantins très-purs. Nous en avons un exemple des plus caractérisés à Bourges même. Il existe dans cette ville une porte du monastère de Saint-Ursin qui date de la fin de la première moitié du XIIe siècle et que l’on voit encore entière rue du Vieux-Poirier. Cette porte est d’abord fort intéressante comme construction en ce qu’elle présente un linteau appareillé supportant un tympan et déchargé par un arc plein cintre. Le tympan, en reliefs très-plats, représente, au sommet, des fabliaux ; au-dessous, dans la seconde zone, une châsse qui paraît copiée d’après ces bas-reliefs si fréquemment sculptés sur les sarcophages des Bas-temps. Dans la zone inférieure, les travaux des mois de l’année. Sur le linteau appareillé se développe un enroulement quasi romain. À côté de ces sculptures, qui sont évidemment imitées des fragments antiques si nombreux à Bourges au XIIe siècle, se trouvent des pieds-droits, des chapiteaux et colonnettes engagés que l’on croirait copiés sur de la sculpture de Constantinople, si bien que plusieurs ont cru longtemps que cette porte, élevée au XIIe siècle, avait été complétée à l’aide de fragments d’une époque antérieure. Cela n’est pas admissible cependant, car en y regardant de près, les figures sont vêtues d’habits du XIIe siècle ; le faire, la taille, les inscriptions, appartiennent à cette époque. D’ailleurs, sous le tympan, un cartouche contient cette légende :


On voit apparaître dans le Berry, à Châteauroux (église de Déols), à Saint-Benoît-sur-Loire, à Saint-Aignan, à Neuvy-Saint-Sépulcre, etc., dans la sculpture d’ornement de la fin du XIe siècle au milieu du XIIe, les traces non douteuses de ce rapprochement entre l’art gallo-romain corrompu et l’art gréco-romain de Syrie importé dès les premières croisades, sans que de ce mélange il résulte tout d’abord un art formé, complet comme dans le roman du Midi, celui de Cluny ou celui de l’Ouest. Ces artistes tâtonnent pendant presque toute la première moitié du XIIe siècle, sans parvenir à fondre entièrement ces deux éléments. À côté d’une imitation très-fine de la sculpture byzantine est un morceau lourdement inspiré des restes gallo-romains, comme dans l’exemple précédent qui se rapproche de 1150. Cependant les fragments anciens de la cathédrale de Bourges[40] qui garnissent les deux portes nord et sud et notamment le linteau à grands enroulements d’une de ces deux portes, 1140 à 1150, présentent un caractère de sculpture assez franc, se rapprochant beaucoup de l’art roman de Chartres et de l’Île-de-France.
Par le fait, vers cette époque, l’école romane du Nord se développe sur une surface de territoire étendue qui comprend l’Île-de-France proprement dite, une partie de la Normandie Séquanaise, le Beauvoisis, le Berry, le pays Chartrain et la Basse-Champagne. Cette école, de 1130 à 1145, avait, de ces éléments, su mieux qu’aucune autre (l’école toulousaine exceptée) composer un style particulier qui n’est ni le byzantin, ni une corruption du gallo-romain, ni une réminiscence de l’art nord-européen, mais qui tient un peu de tout cela et qui, au total, produit de beaux résultats. Arrivée plus tard que les écoles du Centre et du Midi, et surtout que la grande école de Cluny, peut-être a-t-elle profité des efforts de ses devancières, a-t-elle pu mieux qu’elles opérer un mélange plus complet de ces styles divers.
Cependant, quand on remonte aux premiers essais de l’école dont le foyer est l’Île-de-France, après l’abandon des traditions gallo-romaines restées sur le sol, on ne peut méconnaître que cette école réagit plus qu’aucune autre contre ces traditions. On pourrait voir là dedans le réveil d’un esprit gaulois, d’autant qu’il est bien difficile autrement de comprendre l’espèce de répulsion que l’art de la sculpture, au commencement du XIIe siècle, manifeste pour tout ce qui rappelle le style romain. Dans les autres provinces, au fond de toute sculpture, on retrouve quelque chose de l’art antique admis dans les Gaules, et plus spécialement dans les pays de langue d’Oc, mais autour de Paris des éléments neufs ou renouvelés apparaissent.
Cette école de l’Île-de-France était certes, au commencement du XIIe siècle, relativement barbare. L’échantillon de sculpture d’ornement datant de cette époque que nous donnons ici (fig. 43), tiré de l’église abbatiale de Morienval (Oise)[41], est bien éloigné de la belle et large sculpture de Vézelay, de celle de Toulouse, de celle du Quercy.
Sans se lancer dans le champ des hypothèses, on en sait assez aujourd’hui déjà, pour reconnaître : que les traditions d’un peuple laissent des traces presque indélébiles à travers les conquêtes, les invasions, les délimitations territoriales, comme pour donner un démenti perpétuel à l’histoire, telle qu’on l’a écrite jusqu’à ce jour ; que ce principe des nationalités reparaît à certaines époques pour déconcerter les combinaisons de la politique qui semblent les plus solidement conçues. Dans l’histoire de ce monde, les peuples, leurs goûts, leurs affections, leurs aptitudes, jouent certainement un rôle bien autrement important qu’on ne se l’imaginait il y a encore un demi-siècle. Nous pensons donc qu’on a donné une place trop large à l’influence de la civilisation romaine sur la Gaule et que cette influence, toute gouvernementale et administrative, malgré trois siècles de domination sans troubles, n’a jamais fait pénétrer dans le sol national que des racines peu profondes, que le régime féodal et l’introduction d’éléments identiques à ceux de la vieille Gaule celtique, au Ve siècle, n’a pu que raviver le génie national comprimé pendant la période romaine et qu’enfin, à cette époque du moyen âge ou un ordre relatif se rétablit, ce génie national considère comme un temps d’arrêt, une lacune, la période de domination et de désordre comprise entre le Ier siècle et le XIe.
Si dans les monuments qui nous restent de l’époque carlovingienne, nous voyons la sculpture, dans les Gaules, s’efforcer de se rapprocher des arts antiques, copier grossièrement des ornements romains, pourquoi à la fin du XIe siècle abandonne-t-on ces traditions sur la partie du territoire qui est destinée à former le noyau de l’unité nationale rêvée par Vercingétorix, cinquante ans avant notre ère ? Pourquoi les arts de ces provinces françaises, entourant Paris, après avoir produit les grossiers essais dont nous venons de donner un fragment (figure 43), n’adoptent-ils qu’avec réserve, soit les importations de l’Orient acceptées avec empressement au delà de la Loire, soit les restes des édifices gallo-romains dont ils étaient entourés ? Et comment se trouvant dans une situation d’infériorité relative au commencement du XIIe siècle, si on les met en parallèle avec les écoles des Clunisiens et celles du Midi, atteignent-ils au contraire, dès 1150, une supériorité marquée sur ces écoles de l’Est et d’outre-Loire ? Ce serait donc que le génie national, mieux conservé dans ces provinces voisines de Paris, plus ombrageux à l’endroit des importations étrangères, se trouvait, par cela même, plus propre à concevoir un art original ?
L’art roman de l’Île-de-France et des provinces limitrophes, au commencement du XIIe siècle, est relativement barbare, ce n’est pas contestable, mais en peu d’années, dans ces provinces, les choses changent d’aspect. Tandis que la sculpture des provinces méridionales et du centre ne progresse plus et tend au contraire à s’affaisser vers la seconde moitié du XIIe siècle, indécise entre le respect pour des traditions diverses et l’observation de la nature ; dans le domaine royal, il se forme une grande école qui ne rappelle plus la sculpture gallo-romaine, qui refond, pour ainsi dire, l’art byzantin et se l’approprie, qui ne néglige pas absolument ces traces éparses de l’art que nous appelons Nord-Européen, mais qui sait tirer de tous ces éléments étrangers des traditions locales, l’unité dans la composition, dans le style et l’exécution, fait que nous chercherions vainement ailleurs sur le sol gaulois. Cette école préludait ainsi à l’enfantement de cet art laïque de la fin du XIIe siècle si complet, si original aussi bien dans la structure des édifices que dans la manière toute nouvelle de les décorer.
Voici (fig. 44) des chapiteaux jumelés du tour du chœur de Saint-Martin des Champs, à Paris, dont la sculpture atteint à la hauteur d’un art complet.

Certes, on retrouve bien là des éléments byzantins, mais non de cet art byzantin des monuments de Syrie. Cette sculpture rappellerait plutôt celle des diptyques et des reliures d’ivoire, l’orfèvrerie byzantine. Le sentiment de la composition est grand, clair, contenu. Dans des fragments déposés à l’église impériale de Saint-Denis, à Chartres, à l’église de Saint-Loup (Marne), dans quelques édifices du Beauvoisis, on retrouve ces mêmes qualités. Il n’est pas besoin de faire ressortir les différences qui distinguent cet art des arts romans du Midi et du Centre ; ces derniers, quelle que soit la beauté de certains exemples, restent à l’état de tentatives, ne parviennent pas à se développer complétement. L’unité manque dans l’École toulousaine, dans celle de l’Auvergne et du Quercy. Elle se retrouve davantage dans l’École poitevine, mais quelle lourdeur, quelle monotonie et quelle confusion, en comparaison de ces compositions déjà claires et bien écrites du roman de l’Île-de-France vers 1135 !

Où les sculpteurs français avaient-ils pris ces exemples ? Partout et nulle part… Partout, puisque depuis l’époque romaine on avait souvent sculpté des fûts de colonnes, notamment dans les Gaules, puisque dans les provinces de l’Est, avant cette époque, des fûts de colonnes étaient décorés. Nulle part, parce que dans cette sculpture de fûts antiques ou du moyen âge on ne retrouve ce principe neuf, d’un réseau ronde-bosse, enveloppant la colonne comme le ferait une branche tordue à l’entour.
Des ustensiles rapportés d’Orient, des manches d’ivoire, de bois, pouvaient avoir donné au sculpteur chartrain l’idée de cette gracieuse décoration ; mais le style de l’ornementation et l’exécution lui appartiennent. Remarquons que ces colonnettes placées entre des statues d’un travail simple comme masses, sinon comme détails, font admirablement ressortir la statuaire en formant, dans les intervalles qui les séparent, comme une riche tapisserie modelée.
Mais ce qui, à cette époque déjà, distingue l’école du domaine royal de toutes les autres écoles romanes de la France, c’est l’entente parfaite de l’échelle dans l’ornementation. De Toulouse à la Provence, du Lyonnais au Poitou, sur la Loire et en Normandie, à Vézelay même, l’ornementation, souvent très-remarquable, est bien rarement à l’échelle du monument. Rarement encore y a-t-il concordance d’échelle entre les ornements d’un même édifice. Ainsi verrons-nous à Saint-Sernin de Toulouse des chapiteaux couverts de détails d’une délicatesse extrême à côté de chapiteaux dont les masses sont larges. À Vézelay, où la sculpture est si belle, nous signalerons aux portes latérales de la nef, des archivoltes dont les ornements écrasent tout ce qui les entoure, des chapiteaux délicats couronnés par des tailloirs dont la sculpture est trop grande. En Provence, ce sont des détails infinis sur des moulures dont l’effet est détruit par le voisinage d’une lourde frise. L’exemple de la porte de Saint-Ursin à Bourges (fig. 42) donne exactement l’idée de ce manque d’observation dans les rapports d’échelle de l’ornementation. Ces défauts considérables sont évités dans le roman développé du domaine royal, et c’est ce qui en fait déjà un art supérieur, car il ne suffit pas qu’un ornement soit beau, il faut qu’il participe de l’ensemble, et ne paraisse pas être un fragment posé au hasard sur un édifice.
Cependant il se faisait, vers 1160, dans l’art de la sculpture d’ornement comme dans la statuaire, une révolution. Les artistes se préparaient à abandonner entièrement ces influences, ces traditions qui jusqu’alors les avaient guidés ; influences, traditions conservées dans les cloîtres, véritables écoles d’art. De l’archaïsme, la statuaire passe, par une rapide transition, à l’étude attentive de la nature ; il en est de même pour la sculpture d’ornement. En prenant la tête des arts, les laïques semblent fatigués de cette longue suite d’essais plus ou moins heureux, tentés pour établir un art sur des éléments antérieurs. Dorénavant, instruits dans la pratique, ils vont puiser à la source toujours nouvelle de la nature. C’est précisément à l’époque des croisades de Louis le Jeune et de Philippe-Auguste, que l’on signale comme une renaissance des arts en Occident provoquée par l’influence orientale que les artistes français rejettent, soit dans le système d’architecture, soit dans la sculpture, toutes les influences orientales qui avaient eu, au commencement du XIIe siècle, une si grande action sur le développement de nos diverses écoles. Mais ce mouvement n’est pas général sur la surface du territoire des Gaules ; il ne se fait sentir que dans les provinces du domaine royal, en Bourgogne, en Champagne et en Picardie. La prédominance de l’art du Nord en France sur l’art du Midi est assurée à dater de ce moment. De même que la langue d’oïl tend chaque jour à réduire les autres dialectes français à l’état de patois, de même les écoles d’architecture et de sculpture du domaine royal tendent à se substituer à ces écoles provinciales si brillantes encore au milieu du XIIe siècle. Nous expliquons ailleurs[42] comment les sculpteurs laïques de la fin du XIIe siècle vont chercher leurs inspirations dans la flore des champs et des forêts ; comment certaines tentatives timides avaient été faites partiellement en ce sens, dès le commencement du XIIe siècle, par les meilleures écoles françaises, et notamment par les artistes de Cluny, sans toutefois que ces tentatives aient apporté un appoint important à travers les influences orientales ou les traditions gallo-romaines ; mais comment, enfin, cette observation de la nature se formule en des principes invariables au sein de l’école du domaine royal, de 1190 à 1200.
Il ne semble pas toutefois que cette école ait, la première, repris la voie à peine entrevue et bientôt abandonnée par quelques artistes, près d’un siècle auparavant. C’est encore l’école de Cluny qui marche en tête, vers 1170 ; et si elle est bien vite dépassée par l’esprit logique des artistes laïques de l’Île-de-France, il ne faut pas moins lui rendre cet hommage.
Entre autres qualités et défauts, l’esprit de la population dont Paris est devenu le centre passe brusquement de l’idée à la pratique par une déduction logique ; nos révolutions, nos modes en sont la preuve. Une idée, un principe ne sont pas plus tôt émis chez nous, que l’on prétend immédiatement les mettre en pratique.
En Allemagne, on discutera pendant des siècles sur la caducité d’un système ou la vitalité d’un principe avant de penser sérieusement à détruire le premier et à adopter le second ; en France, à Paris surtout, on passera bien vite de la discussion théorique aux effets. Si dans le domaine de l’art, les Académies ont pu, depuis deux siècles, ralentir ce courant logique qui conduit de la théorie à la pratique, comme elles n’existaient point en 1180, et qu’il ne paraît pas que les écoles monastiques aient prétendu prendre ce rôle, il n’est pas surprenant que l’école laïque, nouvellement formée alors, se soit jetée avec passion dans cette application de principes nouveaux à l’ornementation sculptée, d’autant qu’elle avait hâte d’en finir avec cet art roman qui représentait à ses yeux la féodalité monastique, dont elle ne voulait plus, dont saint Bernard avait diffamé les arts, et que les évêques tendaient à détruire.
L’école de Cluny, malgré les reproches du fondateur de l’ordre de Cîteaux, ne tenait pas moins à conserver le rang élevé qu’elle avait su prendre dans la pratique des arts. À ce point de vue, elle prétendait marcher avec le siècle et le devancer au besoin. Vers 1130, ses relations avec l’Orient s’étaient étendues. Elle élevait alors le narthex de l’église de Vézelay, dont l’ornementation est mieux pénétrée de cet art gréco-romain de Syrie que ne l’est celle de la nef. Quelques années après, vers 1150, elle construisait la salle capitulaire de la même église, dont la sculpture est si fortement empreinte de l’art byzantin de Syrie, qu’on croirait voir dans la plupart des chapiteaux et culs-de-lampe, des fragments arrachés à ces villes gréco-romaines du Haouran. Dans cette voie d’imitation, ou d’interprétation plutôt, on ne pouvait aller plus loin sans tomber dans les pastiches ou la monotonie, car cette ornementation gréco-romaine, de même que l’ornementation grecque, son aïeule, ne brille pas par la variété. L’école clunisienne fit donc un temps d’arrêt, et chercha les éléments nouveaux qui lui manquaient dans l’amas de traditions usées par elle. Ces éléments, elle les trouva dans les végétaux de ses champs ; elle pensa qu’au lieu d’imiter ces feuillages de convention attachés sur les frises et les chapiteaux de la Syrie, au lieu d’essayer de les modifier suivant le goût de l’artiste, il serait mieux de prendre les plantes qui croissaient dans la campagne, et d’essayer de les mettre à la place de la flore traditionnelle qu’elle reproduisait sans cesse avec plus ou moins d’adresse et de charme. Désormais cette école, rompue aux difficultés du métier, habile de la main, grâce à ce long apprentissage, était capable de rendre avec délicatesse ces plantes qui allaient remplacer l’ornementation romane à bout d’invention ou d’imitation. Aussi ses essais sont des coups de maître. Vers 1160, on ouvrit dans la salle capitulaire de Vézelay, bâtie depuis dix ans, trois arcades donnant sur le cloître. Ces trois arcades sont décorées de chapiteaux et d’archivoltes sculptés dont rien n’égale la souplesse et l’élégance. La forme générale de ces chapiteaux rappelle encore la forme romane, mais les détails imités de la flore des champs sont composés avec une grâce, une délicatesse de modelé que la main la plus exercée atteindrait difficilement.


On observera cependant que les critiques de saint Bernard ont porté coup. Dans la sculpture de Vézelay innaturelle, comme disent les Anglais, jusqu’en 1132, année de la dédicace du narthex, sur les chapiteaux, la figure humaine, les animaux, les bestiaires, abondent. Déjà, dans la sculpture de la salle capitulaire, un peu plus moderne, ces figures disparaissent presque entièrement. L’ornementation si riche des trois arcs ouverts de 1160 à 1165 dans cette salle n’en porte plus trace. Déjà la flore naturelle s’est substituée à ces éléments aimés des sculpteurs romans et, entre tous, des clunisiens. Mais l’architecture qui portait, à Vézelay, cette sculpture déjà naturelle, était encore toute romane ; elle ne devenait gothique, c’est-à-dire conçue d’après le système de structure gothique, que dans la construction du chœur de la même église, c’est-à-dire vers 1190.
Le mouvement d’art ne se produit pas de la même manière à Saint-Denis, en France. C’est en 1137 que l’abbé Suger commence la construction de l’église abbatiale, dont nous voyons encore la basse œuvre du tour du chœur et le narthex. L’édifice fut élevé en trois ans et trois mois, il était donc achevé en 1141. Or, si la structure de l’église abbatiale de Suger est complétement gothique[43], l’ornementation incline à peine, et comme passagèrement, à imiter la flore.
C’est en 1128, avant le règne de Zenghi, que les Francs, comme les appelaient les auteurs arabes, sont arrivés à l’apogée de leur puissance en Orient : « L’empire des Francs, dit l’auteur de l’histoire des Atabeks[44], s’étendait, à cette époque, depuis Maridin et Schaiketan en Mésopotamie, jusqu’à El-Arisch, sur les frontières de l’Égypte ; et de toutes les provinces de Syrie, Alep, Emesse, Hamah et Damas, avaient pu seules se soustraire à leur joug. Leurs troupes s’avançaient dans le Diarbékir jusqu’à Amida, sans laisser en vie ni adorateurs de Dieu, ni ennemis de l’erreur ; et dans l’Al-Djézirèh jusqu’à Rassain et Nisibe, sans laisser aux habitants ni effets ni argent. » C’est en effet à cette époque, c’est-à-dire de 1125 à 1135, que la structure de nos monuments d’Occident rappelle le mieux les divers styles orientaux dont nous avons indiqué plus haut la provenance. Dès 1137, Zenghi avait pris un bon nombre de places aux chrétiens, s’était fortifié en Syrie ; en 1144, il s’emparait d’Édesse. À dater de cette époque, les affaires des Occidentaux ne firent que s’empirer en Orient. Noureddin continua avec succès l’œuvre commencée par Zenghi. Cependant, en 1164 et en 1167, les armées chrétiennes de Syrie envahirent deux fois la basse Égypte, et s’y maintinrent jusqu’en 1169, dans la crainte de voir les armées musulmanes attaquer à la fois le royaume de Jérusalem par le nord, l’est et le sud. Pour les chrétiens, à dater de 1170, l’Orient n’est plus qu’un champ de bataille où chaque jour il faut se défendre. Plus de commerce, plus d’établissements sûrs, plus de relations avec les caravanes venant de la Perse. Acculés à la mer, ils ne devaient plus songer qu’à se maintenir dans le peu de villes voisines du littoral qui leur restaient, et n’offraient plus aux Occidentaux, qui affluaient en Syrie et en Palestine trente ans auparavant, que des armes pour défendre les débris de leur domination. Cette source d’arts et d’industries qui avait eu sur l’Occident une influence si considérable était tarie ; d’ailleurs elle nous avait donné ce qu’elle pouvait nous donner.
Indépendamment des invasions à main armée que les Francs avaient tentées en 1164, il existait entre l’Égypte et le royaume de Jérusalem des relations fréquentes ; ces invasions mêmes n’étaient qu’une conséquence des rapports, quelquefois amicaux, plus souvent hostiles, qui s’étaient établis entre les successeurs de Godefroy de Bouillon et les khalifes d’Égypte. En 1153, les chrétiens s’emparaient de la ville d’Ascalon, qui était le boulevard des Égyptiens en face des armées de Syrie. Vers le même temps, une flotte partie des côtes de la Sicile s’empara de la ville de Tanis, non loin de la ville de Damielle. Ainsi les Occidentaux, qui, de la fin du XIe siècle jusque vers 1125, occupaient principalement les villes du nord de la Syrie et de la Syrie centrale, avaient peu à peu étendu leurs possessions, malgré bien des revers, jusqu’en Égypte. Leurs établissements, répartis sur une ligne peu profonde, mais très-allongée, s’étaient trouvés tout d’abord en contact avec les débris des arts gréco-romains et byzantins, puis, plus tard, avec ceux de la Palestine, et enfin de la basse Égypte, c’est-à-dire avec les arts des Sassanides, des khalifes, et même peut-être des Ptolémées. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que les Occidentaux furent en Orient des destructeurs de villes et de monuments bien autrement actifs que ne l’avaient été les Arabes. Ces derniers ne s’attaquaient guère aux édifices, bâtissaient peu, jusqu’au Xe siècle ; enlevaient les richesses et les populations, mais laissaient subsister les monuments. Nous en avons la preuve dans le Haouran. Mais les chrétiens d’Occident, bâtisseurs de forteresses, de remparts, ne laissaient rien debout. Il y a tout lieu de croire qu’il existait bien des édifices en Syrie, en Palestine et dans la partie nord-orientale de l’Égypte, qui furent ainsi renversés pour élever ces châteaux et ces murs dont aujourd’hui encore on trouve des débris si nombreux et si imposants. De précieux monuments pour l’étude de l’archéologie ont dû disparaître ainsi ; mais ces démolisseurs acharnés ne laissaient pas, en Orient, comme partout, de profiter des arts dont ils anéantissaient ainsi les modèles. Il y a, entre l’art de Syrie et celui de l’Égypte antique, une lacune regrettable. Notre sculpture, de 1140 à 1160, est peut-être un reflet affaibli de l’art qui s’éleva entre celui des Ptolémées et celui des Sassanides, puisqu’on retrouve dans nos monuments occidentaux des traces non douteuses de ces arts orientaux. Le mélange a pu se faire chez nous, il est vrai, mais quelques rares fragments en Syrie et dans la partie orientale de la basse Égypte feraient également supposer que cet art de transition existait des bords de la mer Morte aux bouches du Nil.
Il est certain que la sculpture romane d’ornement, vers 1140, dans l’Île-de-France notamment, et en basse Champagne, dans le pays chartrain, n’a plus les caractères gréco-romains ou byzantins si apparents au commencement du XIIe siècle, en Languedoc, en Provence, dans le Lyonnais, une partie de la Bourgogne et de la haute Champagne.

Il est un autre monument qui, par sa sculpture, mérite toute notre attention, pour préciser le moment où les artistes abandonnent les traditions romanes. C’est la cathédrale de Sens. M. Challe, au congrès scientifique d’Auxerre, en 1859, sur la question posée par M. Parker, d’Oxford, a revendiqué pour la cathédrale de Sens le titre de « premier des monuments gothiques ». D’accord avec M. F. de Verneilh, nous ne saurions partager cette opinion. Par le système d’architecture adopté, mais plus encore par le style de la sculpture, la cathédrale de Sens doit être postérieure de quelques années à l’église abbatiale de Saint-Denis.
« Il me paraît très-douteux, dit M. Félix de Verneilh[46], que l’édifice (la cathédrale de Sens) ait été commencé avant le chœur de Saint-Denis, et, dans tous les cas, il a été bâti beaucoup plus lentement. En 1163, on en parle comme d’une église « neuve ». Elle était même déjà livrée au culte, car, au lieu de consacrer le chœur entier, comme à Saint-Germain des Prés, le pape Alexandre n’est invité, à son passage, qu’à bénir un autel, celui de Saint-Pierre et de Saint-Paul. On sait, d’ailleurs, que l’évêque Hugues de Toucy, qui occupait le siège de Sens de 1143 à 1168, a « beaucoup travaillé » à la cathédrale et l’a « presque achevée » ; qu’il y a notamment fait poser les stalles de chêne, après l’achèvement du chœur de l’église que « le bon Henri avait commencé. » — Mais le chroniqueur qui s’exprime ainsi vivait en 1294. À cette distance, il pouvait ignorer si l’archevêque Henri de France avait commencé la cathédrale au début ou à la fin de son administration, ou même s’il restait quelque chose de ses constructions. Pour Henri comme pour Hugues, on mentionne la part qu’ils ont prise à l’édification de la cathédrale, immédiatement après leur élection. C’est leur principale œuvre, celle que l’on cite la première. Un autre chroniqueur, cette fois à peu près contemporain, car il s’arrête à 1173, se borne à dire : 1122. Obiit Daimbertus, successit Henricus. Hic incipit renovare ecclesiam sancti Stephani. Eidem successit Hugo 1143.
On est donc libre de croire que, loin d’avoir été commencée vers 1122 ou 1124, la cathédrale de Sens n’a été réellement fondée que dans les dernières années de Henri de France, ou, ce qui revient au même, qu’elle n’est sortie de terre qu’à cette époque. »
Nous ajouterons que le système de structure, les profils (détail si essentiel pour constater une date précise), ne sauraient appartenir à 1124, ni même à 1130, date de la construction du narthex de Vézelay ; que la sculpture, enfin, est plus avancée que celle de l’église de Suger dans la voie tracée, c’est-à-dire qu’elle tend davantage à imiter les objets naturels et à s’affranchir des influences auxquelles les romans s’étaient soumis de 1090 à 1140. On ne saurait douter de la lenteur apportée dans la construction de la cathédrale de Sens, quand on examine les œuvres hautes. Les chapiteaux des arcs-doubleaux des grandes voûtes, ceux du triforium, sont déjà empreints, en grande partie, de l’imitation de la flore, et rappellent, par leur composition, les chapiteaux de l’Île-de-France de 1170, tandis que ceux de l’arcature des collatéraux du chœur ne laissent apparaître l’imitation des objets naturels, feuilles ou animaux, que par exception.

Ainsi, le chapiteau de l’arcature du chœur que nous donnons ici (fig. 49) s’éloigne plus des formes romanes que ceux de l’église de Suger ; il est plus adroitement évasé, plus délicat ; ses feuillages, bien qu’innaturels, et rappelant encore le faire de la sculpture gréco-romaine, sont plus libres, plus souples. Puis les oiseaux qui surmontent les feuillages ne sont plus des volatiles fantastiques, si fréquents dans les sculptures de 1130 : ce sont des perdrix copiées avec une attention minutieuse ; l’allure, le port de ces oiseaux, sont observés même avec une extrême délicatesse.
Sans monter jusqu’au triforium, la plupart des chapiteaux portant les arcs collatéraux du chœur de Saint-Étienne de Sens affectent des formes de feuillages qui appartiennent presque à l’époque de la basse œuvre du chœur de Notre-Dame de Paris, c’est-à-dire à 1160. La figure 50 donne l’un de ces chapiteaux, qui n’a plus rien du roman.


Mais si nous portons toute notre attention sur le deuxième fragment (fig. 52), on y trouve déjà ce style que nous avons vu adopter dans les reprises de la salle capitulaire de Vézelay en 1160. Même imitation, quoique plus archaïque, de la feuille d’ancolie, mêmes découpures arrondies, même modelé, tantôt en saillie, pour exprimer les revers, tantôt en spatule, pour exprimer le dedans des feuilles[49]. Les tiges ne sont plus, comme celles de l’exemple précédent, côtelées régulièrement, mais sont nervées en longues spirales, ce qui indique une étude attentive de la nature ; car si l’on contourne une tige nervée, ou cette tige se brise, ou ses nervures décrivent forcément des spirales pour se prêter à la courbe qu’on impose à leur faisceau. Les attaches des tigettes sont bien senties, cherchant le naturel. Ce bel ornement ne saurait être antérieur à celui de Saint-Denis ; il en est le développement, l’observation de la nature aidant. La date de l’ornement de Saint-Denis n’est pas douteuse, 1137 à 1140. La date de la reprise faite à la salle capitulaire de Vézelay ne peut varier qu’entre les années 1155 et 1165 ; puisque cette salle capitulaire était bâtie après le narthex, qui date de 1130 à 1132, et qu’entre les années 1135 et 1155 les moines de l’abbaye eurent bien autre chose à faire qu’à bâtir. D’ailleurs, le caractère de l’architecture de cette salle capitulaire ne permet pas de placer sa construction, ni avant 1155, ni après 1165. Donc, admettant même que la reprise dont nous parlons ait été faite immédiatement après l’achèvement de la salle capitulaire, ce qui n’est guère vraisemblable, vu la différence marquée du style, elle ne pourrait dater que de 1160 à 1165 au plus-tôt. Le rinceau de Sens (fig. 52), se rapprochant beaucoup du style des chapiteaux et archivoltes (fig. 46 et 47), quoique d’un caractère un peu plus archaïque, ne pourrait remonter plus loin que l’année 1155 ; mais nous sommes porté à lui donner une date plus récente (1165 à 1170), si nous le comparons à l’ornementation de la Bourgogne, de la basse Champagne et de l’Île-de-France, dont la date est bien constatée.
Il est certain qu’une école n’arrive pas à composer des ornements avec cette adresse et cette entente de l’effet du premier coup. La beauté, un peu travaillée, des compositions byzantines, avait été un enseignement assez puissant pour donner à nos artistes une première impulsion ; quand ils mêlent à cet acquis l’étude de la nature, ils arrivent, par une transition rapide, mais que l’on peut suivre année par année, à un développement de l’art décoratif qui tient du merveilleux.
Dans le rinceau de Sens, à côté de l’observation de la nature, on sent encore comme un dernier reflet de l’influence orientale. Les détails, malgré l’entente parfaite de la composition, sont trop multipliés, et cette ornementation conviendrait plutôt à du métal fondu et ciselé qu’à de la pierre. Le sentiment de l’échelle, de la grandeur, n’est pas encore développé ; on sent la recherche de l’artiste tout entier à son œuvre, mais qui ne reçoit pas encore l’impulsion supérieure propre à faire concourir tous les détails d’un édifice à un effet d’ensemble.
Du moment que la sculpture d’ornement n’était plus un art tout de convention, reproduisant des types traditionnels ou enfantés par des réminiscences d’arts antérieurs, qu’elle allait puiser ses inspirations dans la flore, une harmonie plus parfaite pouvait s’établir entre les détails et l’ensemble. L’identité de nature des éléments constitutifs donnait aux artistes des facilités nouvelles pour obtenir cette harmonie cherchée vainement par les diverses écoles pendant les deux premiers tiers du XIIe siècle. L’esprit contenu et ennemi de toute exagération des artistes de l’Île-de-France était d’ailleurs propre à profiter des ressources que fournissait le recours aux productions végétales. C’est bien dans ce centre futur de la nation française que se développe avec rapidité ce nouvel art de la sculpture décorative, dont nous avons fait ressortir l’influence à l’article Flore, et dont on ne retrouve guère d’exemple aussi complet que dans l’art de l’antique Égypte.
Il semble que l’école laïque française de la fin du XIIe siècle veuille en finir avec les traditions accumulées pendant la période romane. En peu d’années, tout ce qui n’est point inspiré par la flore dans la sculpture d’ornement disparaît : plus de perles, plus de ces imitations de passementeries et d’entrelacs, plus de billettes, plus de rangées de ces feuilles d’eau imitées des monuments antiques. La flore, et la flore locale, domine désormais et est le point de départ de l’école. S’il y a des résistances à cet entraînement, elles sont si rares, si apparentes, qu’elles ne font que confirmer l’impulsion donnée. Ce sont évidemment des œuvres d’artistes attardés. Ainsi, bien que le chœur de la cathédrale de Senlis n’ait été construit que de 1150 à 1165 ; qu’à cette époque déjà, à Sens, à Noyon, les sculpteurs cherchassent à s’inspirer de la flore, on peut reconnaître, dans la sculpture de ce chœur de Senlis, le travail d’artistes ne s’étant pas encore pénétrés des idées nouvelles alors. La sculpture des chapiteaux des chapelles et du sanctuaire est presque byzantine (fig. 53)[50], sinon par la forme générale, au moins par les détails.
En adoptant un principe nouveau, étranger aux traditions, quant à la composition des détails de l’ornementation, l’école laïque de l’Île-de-France donne à la sculpture sa place. Désormais elle ne se répand plus au hasard et suivant la fantaisie de l’artiste sur les monuments, ainsi que cela n’arrivait que trop souvent dans l’architecture romane. Elle remplit un rôle défini aussi bien pour la statuaire que pour l’ornement. Si riche que soit un monument, l’artiste a le soin de laisser des repos, des surfaces tranquilles. La sculpture se combine avec la structure, aide à la faire comprendre, semble contribuer à la solidité de l’œuvre. Nous avons dit, dans l’article Chapiteau, comment les artistes de l’école laïque, à son origine, les composent de façon à leur donner non-seulement l’apparence de supports robustes, mais à rendre leur décoration utile, nécessaire. Pour les bandeaux, pour les corniches, pour les encorbellements, ce principe est suivi avec rigueur, et ce n’est pas un des moindres mérites de cette architecture française, logique dans sa structure, mais logique aussi dans la décoration dont elle est revêtue, sobre toujours, puisqu’elle ne place jamais un ornement sans qu’il soit, pour ainsi dire, appelé par une nécessité.
On peut recourir aux articles Bandeau, Chapiteau, Clef, Corbeau, Corniche, Crochet, Cul-de-lampe, Fleuron, Galerie, Griffe, Tapisserie, Tympan, si l’on veut constater le judicieux emploi de la sculpture dans les monuments de l’école laïque de 1170 à 1230. Il n’est pas de symptôme plus évident de la stérilité d’idées de l’architecte que l’abondance irraisonnée de la sculpture. L’ornementation sculptée n’est, le plus habituellement, qu’un moyen de dissimuler des défauts d’harmonie ou de proportions, qu’un embarras de l’architecte. En occupant ou croyant occuper ainsi le regard du passant, on dissimule des pauvretés ou des défauts choquants dans la composition, voire des maladresses et des oublis dans la structure.
Sincères, les maîtres de notre belle époque d’art raisonnaient l’emploi de l’ornementation comme de toute autre partie essentielle de la bâtisse ; cette ornementation n’était point pour eux un masque jeté sur des misères et des vices de la conception. Sachant bien ce qu’ils voulaient dire, et ayant toujours quelque chose à dire, ils ne cachaient pas le vide des idées sous des fleurs de rhétorique et des lieux communs. Souvent la sculpture d’ornement est si bien liée aux formes de l’architecture, qu’on ne sait où finit le travail du tailleur de pierre, où commence celui du sculpteur. Le sculpteur, comme le tailleur de pierre, concouraient à l’œuvre ensemble, sans que l’on puisse établir une ligne de démarcation entre les deux ouvrages. Ces sculptures d’ornement étaient d’ailleurs toujours faites sur le chantier avant la pose, et non sur le tas. Il fallait donc que le maître eût combiné tous ses effets, avant que la bâtisse fût élevée, en raison de la place, de la hauteur, de l’échelle adoptée. Cette méthode avait encore l’avantage de donner à la sculpture une variété dans le faire, attrayante ; de permettre de l’achever avec plus de soin, puisque l’artisan tournait son bloc de pierre à son gré ; d’éviter l’aspect monotone et ennuyeux à l’excès, de ces décorations découpées comme par une machine, sur nos façades modernes. Chaque artisan était intéressé ainsi à ce que son morceau se distinguât entre tous les autres par une exécution plus parfaite ; et, en effet, sur nos monuments du moyen âge de l’école laïque, on remarque toujours, — comme cela arrive dans les beaux monuments de l’antiquité, — certains morceaux d’une frise, d’une corniche, certains chapiteaux, qui sont, entre tous les autres, d’une exécution supérieure. Soumis à la structure, jamais un joint ou un lit ne vient couper gauchement un ornement ; cela était impossible, puisque le travail du sculpteur se faisait avant la pose. Rien n’est plus satisfaisant pour l’esprit et pour l’œil que cette concordance parfaite, absolue, entre l’appareil et la sculpture ; rien ne donne mieux l’idée d’une œuvre bien mûrie et raisonnée, d’un art sûr de ses méthodes et de ses moyens d’exécution. En voyant comme sont composés, par exemple, les angles des contre-forts de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris au niveau de la grande galerie, comme ces larges crochets, ces animaux, cette corniche et sa balustrade surmontée de figures, se combinent intimement avec les lignes de l’architecture, forment une silhouette hardie sur le ciel, on peut se demander si jamais l’art de la grande décoration monumentale a été poussé plus loin ; si jamais union plus complète exista entre les deux arts de l’architecture et de la sculpture pour produire un effet voulu, et bien voulu à l’avance, puisque tous ces énormes blocs de pierre étaient taillés sur le chantier avant d’être posés à près de 40 mètres de hauteur. En présence de pareils résultats, ne paraissons-nous point de pauvres apprentis montant nos bâtisses un peu à l’aventure, et cherchant à les décorer après coup à l’aide d’un essaim de sculpteurs attachés à leurs parois ; défaisant ce que nous avons fait, rajoutant des contre-forts par ici, des groupes par là, ou les supprimant pour les remplacer par des pots ou des ornements qui remplissent tous les livres à gravures imprimés depuis deux siècles !
Nous disions tout à l’heure que l’école de sculpture de la fin du XIIe siècle, en cherchant dans la flore les éléments d’une ornementation nouvelle, originale, savait donner à ses imitations un aspect monumental monumental éloigné encore du réalisme. Ces essais sont déjà systématiquement suivis dans l’œuvre basse du chœur de la cathédrale de Paris pour tous les chapiteaux des colonnes isolées monostyles, tandis que ceux des colonnes engagées du deuxième bas côté sont encore pénétrés du style roman de 1140.

La manière grasse adoptée dans l’exécution, la courbure délicatement rendue des tiges, l’abondance de sève qui semble engorger cette végétation de pierre, tout cela est évidemment le résultat d’une observation passionnée des végétaux. Et c’est bien à Notre-Dame de Paris que s’épanouit tout d’abord cette plantureuse flore monumentale. Partout ailleurs, à la même époque, c’est-à-dire de 1163 à 1170, ou nous trouvons des imitations délicates et recherchées de la flore des champs, comme sur les ornements de Sens et de la salle capitulaire de Vézelay, ou ce sont des imitations de ces ornements gréco-romains plus ou moins bien comprises. Les sculpteurs de Notre-Dame ont été puiser leurs inspirations aux champs, et composent ainsi un style qui est généralement adopté dans tout le nord de la France jusqu’aux premières années du XIIIe siècle.
Bientôt l’école de l’Île-de-France ne se contente plus de ces ornements empruntés à la flore printanière, elle développe les bourgeons de pierre ; mais en prenant la feuille, l’allure du végétal ayant atteint son développement, elle conserve à ses traductions la physionomie monumentale.

Pour nous, l’apogée de la sculpture d’ornement comme de la statuaire du moyen âge, se trouve placé à ce moment où la tradition romane a disparu, et où la recherche de la réalité n’a pas encore imposé ses exigences. Cette période brillante de l’école française dure vingt-cinq ans environ, de 1190 à 1215. C’est l’époque de la construction de la nef et de la partie inférieure de la façade de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale de Laon, de l’œuvre basse du chœur de la cathédrale de Rouen, d’une partie de celle de Lisieux, des chœurs des églises abbatiales de Saint-Remi de Reims, de Saint-Leu d’Esserent, d’Eu, de Vézelay, etc.
Il y eut en effet, à ce moment, un développement d’art merveilleux. La nouvelle école étendait son influence dans toute la partie de la France au nord de la Loire, de la Bourgogne et du Nivernais aux confins du Maine. Mais, cependant, chaque province conservait quelque chose de son originalité. La sculpture décorative, tout en suivant une impulsion générale, se développait suivant les aptitudes particulières à chaque contrée. Large, plantureuse dans l’Île-de-France, énergique et serrée en Bourgogne, la sculpture était délicate et recherchée dans le Maine et la Normandie.
Les conditions de liberté pour les artistes, en tant qu’artistes, ne sont point celles du citoyen. Un état social peut être très-oppressif pour le citoyen, mais très-favorable au développement de la liberté chez l’artiste. La réciproque a lieu. Quand les artistes, dans la société, forment une sorte de caste dont tous les membres sont égaux, ils se trouvent dans les meilleures conditions du développement libre de l’art. Comme caste, ils acquièrent au sein de l’ordre civil, — surtout s’il est divisé comme l’était l’ordre féodal, — une prépondérance marquée. Comme individu, le principe de toute caste étant l’égalité entre les membres qui en font partie, le contraire de la hiérarchie, l’artiste conserve une liberté d’action dont nous sommes aujourd’hui fort éloignés.
L’école laïque d’artistes s’était formée dès la seconde moitié du XIIe siècle, c’était une conséquence naturelle du développement de l’esprit municipal, si puissant à cette époque. Les règlements qui furent rédigés au XIIIe siècle pour donner une existence légale aux corporations sont la preuve que ces corporations fonctionnaient, car jamais la loi ne précède le fait ; elle le reconnaît et le règle lorsqu’il a produit déjà des conséquences dont l’étendue peut être appréciée. Une fois sorti des monastères, l’art se fixait dans des ateliers, dans certaines familles, dont les membres, comme artistes, n’étaient et ne pouvaient être soumis à aucune hiérarchie. Ces ateliers, ces familles se réunissaient, discutaient les intérêts collectifs de la corporation, les établissaient en face de l’ordre féodal, mais n’avaient et ne pouvaient avoir la prétention d’imposer des méthodes d’art au milieu d’elles, car ces chefs d’atelier étaient sur le pied d’égalité parfaite entre eux et n’étaient point pourvus de fonctions ou de dignités de nature à leur donner une autorité prépondérante dans la corporation. On comprend comment un pareil état social devait être favorable au développement et au progrès très-rapide de l’art. L’expérience ou le génie de chaque membre éclairait la corporation, mais n’imposait ni des doctrines ni des méthodes. Aussi l’art de cette époque est-il bien le fidèle miroir de cet état social des artistes. Une expérience réussit-elle, aussitôt on la voit répandre ses résultats, et être immédiatement suivie d’un perfectionnement ou d’une tentative nouvelle. Il est bien certain, — et nous en avons la preuve au XIIIe siècle, — que l’art était pratiqué dans certaines familles, le père instruisait son fils ou son neveu. Les connaissances se transmettaient ainsi dans des corporations composées d’un nombre de membres ayant tous les caractères de la caste. Ces connaissances considérées comme le privilège de la caste n’étaient point divulguées dans le public ; et leur transmission non interrompue dans l’atelier ou la famille, du patron à l’apprenti, du père au fils, explique comment nous ne possédons aucun traité écrit sur les matières d’art en France de la fin du XIIe siècle au XVIe. Des moines pouvaient écrire ces traités, et nous en possédons un, celui de Théophile, qui date du milieu du XIIe siècle très-vraisemblablement, s’occupant de la peinture, des vitraux, de l’orfèvrerie, de la menuiserie, etc. ; d’autres avaient dû être écrits dans les monastères, parce qu’il s’agissait de transmettre des méthodes, soit d’un couvent à l’autre, soit dans des écoles séparées du monastère. Mais les membres laïques des corporations d’artistes ou d’artisans, non-seulement n’avaient nul besoin de mettre sur le papier le résultat de leur expérience et de leur savoir, mais devaient éviter même de rien écrire, pour ne pas donner au vulgaire les recettes, les méthodes admises dans l’atelier. L’album de Villard de Honnecourt, qui date de 1250 environ, n’est qu’un cahier de notes prises partout et sur tout, depuis des procédés de tracés jusqu’à des recettes pour faire des onguents, mais n’a pas le caractère d’un traité destiné à perpétuer des méthodes ou des moyens pratiques. Villard discute, il pose des questions ; son cahier est un memento, pas autre chose.
Cet état social des artistes laïques à la fin du XIIe siècle, connu, nous démontre comment ces corporations devaient nécessairement agir dans une sphère absolument libre ; car, à moins de supprimer la corporation, comment lui imposer un goût, des méthodes ? Force était d’accepter ce qu’elle voulait faire, de suivre le style, les procédés qu’il lui plaisait d’adopter, et dont elle discutait la valeur au sein de son organisation toute républicaine, où les voix n’avaient qu’une autorité purement morale, due à une longue expérience, au génie ou au simple mérite personnel. Une organisation pareille pouvait seule changer en quelques années la face des arts, sans qu’aucun pouvoir, ou civil, ou ecclésiastique (en eût-il eu la volonté), fût en état d’arrêter le mouvement donné. Mais ce qui imprime un caractère d’une grande valeur nationale à cet établissement des écoles laïques du XIIe siècle, c’est que leur premier soin est de rompre avec le passé : que ce passé soit le romain, dont les monuments ne manquaient pas en France, qu’il soit le roman plus ou moins imprégné des arts gréco-romains ou syriaques, les écoles laïques le repoussent comme structure, comme aspect des masses, comme proportions, comme décoration. Nous ne croyons pas utile, arrivé au huitième volume de ce Dictionnaire, de répondre à l’objection faite parfois : que les artistes gothiques n’ont pas copié l’architecture romaine parce qu’ils étaient hors d’état de l’imiter, trop ignorants pour en comprendre la valeur. Ce qu’ils tentaient et ce qu’ils obtinrent, était bien plus savant que ne l’eût été une imitation des arts romains. D’ailleurs, après l’art roman, il était plus facile de retourner franchement au romain, qui en diffère si peu, que de s’en écarter. Si l’école s’en éloignait plus que jamais, si elle rompait même avec les traditions des arts antiques fusionnés dans le roman, c’est qu’elle en avait la volonté, et que cette volonté s’appuyait sur une raison supérieure à toute autre.
Voilà ce qu’il faut bien constater, si l’on veut comprendre quelque chose à ce mouvement d’art de la fin du XIIe siècle. C’était une réaction active, violente, aussi bien contre l’antique domination romaine que contre le système théocratique et le système féodal. Cette école, une fois maîtresse dans le domaine de l’art, entendait que rien, dans les arts, ne devrait rappeler un passé dont on ne voulait plus. Aussi, avec quel empressement les grandes villes du Nord s’empressent de jeter bas leurs vieilles cathédrales pour en bâtir de nouvelles ! Rien ne leur coûte pour effacer la dernière trace de cet art roman développé au sein des établissements monastiques !
Qu’alors les évêques, les seigneurs, ne l’aient pas entendu ainsi, que les populations des villes n’aient pas précisé leur pensée avec cette rigueur, cela est certain : mais les monuments sont là ; leur caractère, les détails dont ils se couvrent, leur structure, parlent pour ces premières corporations d’artistes et d’artisans laïques, qui certes n’ont pas, par l’effet du hasard, et sans une raison bien mûrie, rompu brusquement avec tout un passé. La franc-maçonnerie, le compagnonnage des charpentiers, sont un dernier débris de ces associations laïques, sortes d’initiations dont les résultats, longtemps présentés comme l’expression de la barbarie et de l’ignorance, ne sont, à tout prendre, que le symptôme manifeste des premiers efforts d’une nation qui se reconnaît après tant d’asservissements successifs, veut se constituer, et date son affranchissement, le retour de son esprit national, sur des monuments dus à son propre génie et n’empruntant plus rien aux siècles antérieurs. Aussi ne signaient-ils que bien rarement leurs œuvres, ces premiers maîtres de l’école laïque. À quoi bon ? ils laissaient sur ces monuments l’empreinte du génie national débarrassé de tant de traditions décrépites, et cette signature a sa valeur.
Si ces artistes, après avoir établi un principe de structure neuf, après avoir soumis logiquement à ce principe tout un système de proportions, de profils, de tracés, avaient conservé quelque chose de la décoration romane, aux yeux de la foule ils étaient liés encore à l’art roman. Aussi ne font-ils nulle concession : l’ornementation romane n’existe plus, et pour en constituer une nouvelle, ils étudient curieusement les végétaux qui croissent dans les champs et dans les bois. La statuaire romane est reléguée dans le passé ; ils observent la nature et la considèrent sous un aspect nouveau : ce n’est pas seulement la forme plastique qu’ils cherchent à reproduire en l’idéalisant, c’est le sentiment moral de l’individu.
Une fois sur cette voie, si rigoureuse que fût la constitution de la corporation, son organisation toute républicaine devait la pousser sans arrêts vers le progrès. Malheureusement, dans les choses d’art, le progrès, en nous élevant promptement à l’apogée, nous en fait descendre ; la sculpture, comme chez les Grecs, après avoir idéalisé la nature, veut sans cesse s’en rapprocher et tombe dans la recherche de la réalité. Cependant il arrive à cette école ce qui arrive à toutes les constitutions basées sur la liberté de la pensée, même lorsque celle-ci recherche la quintessence en toute chose, et abandonne l’idéal, toujours un peu vague, pour le réel : longtemps l’art se maintient à une grande hauteur, et jamais l’exécution ne tombe dans la barbarie ; car la barbarie dans la conception ou même dans l’exécution des œuvres d’art, arrivant après une période de splendeur, est toujours la conséquence de l’asservissement de la pensée. Nous en avons la triste preuve dans les monuments romains. À la fin de l’empire, sans qu’il y ait eu interruption dans les travaux, sans que l’enseignement d’art fût supprimé, sans qu’on eût cessé un seul jour de sculpter ou de bâtir, l’exécution est tombée si bas, qu’elle n’inspire plus que le dégoût, et fait presque désirer l’irruption de véritables barbares, mais jeunes, vigoureux et ayant l’avenir devant eux, pour effacer les traces de ces arts séniles qui ne sauraient plus rien produire.
Pendant que l’école de l’Île-de-France opérait cette révolution radicale dans l’art de la sculpture, celle de la haute Champagne, celle du Poitou, flottaient entre les traditions romanes et ces innovations, dont elles ne comprenaient pas l’importance ; ces provinces avaient d’ailleurs élevé l’art roman à un degré de perfection supérieur, soit comme structure, soit comme décoration, et n’abandonnaient qu’avec peine les méthodes ou le style d’ornementation qui avaient laissé de nombreux exemples dans le pays. Ainsi, à Poitiers, les parties de la cathédrale bâties pendant les dernières années du XIIe siècle font apercevoir des réminiscences non douteuses de la sculpture décorative gréco-romaine de Syrie, à côté d’ornements empruntés à la flore locale. Les chapiteaux des grandes arcatures des collatéraux de la nef, bâtis de 1190 à 1205, présentent cette juxtaposition des deux styles.
Quant à l’école de la haute Champagne, qui comprenait les départements de la Haute-Marne, de la Haute-Saône et d’une partie de la Côte-d’Or, son centre était à Langres. Cette école avait adopté de bonne heure un style de sculpture qui se rapprochait sensiblement du style bourguignon, mais avec une dose de traditions gallo-romaines plus prononcée. Possédant de beaux matériaux, cette contrée élève des édifices dont l’exécution est généralement fort bonne. Son architecture suit la chaîne de plateaux élevés qui s’étend de Langres même jusqu’à Lyon, en passant par Saulieu, Beaune, Autun, Paray-le-Monial et Charlieu. Mais, sur cette ligne, on peut distinguer deux écoles de sculpture : celle de la haute Champagne, dont le foyer est à Langres, qui continue assez tard les traditions romaines, et celle de la Bourgogne, qui s’en affranchit promptement. Toutefois, en suivant le style roman, l’école de sculpture de la haute Champagne est évidemment, à la fin du XIIe siècle, stimulée par les progrès des écoles de l’Île-de-France et de Troyes, et cherche une exécution plus large, un modelé plus savant et plus ferme, sans recourir franchement à la flore. Ces ornements (fig. 57 et 58), qui proviennent de la cathédrale de Langres (fin du XIIe siècle), indiquent l’indécision de cette école, balançant entre les traditions romanes et les nouveaux principes admis par les sculpteurs de l’Île-de-France.




En tant qu’exécution, le caractère monumental est observé dans l’un et l’autre de ces exemples ; comme composition dans un même vaisseau, le caractère monumental, qui tient essentiellement à l’observation de l’échelle, n’est pas respecté. Dans aucun édifice de l’Île-de-France et de la même époque, à Notre-Dame de Paris, à Laon, à Saint-Quiriace de Provins ; etc., on ne pourrait signaler ce mépris pour l’échelle. Mais si nous nous en tenons à l’habileté de l’artiste, aucune école ne surpasse l’école bourguignonne. C’est une grandeur dans le tracé, une ampleur dans le modelé, une délicatesse dans le coup de ciseau, dont rien n’approche à cette époque. D’ailleurs, cette école ne taille jamais ses ornements que dans la pierre dure ; elle abandonne les matériaux tendres vers 1180 pour ne les reprendre que vers 1230. La pierre tendre, même fine, pouvait difficilement se prêter, en effet, à la taille précise de cette sculpture qui peut être comparée, comme netteté, à la belle ornementation grecque sur marbre, et qui a sur celle-ci l’avantage d’être plus large et mieux entendue comme effet décoratif. Nous ne savons si les Grecs ont fait de la sculpture d’ornement à une grande échelle, ample, comme composition, puisque les seuls exemples qui nous restent, provenant de monuments petits généralement, paraîtraient maigres et plats, appliqués à nos édifices. Mais quant au faire, le ciseau des praticiens de nos meilleures écoles françaises de la fin du XIIe siècle égale la pureté du ciseau grec.
Produire un effet voulu à l’aide des moyens les plus simples et les moins dispendieux, est certainement le problème qu’ont à résoudre les architectes de tous les temps. Trouver un système d’ornementation qui prête son concours à l’architecture, qu’il s’agisse d’un humble édifice, aussi bien que d’un palais ou d’une cathédrale pour une grande ville, c’était mettre l’art à la portée de tous et n’en pas faire la jouissance de quelques privilégiés. Or, si l’on prend la peine de parcourir deux ou trois de nos provinces, on reconnaîtra bientôt que la plus pauvre église de village, le moindre hospice appartenant à cette période de rénovation, possèdent une décoration sculpturale en parfaite harmonie avec la structure, et que cette ornementation (parfois d’une grande simplicité) a toujours l’avantage de parler aux yeux un langage connu. Dans cette sculpture, le paysan et le seigneur retrouvent des formes qui leur sont familières, des détails inspirés des plantes qui couvrent leurs champs, composés toujours avec grâce et adresse.
Disposés avec sobriété sur les parties de la construction qui se prêtent seules à les recevoir, les ornements variés, mais soumis à la loi d’unité par leur origine commune, produisent le plus grand effet possible, ne serait-ce que par le contraste entre leur richesse et la simplicité vraie de la structure au milieu de laquelle ils viennent se poser. La place donnée à un ornement est pour les neuf dixièmes dans l’effet qu’il produit, et les artistes qui, dans nos églises de la fin du XIIe siècle, sculptaient ces larges chapiteaux sur des colonnes monostyles, à une hauteur très-médiocre, savaient bien ce qu’ils faisaient. Ainsi, cette ceinture riche qui pourtournait l’édifice, en attirant l’attention, dispensait-elle de toute autre décoration ? Il suffisait de quelques rappels, de quelques points dans les parties élevées, tels que les chapiteaux à la naissance des voûtes, les clefs, pour donner à l’intérieur d’un vaisseau l’aspect de la richesse.
Quand on veut se rendre compte du rôle donné à la sculpture d’ornement dans les édifices du moyen âge de cette époque, on est fort surpris de son peu d’importance relativement à l’effet qu’elle produit, surtout si l’on compare ces édifices à ceux élevés aujourd’hui, sur lesquels la sculpture est répandue sans qu’il soit possible de donner la raison de cette profusion, ni de deviner pourquoi tel ornement est placé ici ou là, au faîte ou à la base, à l’intérieur ou à l’extérieur.
D’ailleurs, dans les monuments dus à nos belles écoles du moyen âge, l’ornementation sculptée n’est pas traitée de la même manière à l’air libre ou sous les voûtes et planchers d’une salle. Heurtée à l’extérieur, profitant de la lumière directe du soleil, elle procède par plans nettement accusés ; tandis qu’à l’intérieur, en tenant compte de la lumière diffuse, elle adopte un modelé plus doux, elle évite les trop fortes, saillies.
Du jour où l’école laïque s’emparait de la flore pour composer ses ornements sculptés, elle devait peu à peu se rapprocher de la réalité. Interprétés d’abord, les végétaux sont bientôt imités. À quelques années de distance, le progrès vers l’imitation réelle est sensible. Cette marche d’un art qui suit un développement logique est fournie d’enseignements précieux. L’ornementation primitive de l’école laïque, pendant les dernières années du XIIe siècle, d’une exécution si parfaite, d’un style si délicat, se maintenant entre les exigences monumentales et l’observation de la nature, se prête difficilement, à cause de la délicatesse même des principes admis, à la grande sculpture décorative. Charmante sur des chapiteaux, sur des jambages ou des tympans de portes, placée près de l’œil, elle perd une grande partie de sa valeur au sommet des édifices. Augmentant les dimensions des monuments au commencement du XIIIe siècle, les artistes prennent, pour leurs profils, pour leurs ornements, une échelle plus grande. C’est alors que l’on voit s’épanouir la flore sculpturale, et c’est encore par l’observation de la nature que les sculpteurs arrivent à satisfaire à ces exigences d’échelle. Car il est à remarquer que pour faire grand — nous disons grand, et non point gros — en ornementation sculptée, c’est à la nature seulement que l’on peut recourir. Toute ornementation de convention, comme est la plus grande partie de la sculpture romaine et de la sculpture romane, ne peut être grandie impunément. En augmentant l’échelle, on tombe alors dans la lourdeur, dans le difforme. Nos artistes modernes ont le sentiment de cette difficulté ; aussi l’ornementation pseudo-romaine qu’ils adoptent habituellement n’est jamais grande d’échelle, et les sculptures placées à 40 mètres du sol reproduisent le parti, le modelé et l’échelle des ornements qui décorent des soubassements.
En recourant à la flore, les maîtres d’autrefois se laissaient la ressource, non-seulement de varier à l’infini leurs compositions sans sortir de l’unité, mais d’adopter l’échelle convenable en raison de la place.
Il faut voir comme ils savent, avec une même feuille, par exemple, composer une frise de 20 ou de 60 centimètres de hauteur, et comme ils trouvent dans la nature elle-même les éléments convenables en raison des dimensions ou des situations différentes. À ce point de vue, la sculpture d’ornement de la façade de Notre-Dame de Paris est une œuvre de génie, bien que cette façade n’ait pas été bâtie d’un seul jet. En s’élevant sur l’édifice, l’ornementation grandit d’échelle et se simplifie singulièrement quant à la façon d’interpréter la flore ; car nous observerons que par une loi qui ne souffre pas d’exceptions pendant la première moitié du XIIIe siècle, plus l’échelle de la sculpture d’ornement est grande, plus les détails sont sacrifiés aux masses. Nous avons fait cette observation déjà à propos de la statuaire. L’ornement petit, placé près de l’œil, est très-détaillé, très-finement modelé ; l’ornement colossal est simple, large, les masses sont accentuées, les saillies vivement senties.



Cet exemple est remarquable à plus d’un titre. Il n’est point aisé déjà pour le dessinateur de combiner ce mélange de formes architectoniques, d’ornements et d’animaux ; mais le dessin donné, il est encore moins facile de le faire interpréter par des exécutants, puisque cette composition mise en place a demandé le concours de l’appareilleur, du tailleur de pierre, du sculpteur d’ornements et de figures, du bardeur, et enfin du poseur. Les morceaux sculptés ou non sculptés étant tous terminés avant la pose, — ne l’oublions pas, — il n’est point nécessaire d’être versé dans la pratique du bâtiment pour comprendre les difficultés de montage et de mise en place d’un sommier de cette taille, — car il ne cube pas moins de 1m,50, — ne présentant pas de prise, puisque toutes ses faces sont parementées et que celle de devant est couverte de sculptures très-saillantes. Avec nos engins perfectionnés, nous ne parvenons pas toujours à placer des pierres simplement épannelées, sans épaufrures. Comment donc s’y prenaient ces bâtisseurs du moyen âge pour élever et placer de pareils blocs complétement achevés, sans endommager les moulures et les reliefs ? Comment les préservaient-ils pendant l’exécution des parties supérieures ? Il y a là matière à méditations, surtout si l’on considère la rapidité extraordinaire avec laquelle certains édifices étaient élevés[54].
C’est à cette époque, au moment du développement de l’école laïque, de 1210 à 1230, que l’ornementation s’identifie pleinement avec l’architecture. Les façades des cathédrales de Paris, d’Amiens (œuvre ancienne), certaines parties de Notre-Dame de Chartres, de la cathédrale de Laon, les tours de la façade occidentale notamment, montrent avec quelle entente de la composition les maîtres savaient rattacher la sculpture à l’architecture, et avec quelle adresse les ouvriers interprétaient les conceptions de leurs patrons.
Il existait alors plusieurs séries d’ouvriers façonnés à ce travail qu’aujourd’hui nous obtenons avec les plus grandes difficultés. Il y avait les tailleurs de pierre ordinaires, tâcherons, qui, sur le tracé de l’appareilleur, taillaient les pierres à parement simple ; des ouvriers plus habiles faisaient les profils avec moulures ; puis venaient les tailleurs d’images, qui taillaient et sculptaient les pièces comme celles que nous présente la figure 63. Mais tous ces ouvriers de mérite différent entendaient le trait, chose que nos sculpteurs d’aujourd’hui ne savent pas généralement. On a la preuve de cette façon de procéder : 1o par les marques de tâcherons, 2o par la nature de la taille ou du brettelage, qui diffère dans les trois cas. Les marques de tâcherons des profils, dans le même édifice, ne sont point celles des tâcherons de parement. Quant aux morceaux portant sculpture, la bretture est beaucoup plus fine, et surtout moins large ; puis ils sont dépourvus de signes. L’épannelage de ces morceaux était préparé par les tailleurs de pierre ordinaires, ce que démontrent certains fragments non sculptés et posés tels quels par urgence.
Il ne paraît pas que les tailleurs d’images se servissent de modèles ; car, dans les représentations de ces sortes de travaux, qu’on retrouve sur des vitraux, dans des vignettes de manuscrits et des bas-reliefs, on ne voit jamais de modèles figurés, mais des panneaux. D’ailleurs, ces sculpteurs ne répétant jamais exactement le même motif, il est évident qu’ils ne suivaient point un modèle. Dans des ornements courants mêmes, comme des feuilles ou crochets de bandeaux et corniches, chaque ornement est traité suivant la largeur de la pierre, et sur vingt feuilles, semblables comme type, il n’en est pas deux qui soient identiques.
Pour ces ornements courants, on voit comment on procédait. Un maître faisait une feuille, un crochet, un motif enfin, destiné à être répété sur chaque morceau ; puis, des ouvriers copiaient librement ce type. Cette méthode est dévoilée par la présence de morceaux exécutés entre tous avec une rare perfection et par des mains habiles. Lorsqu’il s’agissait de ces pièces exceptionnelles, comme de grands chapiteaux, ou des gargouilles, ou des compositions un peu compliquées, prenant une certaine importance, elles étaient confiées à ces maîtres tailleurs d’images. Beaucoup de sculptures de l’époque romane étaient faites sur le tas, c’est-à-dire après un ravalement ; ce qui est indiqué par des joints passant tout à travers les ornements et parfois même les figures. Mais l’école laïque repoussa cette méthode jusqu’au XVIe siècle, c’est-à-dire tant que les corporations conservèrent leur organisation intacte. Chaque ouvrier finissait l’objet qui lui était confié. Jamais un tailleur de pierre ou un tailleur d’images ne montait sur le tas. Il travaillait sur son chantier, terminait la pièce, qui était enlevée par le bardeur et posée par le maçon, qui seul se tenait sur les échafauds. On ne peut disconvenir qu’une pareille méthode dût donner aux contre-maîtres plus de facilités pour mettre de l’ordre dans le travail, dût éviter les encombrements, par conséquent les chances d’accident, et permît une grande rapidité d’exécution, du moment que l’organisation première était bonne, et que l’architecte avait tout prévu d’avance : or, il fallait bien qu’il en fût ainsi, pour que ces rouages pussent fonctionner. Sous ce rapport, il n’y a pas à tirer vanité des progrès que nous avons faits.
C’est au moment de l’épanouissement de l’école laïque, que les animaux, si fréquents dans l’ornementation romane, délaissés dans la sculpture de la fin du XIIe siècle, reparaissent dans la décoration extérieure des édifices. À côté de la flore, ils forment une faune ayant sa physionomie bien caractérisée. Les animaux figurés dans la sculpture de 1210 à 1250 sont de deux sortes : les uns sont copiés sur la faune locale, et sur quelques espèces dont, par luxe, les grands seigneurs gardaient des individus dans leurs palais, tels que lions, panthères, ours, etc. ; les autres appartiennent au règne fabuleux si bien décrit dans les bestiaires. C’est le griffon, la wivre, la caladre, la harpie, la sirène, le basilic, le phénix, le tiris, le dragon, la salamandre, le pérédexion, animaux auxquels ces bestiaires accordaient les qualités ou les instincts les plus étranges. Pourquoi ces animaux réels ou fabuleux venaient-ils ainsi se poser sur les parements extérieurs des édifices, et particulièrement de nos grandes cathédrales ? Il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons dit précédemment à propos des tendances de l’école laïque qui élevait ces monuments. Ceux-ci étaient comme le résumé de l’univers, un véritable Cosmos, une encyclopédie, comprenant toute la création, non-seulement dans sa forme sensible, mais dans son principe intellectuel. Là encore nous retrouvons la trace effacée, mais appréciable encore, du panthéisme splendide des Aryas. Le vieil esprit gaulois perçait ainsi à travers le christianisme, et revenait à ses traditions de race, en sautant d’un bond par-dessus l’antiquité gallo-romaine. Le dogme chrétien domine, il est vrai, toutes ces traditions conservées à l’état latent à travers les siècles ; il les règle, il s’en empare, mais ne peut les détruire. Les bestiaires, qui furent si fort en vogue à la fin du XIIe siècle et jusque vers le milieu du XIIIe, au moment même où l’école laïque se développait, ces bestiaires qui se répandent sur nos cathédrales et participent au concert universel, semblent être une dernière lueur des âges les plus antiques de notre race. Tout cela est bien corrompu, bien mélangé des fables de Pline et des opinions de la dernière antiquité païenne, mais ne laisse pas moins percer des traditions locales et beaucoup plus anciennes. Ce n’est point ici le lieu de discuter cette question, nous ne devons nous occuper que du fait : or, le fait, c’est le développement de ces bestiaires à l’extérieur de nos grandes cathédrales, sur ces monuments où tout l’ordre naturel et surnaturel, physique et immatériel, se développe comme dans un livre.
D’après les bestiaires des XIIe et XIIIe siècles, chacun des animaux qui s’y trouvent figurés est un symbole. Ainsi, par exemple le phénix, qui se consume en recueillant les rayons du soleil et renaît de ses cendres, représente Jésus-Christ se sacrifiant sur la croix et ressuscitant le troisième jour. Le phénix est décrit par les anciens, mais il est difficile de ne pas reconnaître dans ce mythe l’Agui des Védas. Que parmi tant d’éléments d’art laissés par l’antiquité romaine, l’école laïque du XIIIe siècle ait été recueillir particulièrement ces animaux fabuleux, leur ait donné une forme symbolique, en ait fait des mythes même, en appropriant ces mythes à l’idée chrétienne, n’est-ce point un signe que ces représentations rappelaient des traditions locales encore persistantes ? N’est-il pas naturel que les clercs, reconnaissant la puissance encore vivace de ces traditions, aient cherché au moins à leur donner un sens symbolique chrétien ? n’est-il pas vraisemblable aussi que les évêques qui présidaient à la construction des grandes cathédrales, aient permis la représentation de ces mythes transformés, à l’extérieur des édifices religieux, mais leur aient interdit l’intérieur des sanctuaires, à cause de leur origine douteuse ? Et, en effet, si ces animaux abondent sur les façades des cathédrales du commencement du XIIIe siècle, ils font absolument défaut à l’intérieur, sauf de rares exceptions. Il n’y a pas un seul animal figuré dans les sculptures intérieures de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame d’Amiens. On en rencontre quelques-uns sur les chapiteaux de la nef de la cathédrale de Reims. Or, ces trois églises, et particulièrement celle de Paris, présentent à l’extérieur un monde d’animaux réels ou fantastiques.
Cette faune innaturelle possède son anatomie bien caractérisée, qui lui donne une apparence de réalité. On croirait voir, dans ces bestiaires de pierre, une création perdue, mais procédant avec la logique imposée à toutes les productions naturelles (voy. Animaux). Les sculpteurs du XIIIe siècle ont produit en ce genre des œuvres d’art d’une incontestable valeur, et sans nous étendre trop sur ces ouvrages, nous donnerons ici, comme échantillon, la tête d’une des gargouilles de la sainte Chapelle de Paris (fig. 64), que certes un artiste grec ne désavouerait pas. Il est difficile de pousser plus loin l’étude de la nature appliquée à un être qui n’existe pas.
Vers 1240, il se produit dans la sculpture d’ornement, comme dans la statuaire, un véritable épanouissement. Ainsi les frises, les chapiteaux, les bandeaux, les rosaces, au lieu d’être composés suivant un principe monumental, ne sont bientôt plus que des formes architectoniques sur lesquelles le sculpteur semble appliquer des feuillages ou des fleurs.


En présence de cette marche rapide de l’art de la sculpture, et surtout de la perfection de l’exécution qui se développe de plus en plus, on ne sait ce que l’on doit préférer, ou de la décoration encore soumise à la composition monumentale, ou de cette imitation adroite, souple et ingénieuse de la nature, cherchée par les artistes du milieu du XIIIe siècle. Cependant rien, à notre avis, n’est au-dessus de la sculpture large, claire, habilement composée, et déjà tout empreinte de l’observation de la flore, qui se voit dans la nef de la cathédrale de Paris. L’échelle de cette sculpture est en parfaite concordance avec celle des profils et de l’architecture tout entière. Il semble que l’art ne puisse aller au delà. Mais il était de l’essence même de la sculpture du moyen âge de ne pouvoir se fixer. Partant de l’observation de la nature, dans la flore aussi bien que dans la statuaire, il fallait aller en avant, poursuivre le mieux, et, en le poursuivant, atteindre le réel. Prenant la nature pour point de départ, de l’interprétation on arrive toujours par une pente irrésistible à l’imitation ; puis, quand l’imitation fatigue, on veut faire mieux que le modèle, on l’exagère, on tombe dans l’affectation, dans la manière et souvent dans le laid. Disons cependant que cette robuste école de l’Île-de-France sait se maintenir dans les limites du goût, et qu’elle ne cesse d’être contenue, sobre et distinguée jusqu’aux dernières limites de l’art du moyen âge, même alors que d’autres provinces, comme la Picardie, la Bourgogne, la Champagne, tombaient dans le maniéré et le laid.
On confond avec trop peu d’attention généralement ces écoles à leur déclin. Les figures bouffonnes et maniérées à l’excès de l’art du XVe siècle dans les Flandres, en basse Bourgogne, en Picardie, empêchent de voir nos œuvres réellement françaises de la même époque, œuvres que le goût ne cesse de diriger. Aussi est-ce de cette école française que sortent, au XVIe siècle, les Jean Goujon, les Germain Pilon, et cette pléiade de sculpteurs dont les œuvres rivalisent avec celles des meilleurs temps.
À dater de 1250, l’art est formé ; dans la voie qu’il a parcourue il ne peut plus monter. Il réunit alors au style élevé, à la sobriété des moyens, à l’entente de la composition, une exécution excellente et une dose de naturalisme qui laisse encore un champ large à l’idéal. Cependant, si séduisantes que soient les belles œuvres de sculpture à dater de la seconde moitié du XIIIe siècle jusqu’au XVe, il est impossible de ne pas jeter un regard de regret en arrière, de ne pas revenir vers cet art tout plein d’une sève qui déborde, qui parle tant à l’imagination, en faisant pressentir des perfections inconnues. Toute production d’art qui transporte l’esprit au delà de la limite imposée par l’exécution matérielle, qui laisse un souvenir plus voisin de la perfection que n’est cette œuvre même, est l’œuvre par excellence. Le souvenir que l’on garde de certaines statues grecques est pour l’esprit une jouissance plus pure que n’est la vue de l’objet ; et qui n’a pas parfois éprouvé une sorte de désenchantement en retrouvant la réalité ! Est-ce à dire pour cela que ces œuvres sont au-dessous de l’estime qu’on en fait ? Non point ; mais elles avaient développé dans l’esprit toute une série de perfections dont elles étaient réellement la première cause. Pour que ce phénomène psychologique se produise, il est deux conditions essentielles : la première, c’est que l’œuvre d’art ait été enfantée sous la domination d’une idée chez l’artiste ; la seconde, est que celui qui voit ait l’esprit ouvert aux choses d’art. Pour former l’artiste, il est besoin d’un public appréciateur, pénétrable au langage de l’art ; pour former le public, il faut un art compréhensible, en harmonie avec les idées du moment. Depuis le XVIIe siècle, nous voulons bien qu’on ait pensé à maintenir l’art à un niveau élevé, mais on n’a guère songé à lui trouver ce public sans la sympathie compréhensive duquel l’art tombe dans la facture, et n’exprime plus un sentiment, une idée, un besoin intellectuel.
Il est évident que pendant le moyen âge il existait entre l’artiste et le public un lien étroit. Le moyen âge n’aurait pas fait un si grand nombre de sculptures pour plaire à une coterie, l’art s’était démocratisé autant qu’il peut l’être. De la capitale d’une province, il pénétrait jusque dans le dernier hameau.
Il avait sa place dans le château et sur la plus humble maison du petit bourgeois ; et ce n’est pas à dire que l’œuvre fût splendide dans la cathédrale et le château, barbare dans l’église de village ou sur la maison du citadin. Non : l’exécution était plus ou moins parfaite, mais l’œuvre était toujours une œuvre d’art, c’est-à-dire empreinte d’un sentiment vrai, d’une idée. Le langage était plus ou moins pur, mais la pensée ne faisait jamais défaut et elle était comprise de tous. On ne trouvait nulle part alors, sur le sol de la France, de ces ouvrages monstrueux, ridicules, qui abondent sur nos édifices publics ou particuliers, bâtis depuis deux cents ans, loin des grands centres. Le langage des arts est devenu une langue morte sur les quatre cinquièmes du territoire, non parce que la population l’a repoussé, mais parce que ce langage a prétendu ne plus s’adresser qu’à quelques élus. Alors il est arrivé ce qui arrive à toute expression de la pensée humaine qui rétrécit le champ de son développement au lieu de l’étendre, elle n’est même plus comprise du petit nombre de gens pour lesquels on prétend la réserver.
Une des gloires de nos écoles laïques du XIIIe siècle, ç’a été de vulgariser l’art. Ainsi que chez les Grecs, l’art était dans tout, dans le palais comme dans l’ustensile de ménage, dans la forteresse comme dans l’arme la plus ordinaire ; l’art était un besoin de la vie, et l’art n’existe qu’à cette condition[55]. Du jour que l’on a appris à un peuple à s’en passer, qu’il n’existe plus que pour une caste, ce n’est pas par des décrets qu’on le vulgarise de nouveau. On ne décrète pas plus le goût qu’on ne le développe par de prétendus encouragements : car encourager le goût, c’est encourager un goût ; encourager un goût, c’est tuer l’art. L’art est un arbre qu’on n’élague pas et qui n’a pas besoin de tuteurs. Il ne pousse qu’en terre libre, en prenant sa sève comme il peut et où il veut, en développant ses rameaux en raison de sa nature propre. Le régime féodal n’avait ni académies, ni conseils des bâtiments civils, ni comités protecteurs des arts ; il ne donnait ni récompenses, ni médailles ; il ne s’inquiétait point de savoir si, dans ses domaines, on apprenait le dessin, si l’on modelait la terre et si l’on sculptait le bois ; il n’avait ni musées ni écoles spéciales, et l’art vivait partout, florissait partout. Dès que le despotisme unique de Louis XIV se substitue à l’arbitraire féodal, dès que le gouvernement du grand roi prétend régenter l’art comme toutes choses, former un critérium du goût, l’art se range, se met au régime et n’est bientôt plus qu’un moribond dont on entretient la vie à grand’peine avec force médicaments et réconfortants, sans pouvoir un seul jour lui rendre jeunesse et santé.
La puissance productive de l’art au XIIIe siècle, et particulièrement de la sculpture, tient du prodige. Après les guerres du XVe siècle, après les luttes religieuses, après les démolitions dues aux XVIIe et XVIIIe siècles, après les dévastations de la fin du dernier siècle, après l’abandon et l’incurie, après les bandes noires, il nous reste encore en France plus d’exemples de statuaire du moyen âge qu’il ne s’en trouve dans l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne réunies[56].
Au commencement du XIIe siècle, la bonne statuaire est d’une valeur incomparable, mais faut-il encore la chercher. Les grandes écoles se forment, et leurs rameaux ne s’étendent pas bien loin. À dater du milieu du XIIIe siècle, les œuvres remarquables abondent ; un monde d’artistes s’est constitué, les écoles tendent à se fondre dans une unité de méthode, et de pauvres églises, des maisons, des châteaux de petite apparence, contiennent parfois des ouvrages de sculpture d’une excellente exécution, d’un style irréprochable. Ces artistes étaient donc répandus partout, et la sculpture semblait être un art de première nécessité. À ce moment du développement de l’art sculptural, l’exécution atteint un haut degré de perfection. Que l’on examine la statuaire et la sculpture d’ornement de la sainte Chapelle du palais, de la porte sud du transsept de l’église abbatiale de Saint-Denis, les parties inférieures du portail de droite de la cathédrale d’Auxerre, les portes nord et sud de Notre-Dame de Paris, la sculpture des portails de Reims et d’Amiens, on pourra se faire une idée du développement que prenait l’art sous le règne de Louis IX. Jamais l’observation de la nature ne fut poussée plus loin. Au milieu de tant d’œuvres, il est difficile de choisir un exemple.

Nous ne soutiendrons pas que les habits du XIIIe siècle ne fussent pas plus favorables à la statuaire que les nôtres, mais les artistes ne reproduisaient guère les vêtements de leur temps qu’accidentellement. Ils drapaient leurs figures suivant leur goût, leur fantaisie, et jamais on ne sut mieux, sinon dans la belle antiquité grecque, donner aux draperies le mouvement, la vie, l’aisance.
Et quand même ces artistes reproduisaient les vêtements portés de leur temps, avec quel art savaient-ils les arranger, leur donner la noblesse, le style, sans s’écarter de la vérité ! et cela jusqu’à la fin du XVe siècle[58].
Le moyen âge ne s’est pas contenté de sculpter les pierres dures, le marbre, le bois, il éleva un grand nombre de monuments de bronze coulé et de cuivre repoussé. Presque toutes ces œuvres d’art ont été jetées au creuset pendant le XVIIIe siècle et en 1793. Il ne nous en reste aujourd’hui qu’un très-petit nombre[60]. Ce peu suffit toutefois pour faire connaître que les artistes des XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles avaient poussé très-loin l’art du fondeur. Les deux tombes de la cathédrale d’Amiens sont des chefs-d’œuvre de fonte ; l’une d’elles est, comme art, un monument du premier ordre[61]. Toutes deux représentent des évêques grandeur naturelle, ronde bosse, couchés sur une plaque de cuivre décorée d’accessoires. Le tout est fondu d’un seul jet et admirablement fondu. Seules, les crosses étaient des pièces rapportées.
Il existait à Saint-Denis une tombe de Charles le Chauve, datant de la fin du XIIe siècle, en bronze coulé et émaillé. L’église Saint-Yved de Braisne contenait un grand nombre de ces monuments de bronze émaillés et dorés[62]. Nous ne savons comment ces artistes du moyen âge s’y prenaient pour émailler des statues de bronze grandes comme nature ; cela nous paraît impossible aujourd’hui. Cet art se conserva jusqu’à l’époque de la renaissance, car la statue de Charles VIII agenouillée sur son tombeau, à Saint-Denis, était vêtue d’un manteau royal entièrement émaillé en bleu sur le bronze, avec semis de fleur de lis d’or[63]. Le XIIe siècle avait fabriqué un grand nombre d’objets de bronze servant à la décoration des édifices. Suger parle des grilles de bronze qu’il avait fait fondre pour l’autel des martyrs. On conserve encore au musée de Reims un magnifique fragment d’un grand candélabre de bronze qui était placé dans le sanctuaire de l’église de Saint-Remi, et qui date du milieu du XIIe siècle ; on ne saurait voir de fonte plus pure et une ornementation mieux appropriée à la matière[64]. Enfin, il existe un assez grand nombre de bustes de cuivre ou d’argent repoussé des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, servant de reliquaires, qui sont d’un excellent travail ; nos sanctuaires possédaient des autels, des baldaquins en bronze fondu et repoussé, émaillé et doré d’une grande richesse de travail.
Ces objets de bronze étaient habituellement fondus en grandes pièces et à cire perdue. Il fallait bien que ce travail ne sortît pas des procédés ordinaires, car il existait en France une grande quantité de statues tombales ou autres, en bronze, jusqu’à la révolution du dernier siècle. La collection Gaignères d’Oxford en reproduit beaucoup, et les inventaires des églises en signalent de tous côtés. Il est évident que la plupart de ces œuvres de métal, grandes ou petites, étaient fondues à cire perdue, car, outre que le moine Théophile mentionne l’emploi de ce procédé, les monuments existants indiquent que la fonte venait sans bavures, puisqu’on n’en retrouve point de traces, et que le grain de la fonte est égal partout. Si la ciselure intervient, ce n’est que pour donner du vif à des broderies, obtenir des gravures délicates, mais nulle part on ne voit la trace de la lime, de la râpe ou du grattoir. D’ailleurs on sait fort bien que les imagiers du moyen âge avaient pris l’habitude de façonner des figures de cire de grandeur naturelle, puisqu’il en est fait souvent mention. Or, ces figures étaient faites sur des noyaux de terre séchée, suivant le procédé indiqué par Théophile. Le procédé pour fondre est le même. Ces bronzes du moyen âge sont fondus très-minces, comme la plupart des bronzes antiques, et comme le sont aussi les belles statues françaises de la renaissance, parmi lesquelles on citera celles de Henri II et de Catherine de Médicis de l’église de Saint-Denis. Dans ces deux figures, la fonte n’a point été retouchée et est restée telle qu’elle est sortie du moule. Or, ces figures sont fondues d’un seul jet et ne présentent aucune bavure. L’emploi de la cire perdue permettait seul d’obtenir un pareil résultat.
Mais le moyen âge n’est point routinier dans l’emploi des procédés. Il cherche sans cesse, il simplifie, modifie et améliore avec une telle activité, qu’un monument, ou même un objet, est commencé d’après un système et fini suivant un autre. Non content de fondre ou de repousser au marteau des statues de bronze ou de grands objets mobiliers, tels que chaires, fonts baptismaux, croix de carrefour, lutrins, margelles de puits, tombes, candélabres, etc., il avait adopté un procédé mixte qui permettait d’obtenir des résultats singuliers. On fondait une figure, comme un mannequin vêtu d’un habit de dessous ; puis, sur ce mannequin de bronze, on posait successivement des habits de dessus, faits au marteau, des armes, des bijoux de bronze ciselé, des couronnes et tous les ornements constituant une riche parure. C’est ainsi que sont fabriquées quelques-unes des statues qui ornent le tombeau de Maximilien à Innsbrück ; et bien que ce monument ne date que du XVIe siècle, nous retrouvons là un procédé de fabrication très-anciennement adopté, non-seulement en Allemagne, mais en France.
D’autres fois le mannequin était de bois, et était revêtu de lames très-minces de bronze façonnées au marteau ou simplement embouties, c’est-à-dire modelées avec l’ébauchoir sur son moule de bois. Aussi ces artistes du moyen âge pouvaient-ils satisfaire à toutes les exigences de l’art et à celles de l’économie.
Le siècle de Louis XIV, qui avait la prétention d’avoir tout inventé ou tout retrouvé, admit qu’avant les frères Keller on ne savait point couler en bronze de grandes pièces en France[65]. Sans vouloir en rien diminuer le mérite de ces industriels, nous ne pouvons admettre qu’ils aient retrouvé les procédés de fonte ; ils n’ont fait qu’adopter, pour toute fonte, un mode rarement employé : et cela s’explique par la nature même des objets d’art qu’on leur demandait. Il s’agissait de fondre des statues d’après l’antique. Il est évident que le procédé de cire perdue ne pouvait être alors employé. Il fallait battre des pièces sur un moulage ou sur l’original, faire un noyau, rassembler avec grand soin les pièces autour du noyau, et couler du bronze dans l’intervalle resté libre. Ce procédé, si intéressant et précieux qu’il soit, eut un inconvénient, il déshabitua les statuaires de faire des cires perdues ; ceux-ci se contentèrent dès lors de façonner un modèle en terre que l’on moule en plâtre ; sur ce plâtre les pièces sont battues, et l’on coule, en ménageant un noyau au centre de toutes ces pièces rassemblées. Mais comme il est très-difficile, sinon impossible, de battre des pièces sur une statue entière et de les rassembler exactement, on coupe les statues en plusieurs morceaux et l’on fond séparément chaque pièce ; puis on rassemble ces pièces par des tenons, des goupilles et des rivets. Or, jamais, par ce procédé, le bronze ne conserve cet ensemble, cette unité d’aspect des pièces fondues d’un seul jet. Puis, comme les coutures, les bourrelets réservés pour l’assemblage se multiplient, il faut passer sur tout cela la lime, le burin, contenter les parties faibles ; si bien que la statue fondue ne reproduit qu’assez imparfaitement le modèle du maître. Nous ne voyons pas trop ce que l’art a gagné à cela, si ce n’est de permettre au premier modeleur venu de faire faire un bronze par un fondeur.
Mais quand il faut que l’artiste qui veut couler une statue en bronze, fasse lui-même le noyau de terre de sa figure, — car ce noyau est la partie essentielle, — veille à ce que ce noyau façonné en argile et paille hachée soit bien séché ; quand, après cela, il faut revêtir cette grande maquette d’une couche de cire dont l’épaisseur doit être exactement calculée ; modeler cette cire pour obtenir les finesses de la forme ; puis, enfin, après avoir ménagé des évents et des jets, faire recouvrir tout cela d’une épaisse couche de terre préparée exprès, la bien envelopper et cercler, chauffer l’ensemble pour que la cire s’échappe en fondant, et enfin, après avoir combiné le mélange de ses métaux et avoir fait faire un fourneau, couler la matière en fusion dans le vide qu’occupait la cire : certes, alors, il y a là tout un labeur pénible, chanceux, une suite de calculs et de combinaisons, une idée arrêtée dès le commencement du travail et suivie jusqu’au bout sans hésitation. Que le génie de nos statuaires ne se prête pas à cette dure besogne, nous le voulons bien ; mais au total l’art y a perdu, car les fontes du moyen âge, aussi bien que celles de l’antiquité et de la renaissance, sont supérieures comme pureté et légèreté à celles qui sortent aujourd’hui de nos ateliers. En Italie, en Allemagne, en France, pendant le moyen âge, on fit d’admirables fontes, et ces sculpteurs-fondeurs (car il fallait être l’un et l’autre) français, allemands, italiens, ne croyaient pas faire une chose extraordinaire lorsqu’ils avaient réussi à couler une grande pièce. Ils ne croyaient pas utile, pour faire valoir leurs œuvres, d’occuper toute une ville, et d’écrire cent pages de mémoire, comme le fit plus tard Benvenuto Cellini à propos de son Persée. Ils avaient tort, et l’exemple de ce maître poseur, pour nous servir d’une expression récente qui s’applique si bien à l’homme, prouve que le bruit, en pareil cas, s’il ne profite pas à l’art, contribue à la renommée de l’artiste.
On ne cessa jamais de fondre des objets en bronze dans les Gaules, et du temps de César déjà nos ancêtres étaient habiles à ouvrer les métaux. Les rapports fréquents avec l’Orient, à dater du XIe siècle, apportèrent des perfectionnements dans cette industrie si ancienne en France, et il ne faut point être surpris de trouver des fontes du XIIe siècle, qui surpassent en beauté tout ce qu’on a su faire depuis. Tel est l’admirable candélabre de cette époque, qui faisait partie de la collection Soltykoff, et qui fut acheté pour l’Angleterre. Cet objet, fondu d’un seul jet, sans une pièce rapportée, présente une suite d’enroulements et de figurines enchevêtrés, le tout ajouré et d’une admirable pureté de style et d’exécution. Il provenait de la cathédrale du Mans.
Jusque vers le milieu du XIIIe siècle, si la statuaire échappe en France au naturalisme absolu, les diverses écoles ne s’avancent pas toutes d’un pas égal ; quelques-unes maintiennent assez tard une sorte d’archaïsme, tandis que celle de l’Île-de-France se jette hardiment dans l’étude de plus en plus exacte de la nature. Il est même certains édifices dans lesquels, probablement, on employait de vieux sculpteurs, qui possèdent une statuaire relativement arriérée ou empreinte d’un style qui n’était plus admis au moment de leur construction. Ainsi, la cathédrale de Laon, dont la façade ne peut être antérieure à 1200, même dans la construction de ses œuvres basses, montre sur ses portes des bas-reliefs ou statues qui ont conservé un caractère archaïque bien prononcée. Les artistes, auteurs de ces ouvrages, sont pénétrés des exemples de peintures grecques. Il y a dans l’agencement des figures, dans les compositions, une recherche de la symétrie qui rappelle les vignettes des manuscrits grecs. Cette influence se montre même dans le choix des sujets, dans les draperies, dans quelques accessoires tels que sièges, dais, etc. À Notre-Dame de Reims, la porte nord du transsept, aujourd’hui masquée, est toute empreinte de ce style des peintures grecques, bien que cette porte soit postérieure de quelques années à l’an 1200. Rien de pareil à Paris ; le statuaire recherche l’étude de la nature dès 1200, ne veut plus avoir affaire aux traditions romanes ou byzantines. Un fait indique combien l’école nouvelle réagissait contre ces traditions. En faisant des fouilles devant la porte centrale de Notre-Dame de Paris, on a trouvé une certaine quantité de fragments d’un bas-relief central représentant le Christ glorieux au jour du jugement, comme celui que l’on voit aujourd’hui : mais cette sculpture est empreinte du style archaïque du XIIe siècle ; d’ailleurs la pierre en est toute fraîche, sans aucune altération produite par le temps. Ce bas-relief avait été supprimé peu après avoir été achevé, pour être remplacé par le sujet actuel, dû à des artistes de la nouvelle école. Et en effet, lorsque l’on considère cette sculpture, composé de cinq figures, le Christ, deux anges, la Vierge et saint Jean, on remarque dans le faire de ces statues colossales des différences notables. Le Christ et un des anges, celui qui porte les clous, appartiennent déjà à l’école penchant vers le naturalisme, tandis que la Vierge, le saint Jean et l’ange qui porte la croix sont encore des sculptures archaïques ; cependant il était impossible matériellement d’introduire les deux premières statues au milieu des trois autres. Elles ont dû être posée ensemble.
De toutes les provinces, la Champagne marche bien vite dans la voie nouvelle, et la statuaire du portail de Notre-Dame de Reims en est la preuve. Le naturalisme a déjà fortement pénétré cette statuaire qui date de 1240 environ. Cependant, à propos de ce portail, il faut signaler des indécisions que l’on ne trouve point dans l’école de l’Île-de-France. Quelques figures colossales, notamment celles qui, à la porte de droite, représentent la Visitation, sont inspirées comme composition et exécution des draperies, de la statuaire romaine, dont il existait d’ailleurs à Reims de nombreux débris. On ne trouve pas dans ce portail cette unité de style qui, sauf l’exception que nous venons de signaler à Notre-Dame de Paris, frappe dans la statuaire de l’Île-de-France. Une autre école, celle de Bourgogne, si belle déjà au commencement du XIIe siècle, conserve sa liberté d’allure pendant le XIIIe siècle, qu’il s’agisse de la statuaire ou de la sculpture d’ornement. La puissance, l’énergie, un faire hardi, vivant, sont les caractères de cette école. Il ne faut pas lui demander, au moment de l’émancipation des écoles laïques, la finesse, le contenu, la distinction, qui forment les qualités de l’école de l’Île-de-France. Elle cherche les grands effets, et elle les obtient. La sculpture bourguignonne participe peut-être plus qu’aucune autre de l’architecture ; on peut se rendre compte de cette qualité en voyant les compositions des pignons des églises de Vézelay et de Saint-Père[66]. Cette sculpture est, dans tous les monuments de cette province, grande d’échelle, relativement à l’architecture, commande parfois les dispositions de celle-ci au lieu de s’y soumettre. Elle est d’ailleurs taillée avec une verve et un entrain qui placent cette école au premier rang dans l’art monumental.




Nous ne saurions trop le redire, ces époques brillantes de l’art, par cela même qu’elles ont atteint la splendeur en cherchant le mieux, ne sauraient s’arrêter. Du style, de la conception large, simple, de l’inspiration obtenue par la première observation raisonnée de la nature, elles arrivent à l’imitation matérielle, de l’imitation à la recherche, puis à la manière et à ses exagérations. Quand l’artiste observe la nature, il en prend d’abord les caractères principaux. Il n’est point savant encore ; il voit des formes séduisantes, il s’en inspire plutôt qu’il ne les copie servilement. C’est là le beau moment de l’art, tout plein de promesses, laissant à deviner encore plus qu’il n’explique. Mais la nature a des attraits puissants pour qui l’observe. Bientôt l’artiste reconnaît que ses inspirations, ses déductions, ses à-peu-près, sont bien loin de la réalité ; il se passionne pour son modèle, il lui trouve chaque jour des aspects nouveaux, des qualités charmantes qui lui échappaient. Alors la traduction devient de plus en plus littérale. De créateur (créateur de seconde main) il devient copiste ; il est subjugué par la divinité qui l’inspirait à mesure qu’il la connaît mieux, et ne pense plus qu’à la montrer telle qu’il la voit. C’est l’heure du naturalisme, heure qui a sonné pour la Grèce et pour nos écoles du XIIe siècle.
Mais dans ce naturalisme de la sculpture, l’art n’entre-t-il pour rien ? Si fait : la composition, l’agencement de ces charmants modèles recueillis dans les champs, comptent pour quelque chose, et en cela nos artistes, le naturalisme admis, sont encore des maîtres.
Pour la statuaire, il se manifeste un besoin de formules ; on n’admet plus alors, il est vrai, le mode hiératique, traditionnel, mais on sent la nécessité, quand l’art pénètre partout, exige un grand nombre de mains, d’établir des méthodes pratiques qui permettent d’éviter de grossières erreurs. Bien entendu, les chefs-d’œuvre, ou plutôt ceux qui ont assez de génie pour en produire, se préoccupent médiocrement de ces règles. Mais c’est précisément en s’appuyant sur ces œuvres des maîtres que l’on formule des règles pour le commun des artistes. Dans l’album de Villard de Honnecourt, qui date du milieu du XIIIe siècle, on voit apparaître l’emploi de ces procédés mécaniques propres à faciliter la composition et le dessin des figures, et même des ornements. Il y a toute raison de croire que ces méthodes, fort anciennes d’ailleurs, puisqu’on en trouve l’application dans les arts du dessin de l’Égypte, ne furent jamais perdues, et avaient été transmises en Occident par l’école d’Alexandrie, par les peintres grecs de Byzance. Leur apparition dans le recueil de croquis de Villard de Honnecourt n’en est pas moins un fait d’un grand intérêt, parce qu’elle semble indiquer une application libre de formules qui, jusqu’au commencement du XIIIe siècle, avaient un caractère hiératique.
Nous avons dit comme les imagiers du moyen âge avaient su observer et rendre le geste dans les compositions des figures. Si grossière parfois que soit l’œuvre, le geste n’est jamais faux. Or, les croquis de Villard nous donnent la clef des formules adoptées pour arriver à ce résultat. La géométrie, d’après ces croquis, est le générateur des mouvements du corps humain, des animaux ; elle sert à établir certaines proportions relatives des figures ; lui-même le dit et fournit quelques exemples pris en courant[70]. Du temps de Villard, donc, les imagiers possédaient ces méthodes pratiques qui, si elles ne peuvent inspirer l’artiste de génie, empêchent le pratricien de tomber dans des fautes grossières. Un de ces dessins à la plume, que nous reproduisons ici (fig. 73), indique ces procédés pratiques.

En comparant ce mode de tracé avec des figures de vignettes de manuscrits, avec des dessins sur vitraux, et même avec des statues et des bas-reliefs, nous sommes amenés à reconnaître l’emploi général, pendant les XIIIe et XIVe siècles, de ces moyens géométriques propres à donner aux figures, non-seulement leurs proportions, mais la justesse de leur mouvement et de leur geste, sans sortir de la donnée monumentale qui fait que ces figures s’accordent si bien avec la fermeté des lignes architectoniques ; et, fait intéressant, les résultats obtenus par ces procédés rappellent les dessins des vases grecs les plus anciens. Une sorte de canon, reproduit grossièrement par Villard, semble admis[71]. Le rectifiant, comme proportions, à l’aide des meilleures statues, et notamment celles placées à l’intérieur de la façade occidentale de la cathédrale de Reims, nous obtenons la figure 74.

La ligne AB, hauteur totale de la figure humaine, est divisée en sept parties. La partie supérieure est occupée par la tête et le cou dégagé des épaules. Soit CD l’axe de la figure, la ligne ab est égale aux de la hauteur AB. Le point E étant le milieu de la ligne CD, on fait passer deux lignes af, be, par ce point E ; du point g deux autres lignes ge, gf, sont tirées. La ligne bh donne la longueur de l’humérus ; le haut de la rotule est sur la ligne ik. La longueur du pied est égale aux d’une partie. Les masses du canon ainsi établies, voici comment procèdent les imagiers pour donner des mouvements à leurs figures, lorsque ces mouvements ne se présentent pas absolument de profil.

Premier exemple (75) : il s’agit de faire porter la figure sur une jambe. La ligne be (du canon, fig. 74) est verticale, dès lors l’axe de la figure géométrique est incliné de o en p (fig. 75). Le mouvement des épaules, du torse, suit cette inflexion. L’axe de la tête et le talon de la jambe droite se trouvent sur la verticale. Une figure doit-elle monter (second exemple), l’axe de la figure est vertical, et le talon de la jambe droite relevée se trouve sur la ligne inclinée st, tandis que la ligne du cou est sur la ligne lm ; dans ce mouvement, le torse conserve la verticale. L’exemple troisième fait voir, toujours en conservant le même tracé géométrique, comment une figure peut être soumise à un mouvement violent. Le personnage est tombé : il se soutient sur un genou et sur un bras, de l’autre bras il pare un coup qui lui est porté ; la tête est ramenée sur la verticale. D’ailleurs la figure géométrique engendre ce mouvement, comme les deux premiers.

Voulons-nous précipiter davantage ce dernier mouvement, nous obtenons la figure 76. Maintenant la cuisse gauche sur la ligne af, force nous est, pour trouver la longueur de la jambe gauche (le sol étant horizontal), de ramener le talon en c, ce qui est parfaitement dans le mouvement. Dans ce dernier exemple, la ligne ef est horizontale. Il est clair qu’en adoptant ces méthodes pratiques, tous les membres des figures devaient se développer en géométral, sans raccourcis. Mais c’est que dans la sculpture monumentale, dans les reliefs destinés à être placés loin de l’œil, la vivacité du geste, sa netteté, ne peuvent être obtenues qu’à la condition d’adopter le géométral. Il en est ainsi dans la grande peinture, dans les vitraux. Les Grecs, au commencement de leur plus belle époque, procèdent de la même manière, et les personnages des métopes du Parthénon, des frises du temple de Thésée, sont tracés d’après ce principe.
Examinons les dessins qui décorent les vases grecs, et nous verrons que les artistes de l’antiquité employaient certainement des méthodes analogues à celles que nous présentons ici. Villard de Honnecourt trace des figures avec des mouvements entièrement de profil qui sont obtenus par des procédés géométriques : entre autres, un batteur en grange, dont l’attitude est d’une exactitude parfaite ; un chevalier chargeant, d’un mouvement très-juste ; des lutteurs, une femme ayant un genou en terre, etc. Nous le répétons, ces méthodes ne pouvaient qu’empêcher des écarts ; elles n’étaient point une entrave pour le génie, qui savait bien, ou s’en affranchir, ou en trouver de nouvelles. C’était un moyen de conserver le style monumental dans la composition des sculptures, d’obtenir la clarté dans l’exécution, deux qualités passablement négligées depuis le XVIe siècle.
Les statuaires du moyen âge exécutaient-ils les figures innombrables qui garnissent leurs monuments, sur modèles ? Nous ne le pensons pas. D’abord ils n’en avaient certainement pas le temps, puis l’entrain de l’exécution et certaines irrégularités que l’on observe dans cette statuaire excluent la présence du modèle en terre. Peut-être faisaient-ils des maquettes à une petite échelle ? Mais nous serions portés à croire qu’ils traçaient les lignes générales de leurs statues sur des panneaux, l’un pour l’aspect de face, l’autre pour l’aspect de profil, et qu’à l’aide de ces deux sections, ils dégrossissaient la pierre en cherchant les détails sur la nature même. On voit dans beaucoup de statues du XIIIe siècle, à côté d’une partie de figure traitée avec amour, un morceau très-négligé ; cela n’arrive point quand des artistes exécutent sur des modèles : alors le travail est égal, uniforme et souvent amolli par la traduction en pierre d’un modèle fait avec de la terre ou de la cire.
Les monuments nous prouvent que les sculpteurs égyptiens, lorsqu’ils faisaient des bas-reliefs modelés en creux, commençaient par dessiner simplement leurs figures sur le parement, qu’ils en creusaient la silhouette et qu’ils cherchaient le modelé en pleine pierre ; et cependant ce modelé arrive à des délicatesses merveilleuses. Bien que nous sachions que les artistes grecs, surtout après Phidias, faisaient des modèles en cire ou en matières molles, il n’est pas prouvé que les sculpteurs antérieurs à Phidias procédassent ainsi lorsqu’ils avaient à faire des statues de bois, de pierre ou de marbre ; le géométral, toujours observé dans la statuaire éginétique, ferait supposer au contraire que ces artistes primitifs se contentaient du dessin pour procéder à l’exécution définitive.
Déjà, vers la fin du XIIIe siècle, on commence à sentir en France l’influence souveraine de cette divinité qu’on appelle la Mode, divinité aussi cruelle pour la veille qu’elle est indulgente pour le moment présent. C’est alors qu’on voit tous les artistes, au même moment, adopter dans la statuaire, non-seulement les vêtements du jour, mais certains caractères physiques qui sont regardés comme se rapprochant de la perfection. On ne saurait se dissimuler que l’empire de la mode est tel, qu’il influe jusqu’à un certain point sur le physique. Les traits, le port, jusqu’aux formes du corps, s’arrangent pour sortir d’un moule commun, admis comme étant la suprême élégance. Cela n’est pas né d’hier ; les Grecs eux-mêmes sacrifièrent à cette déesse changeante.
Les statuaires du moyen âge s’interdisaient habituellement la reproduction du nu. Leurs figures étaient drapées, sauf de rares exceptions ; or, l’allure d’une figure nue et d’une figure vêtue n’est pas la même, et nous ne voyons que trop, depuis le commencement du siècle, à quels résultats fâcheux nos sculpteurs sont arrivés en concevant une figure vêtue comme une figure nue, ou plutôt en cherchant à habiller un Apollon ou un Antinoüs antique : rien n’est plus gauche. Il y a, dans le port d’un personnage nu et habitué à se mouvoir sans vêtements, une grâce étrangère à celle qui convient au personnage vêtu. Les anciens savaient cela, aussi ont-ils donné à leurs figures habillées d’autres mouvements, d’autres gestes que ceux dont ils savaient si bien doter leurs figures nues. Faute d’observer ces lois, on nous donne souvent des statues qui ont l’air de portefaix habillés en généraux, ou tout au moins qui paraissent fort gênées dans leurs vêtements d’emprunt ; et ce n’est pas l’éternel manteau dont on drape le maréchal de France comme le savant ou le poëte qui peut dissimuler ce défaut de convenances.
Nos sculpteurs du moyen âge prennent donc résolûment leur parti de faire des figures vêtues ; ils leur donnent les mouvements, les gestes familiers aux gens habitués à porter tel ou tel habit. Aussi les vêtements de leurs statues ont-ils l’air de tenir à leur corps et ne paraissent point empruntés au costumier. Les nombreuses statues des tombeaux déposés à Saint-Denis, des XIIIe et XIVe siècles, parmi lesquelles nous citerons celles de Louis et de Philippe, fils et frère de saint Louis, celles de Philippe le Hardi, d’un comte d’Évreux, de Charles V et de Jeanne de Bourbon, provenant du portail des Célestins ; les statues du tympan intérieur de la façade occidentale de la cathédrale de Reims, celles du portail des Libraires à la cathédrale de Rouen, bien que déjà empreintes de la manière affectée qui fait regretter le grand style du XIIIe siècle, sont des œuvres supérieures comme caractère, comme beauté d’ajustement et comme exécution. Dans la statuaire du tour du chœur de la cathédrale de Paris, on trouve également quantité de très-bonnes figures, petite nature, qui datent du commencement du XIVe siècle. Les calamités qui affligèrent le royaume de France pendant tout le milieu de ce siècle ne permirent guère de s’occuper d’art et cependant les écoles ne laissaient point perdre leur enseignement, puisque nous les voyons reprendre un nouvel éclat vers la fin du règne de Charles V. Ce prince, réellement amateur des arts, les encourageant par le choix plutôt que par la quantité, fit élever d’assez importantes constructions dont la sculpture, — autant qu’on en peut juger par ce qui nous reste, — est fort bonne. Ce fut sous le règne de ce prince que l’on éleva, au côté nord de la tour septentrionale du portail de la cathédrale d’Amiens, un gros contre-fort très-orné et très-pesant, destiné à arrêter les mouvements d’oscillation qui se produisaient dans cette tour lorsqu’on sonnait les grosses cloches. Sur les parois de ce contre-fort sont posées sept statues colossales religieuses et historiques, d’un beau travail. Ces statues représentent : la sainte Vierge, saint Jean-Baptiste, Charles V ; le Dauphin, depuis Charles VI ; Louis d’Orléans ; le cardinal de la Grange, évêque d’Amiens, surintendant des finances, et Bureau de la Rivière, chambellan du roi[72]. En examinant ces statues de la fin du XIVe siècle, comme toutes celles de cette époque, il est facile de voir que l’artiste tenait avant tout (puisqu’il habillait ses figures) à ce que le vêtement fût bien porté. Or, pour bien porter un vêtement long, par exemple, il est nécessaire de donner au corps certaines inflexions qui seraient ridicules chez un personnage se promenant tout nu. Il faut marcher des hanches, tenir les jambes ouvertes et faire en sorte, par les mouvements du torse, que la draperie colle sur certaines parties, flotte sur d’autres. Faire, pour une statue vêtue, un bon mannequin en raison du vêtement, n’est point chose aisée. Nos statuaires du XIVe siècle avaient du moins ce mérite. Ainsi la statue du cardinal de la Grange, que nous citions tout à l’heure, est parfaitement entendue comme mouvement du nu pour faire valoir le vêtement. Cependant ce mouvement serait choquant pour un personnage nu. Nous en donnons (fig. 77) le tracé. La jambe droite porte plutôt que la jambe gauche ; celle-ci cependant étaye le torse, qui se porte en arrière pour faire saillir la hanche droite. L’épaule gauche s’affaisse, contrairement aux règles de la pondération, pour un personnage qui n’aurait pas à se préoccuper du port d’un vêtement. Voici (fig. 78) une copie de cette statue du cardinal de la Grange, qui fait assez voir que le mouvement indiqué ci-dessus est donné en vue d’obtenir ce beau jet de draperies du côté droit.
La jambe droite porte plutôt que la jambe gauche ; celle-ci cependant étaye le torse, qui se porte en arrière pour faire saillir la hanche droite. L’épaule gauche s’affaisse, contrairement aux règles de la pondération, pour un personnage qui n’aurait pas à se préoccuper du port d’un vêtement. Voici (fig. 78) une copie de cette statue du cardinal de la Grange, qui fait assez voir que le mouvement indiqué ci-dessus est donné en vue d’obtenir ce beau jet de draperies du côté droit. 
Charles V laissait dans sa famille un goût éclairé pour les arts, et, à dater de ce règne, nous voyons les princes du sang royal se mettre à la tête d’un nouveau mouvement d’art dont ni les historiens ni les archéologues de notre temps ne semblent pas avoir tenu assez compte. En effet, le second fils de Charles V, Louis d’Orléans, assassiné dans la nuit du 23 au 24 novembre 1407, par le duc de Bourgogne, était un prince aimant les arts avec la passion d’un connaisseur émérite. Pendant la démence de son frère Charles VI, jusqu’au jour de sa mort, c’est-à-dire de 1392 à 1407, il gouvernait à peu près seul, avec la reine Isabeau de Bavière, les affaires du royaume. Ce fut pendant cette période que Louis d’Orléans acheta Coucy, et y fit faire d’immenses travaux, qu’il bâtit Pierrefonds, la Ferté-Milon, Vées ; qu’il répara les châteaux de Béthisy, de Mont-Épilloy, de Crespy, toutes forteresses importantes destinées à faire du Valois un territoire inattaquable. Il est à croire que les finances du royaume entrèrent pour une large part dans ces acquisitions et ces travaux ; mais ce qui nous importe seulement ici, c’est le goût particulier qui présida à toutes ces grandes constructions. Au point de vue de l’architecture, elles sont largement conçues et traitées, ne participant en aucune manière de la maigreur et de la recherche que l’on peut reprocher au style de cette époque. D’ailleurs toutes empreintes du même style, elles semblent élevées sous la direction d’un seul maître des œuvres. Les profils sont d’une beauté exceptionnelle pour le temps, et la sculpture d’une largeur, d’une distinction qui ont lieu de surprendre au milieu des mièvreries de la fin du XIVe siècle. La statuaire qui reste encore à Pierrefonds, au château de la Ferté-Milon, a toute l’ampleur de notre meilleure renaissance, et si les habits des personnages n’appartenaient pas à 1400, on pourrait croire que cette statuaire date du règne de François Ier. Encore en trouve-t-on fort peu, à cette époque, qui ait cette largeur de style et ce faire monumental. Des fragments de la statuaire du château de Pierrefonds, le Charlemagne, le roi Artus[73], l’archange saint Michel de la tour de l’est, la Vierge du grand bas-relief de la façade, sont des œuvres de maîtres consommés dans la pratique de leur art, et tout remplis d’un beau sentiment. Jamais peut-être on n’a si bien vêtu la statuaire en faisant sentir le nu sans affectation, et en donnant aux vêtements leur aspect réel, aisé, sans recherche dans l’imitation des détails. Des statues tombales du commencement du XVe siècle sont d’une largeur de style dont la renaissance s’éloigne trop souvent. Il nous suffit de citer la statue d’Isabeau de Bavière, à Saint-Denis ; celle d’un évêque, d’albâtre gris, du musée de Toulouse ; celles des princes de la maison de Bourbon, dans l’église abbatiale de Souvigny ; de nombreux fragments déposés aux musées de Dijon, de Rouen, d’Orléans, de Bourges.
Il est clair que cet art français de 1390 à 1410 était loin de la maigreur, de la pauvreté que lui reprochent ceux qui vont chercher des exemples de la dernière statuaire gothique en Belgique ou sur les bords du Rhin. L’ornementation de Pierrefonds est en rapport avec cette bonne statuaire ; elle est ample, monumentale, admirablement composée et d’une exécution sobre et excellente. Les statues des preuses qui décorent les tours existantes du château de la Ferté-Milon présentent les mêmes qualités. C’est un art complet, qui n’est plus l’art du XIIIe siècle, qui n’est plus la décadence de cet art, tombant dans la recherche, mais qui possède son caractère propre. C’est une véritable renaissance, mais une renaissance française, sans influence italienne. Les Valois, ces princes d’Orléans, Louis, Charles, et enfin celui qui devint Louis XII, avaient pris évidemment la tête des arts en France, s’en étaient faits les protecteurs éclairés, et, sous leur patronage, s’élevaient des édifices qui devançaient, suivant une direction plus vraie, le mouvement du XVIe siècle. Témoin l’ancien hôtel de ville d’Orléans, aujourd’hui le musée, bâti en 1442, et auquel on assignerait une date beaucoup plus récente[74]. Cet édifice, dont la façade est due au maître Viart, présente une ornementation charmante, originale, qui n’a plus rien de l’ornementation gothique, mais qui est mieux entendue et surtout d’une composition plus large que celle admise sous François Ier, alors que les arts d’Italie avaient exercé une influence sur nos artistes. Pour en revenir au château de Pierrefonds, qui nous paraît être le point de départ d’une réforme malheureusement interrompue par les guerres et plus tard par l’introduction de l’élément italien, son ornementation prend un caractère particulier. On ne trouve plus là de ces sculptures d’une échelle qui ne tient pas compte de l’architecture. Au contraire, l’échelle de cette ornementation est en rapport parfait avec la destination et la place, claire, facile à saisir, et s’inspirant de la flore sans se soumettre à une imitation absolue. Les beaux rinceaux de feuillages, par exemple, qui entourent les grandes niches des preux, posées à 25 mètres du sol, et qui sont destinées à être vues de fort loin, ont toute l’ampleur que comporte la place. Leur modelé accentué produit un effet très-riche, sans confusion, défaut si commun dans l’ornementation du XVIe siècle. Il y avait donc, dès le commencement du XVe siècle, à côté de la vieille école gothique qui se mourait, un noyau d’artistes préparant une renaissance dans toutes les branches de l’architecture. Malgré les malheurs des temps, cette école se maintenait, et la pratique de l’art, loin de s’abaisser, atteignait au milieu du XVe siècle un haut degré de perfection. L’ornementation des parties de la sainte Chapelle qui datent de Charles VII, ainsi que celle des édifices du temps de Louis XI, est parfois large et bien composée, préférable sous ce rapport à la sculpture de la fin du XIVe siècle, qui pèche par la maigreur et le défaut d’échelle ; toujours cette ornementation est exécutée avec une habileté surprenante. À voir les choses sans prévention, c’est bien plutôt cette école française du XVe siècle qui forme nos artistes de la renaissance que les relations avec l’Italie, comme nous l’expliquons ailleurs[75].
Les écoles laïques qui, dès la fin du XIIe siècle, s’emparèrent de la culture des arts, étaient parties d’un bon principe : solidarité entre les œuvres concourant à un ensemble monumental, et étude réfléchie de la nature. Si ces écoles subirent à certains moments les influences de la mode, ces écarts ne les détournaient pas de cette étude constante. C’était dans leur propre fonds qu’elles puisaient, non dans l’imitation d’arts étrangers à leur essence. Elles ne se faisaient ni grecques, ni romaines, ni byzantines, ni allemandes ; elles suivaient leur voie, elles vivaient dans leur temps, et leur temps les comprenait. C’était là une force, la force qui avait soutenu l’art grec. Si prévenu que l’on soit contre la sculpture du moyen âge, on ne saurait méconnaître son originalité ; cette qualité suffit à lui donner un rang élevé dans l’histoire des arts. À vrai dire, tout art qui manque d’originalité, qui ne vit que d’emprunts, ces emprunts fussent-ils faits aux meilleures sources, ne peut espérer conserver une place dans le cours des siècles ; il est bientôt effacé, et va remplir ces limbes où demeurent dans l’oubli toutes les œuvres qui n’ont possédé qu’une vie factice.
Le moyen âge a très-fréquemment coloré la statuaire et l’ornementation sculptée. C’est encore un point de rapport entre ces arts et ceux de l’antiquité grecque. La statuaire du XIIe siècle est peinte d’une manière conventionnelle. On retrouve, sur les figures de la porte de l’église abbatiale de Vézelay dont nous avons entretenu nos lecteurs, un ton généralement blanc jaunâtre ; tous les détails, les traits du visage, les plis des vêtements, leurs bordures, sont redessinés de traits noirs très-fins et très-adroitement tracés afin d’accuser la forme. Le même procédé est employé à Autun, à Moissac. Derrière les figures, les fonds sont peints en brun rouge ou en jaune d’ocre, parfois avec un semis léger d’ornements blancs. Cette méthode ne pouvait manquer de produire un grand effet. Rarement, dans la première moitié du XIIe siècle, trouve-t-on des statues colorées de divers tons. Quant aux ornements, ils étaient toujours peints de tons clairs, blancs, jaunes, rouges, vert pâle, sur des fonds sombres. C’est vers 1140 que la coloration s’empare de la statuaire, que cette statuaire soit placée à l’extérieur ou à l’intérieur. Les deux statues de Notre-Dame de Corbeil, dont nous avons parlé au commencement de cet article, étaient peintes de tons clairs, mais variés, les bijoux rehaussés d’or. Les statues du portail occidental de Chartres étaient peintes de la même manière. Quelquefois même des gaufrures de pâte de chaux étaient appliquées sur les vêtements, ainsi qu’on peut le constater encore au portail de la cathédrale d’Angers. Ces gaufrures étaient peintes et dorées, et figuraient des étoffes brochées ou des passementeries. Les nus de la statuaire, à cette époque, sont très-peu colorés, presque blancs et redessinés par des traits brun-rouge.
Il va sans dire que la statuaire des monuments funéraires était peinte avec soin, et c’est sur ces ouvrages d’art que l’on peut encore aujourd’hui examiner les moyens de coloration employés. Nous avons vu les statues des Plantagenets, à Fontevrault, entièrement couvertes de leur ancienne peinture avant le transport de ces figures au musée de Versailles.
Le XIIIe siècle ne fit que continuer cette tradition. La statuaire et l’ornementation des portails de Notre-Dame de Paris, des cathédrales de Senlis, d’Amiens, de Reims, des porches latéraux de Notre-Dame de Chartres, étaient peintes et dorées. Et de même que la sculpture, la coloration penchait vers le naturalisme. Toutefois cette peinture ne consistait pas seulement en des tons posés à plat sur les vêtements et les nus : l’art intervenait. Dans les plis enfoncés, dans les parties qui sont opposées à la lumière, ou qui pouvaient accrocher des reflets trop brillants, on reconnaît l’apposition de glacis obscurs. Des redessinés vigoureux en noir ou en brun donnent du relief au modelé, de la vie aux nus. Ainsi dans les fonds des plis de robes bleu clair, le peintre a posé un glacis roux ; d’autres fois a-t-on fait valoir des tons jaune pur, dans la lumière, par des glacis froids obtenus par du noir. Des artistes qui ont fait les admirables vitraux des XIIe et XIIIe siècles, avaient une connaissance trop parfaite de l’harmonie des couleurs pour ne pas appliquer cette connaissance à la coloration de la sculpture. Et, à vrai dire, cela n’est point aussi facile qu’on le pourrait croire tout d’abord. Les tentatives en ce genre que l’on a faites de notre temps prouvent que la difficulté en pareil cas est grande, au contraire, quand on veut conserver à la sculpture sa gravité, son modelé, et que l’on prétend obtenir autre chose que des poupées habillées. L’harmonie des tons entre pour beaucoup dans cette peinture d’objets en relief, et cette harmonie n’est pas la même que celle adoptée pour les peintures à plat. Ainsi, par exemple, dans les peintures à plat, les artistes du moyen âge mettent rarement l’un à côté de l’autre deux tons de couleurs différentes, mais de même valeur ; c’est une ressource dont ils n’usent qu’avec parcimonie. Dans la sculpture, au contraire, à dater du XIIIe siècle, ces artistes cherchent des tons de valeurs pareilles, se fiant d’ailleurs au modelé du relief pour empêcher qu’ils ne gênent le regard. En effet, les ombres naturelles neutralisent la dissonance qui résulte de la juxtaposition de deux tons d’égale valeur, et ces égales valeurs donnent aux reliefs une unité, une grandeur d’aspect, que des tons de valeurs très-dissemblables leur enlèveraient. Cette étude peut être faite sur quelques monuments colorés qui existent encore, comme par exemple le retable de la chapelle de Saint-Germer déposé au musée de Cluny, des tombeaux de l’abbaye de Saint-Denis, des parties des bas-reliefs de Notre-Dame d’Amiens (portail occidental), de Notre-Dame de Reims (porte nord, masquée). C’est surtout dans la grande sculpture extérieure que l’on peut constater ce système de coloration pendant la première moitié du XIIIe siècle. Une statue est-elle revêtue d’une robe et d’un manteau, le peintre, adoptant le bleu pour la robe et le pourpre pour le manteau, a préparé ses deux tons de manière qu’ils présentent à l’œil une même valeur. Chaque couleur a une échelle chromatique de nuances ; en supposant pour chaque couleur une échelle de cinq nuances, l’artiste, pour une même figure, adoptera, par exemple, les tons bleu et pourpre no 3, mais bien rarement no 2 et no 3. Ainsi ces colorations laissent-elles à la sculpture sa grandeur. Plus tard, au contraire, vers la fin du XIIIe siècle, les peintres de la sculpture cherchent les oppositions. Ils poseront sur une même statue un ton rose et un ton bleu foncé, vert blanchâtre et pourpre sombre. Aussi la sculpture peinte, à dater de cette époque, perd-elle la gravité monumentale qu’elle avait conservée pendant la première moitié du XIIIe siècle. On ne tarda pas cependant à reconnaître les défauts de cette coloration heurtée, vive, brillante et trop réelle, car vers la fin du XIVe siècle, tout en conservant des tons de valeurs différentes sur une même statue, on couvrit si bien ces tons de détails d’ornements d’or, bruns, noirs, que ce réseau dissimulait les oppositions de couleurs et rendait de l’unité à l’ensemble de la figure. Les colorations de la statuaire ou de la sculpture d’ornement au XVe siècle sont plus rares à l’extérieur des édifices. Ces peintures sont réservées pour les tombeaux, les retables, les meubles et bas-reliefs intérieurs. Toutefois on trouve encore à cette époque des traces de colorations extérieures : ainsi les statues dont nous parlions tout à l’heure, qui ont été découvertes dans les ruines du château de Pierrefonds, et qui décoraient les façades, les tours, étaient peintes, mais de trois tons seulement : le jaune, le brun rouge et le blanc. Presque toute la sculpture de l’hôtel de Jacques-Cœur, à Bourges, était peinte ; on distingue encore quelques traces des tons employés.
Pendant la renaissance encore reste-t-il quelques traces de ces traditions, malheureusement perdues définitivement depuis le XVIIe siècle.
Il faut reconnaître que la peinture appliquée à la sculpture lui donne une valeur singulière, mais à la condition que cette application soit faite avec intelligence et par des artistes qui ont acquis l’expérience des effets de la couleur sur des objets modelés, effets, comme nous le disions plus haut, qui ne sont point ceux produits sur des surfaces plates. Des tons très-sombres, par exemple, qui seraient lourds et feraient tache sur une peinture murale, prennent de l’éclat sur des reliefs. Un ton noir posé sur le vêtement d’une statue, par l’effet de la lumière, se détacherait en clair sur un fond de niche brun rouge. Cette sorte de peinture demande donc une étude spéciale, une suite d’observations sur la nature même, si l’on veut obtenir des résultats satisfaisants. Mais déclarer que la peinture appliquée sur la sculpture détruit l’effet de celle-ci, que c’est la conséquence d’une dépravation du goût, parce que quelques badigeonneurs ont posé du rouge ou du bleu au hasard sur des statues et que cela est ridicule, c’est juger la question un peu vite, d’autant que les Grecs ont de tout temps peint la sculpture comme ils peignaient l’architecture ; ils ne sauraient cependant être considérés comme des barbares. Malgré des abus, l’art de la période du moyen âge vers son déclin manifestait encore une grande force vitale. La sculpture à cette époque n’est point tant à dédaigner qu’on veut bien le dire : elle possède un sentiment de l’effet, une expérience longuement acquise, qui lui donnent une grande importance ; elle atteint d’ailleurs une parfaite sûreté d’exécution. De cette école sont sortis nos meilleurs artistes de la renaissance.
Pour conclure, il ne faut pas demander à l’art de la sculpture du moyen âge des modèles à imiter, pas plus qu’il n’en faudrait demander aux arts de la Grèce. Ce qu’il faut y chercher, ce sont les principes sur lesquels ces arts se sont appuyés, les vérités qu’ils ont su aborder, la manière de rendre les idées et les sentiments de leur temps. Faisons comme ils ont fait, non ce qu’ils ont fait. Il en est de cela comme de la poésie : celle-ci est toujours nouvelle et jeune, parce qu’elle réside dans le cœur de l’homme ; mais tout attirail poétique vieillit, même celui de Virgile, même celui d’Homère.
Le lever du soleil est toujours un spectacle émouvant et neuf ; et si nos premiers parents pouvaient dire que les cavaliers célestes, les Acwins, précédaient le char de Sâvitri à la main d’or ; Homère, que l’Aurore aux doigts de rose ouvrait les portes de l’Orient ; les trouvères, que le soleil sortait des flots ou de la plaine ; ne devrions-nous pas dire : « Dans leur révolution, nos plaines, nos montagnes, de nouveau se présentent aux rayons du soleil. » En faisant tomber de leur sphère surnaturelle tous les mythes poétiques des Védas, de l’antique Hellade, n’avons-nous pas aperçu, derrière ces personnifications des forces de la nature, des horizons bien autrement étendus, et l’épopée scientifique de la formation de l’univers n’offre-t-elle pas à l’esprit de l’homme une large pâture, sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir les Titans et le règne de Saturne ? Soyons vrais : dans l’art, c’est à la vérité seule qu’il faut demander la vie, l’originalité, la source intarissable de toute beauté.
- ↑ Commencement d’un ouvrage (Diog. Laerce, II, 6 ; Walken, Diatrib. in Euripid. fragm.).
- ↑ Voyez Architecture Monastique.
- ↑ Voyez l’ouvrage de M. le comte Melchior de Vogué et de M. Duthoit, sur les villes entre Alep et Antioche (Syrie centrale).
- ↑ M. Paul Durand a calqué un grand nombre de ces peintures qui datent des VIIIe, IXe, Xe et XIe siècles, et qui sont du plus beau style. Il serait fort à désirer que ces calques fussent publiés.
- ↑ Il ne faut pas prendre ici la peinture grecque telle, par exemple, que les moines du mont Athos l’ont faite depuis le XIIIe siècle et la font encore aujourd’hui. C’est là un art tout de recettes, figé ; les peintures des manuscrits des VIIIe, IXe et Xe siècles ont un caractère plus libre et une tout autre valeur. Nous en dirons autant des peintures grecques recueillies par M. Paul Durand.
- ↑ Voyez Porte, fig. 66, et le texte qui accompagne cette figure.
- ↑ Voyez dans les œuvres de Dioscoride de la bibliothèque impériale de Vienne, manuscrit du VIe siècle, la miniature représentant Juliana Anicia ; les manuscrits grecs, nos 139, 64, 70 de la bibliothèque impériale de Paris, Xe siècle ; les manuscrits de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise ; celui conservé au Louvre. Beaucoup de vignettes de ces manuscrits se font remarquer par la grandeur et l’énergie des compositions, par la netteté du geste et par la physionomie tout individuelle de certains personnages. Dans son Histoire des arts au moyen âge, M. Labarte a reproduit fidèlement quelques-unes de ces vignettes. Dans le même ouvrage on peut voir des copies d’ivoire du Ve au XIe siècle byzantin, obtenues par la photographie, qui forment, par leur caractère hiératique, un contraste frappant avec ces peintures.
- ↑ Voyez Hôtel-de-Ville, fig. 1, 2 et 3.
- ↑ Cette tête, comme toutes les sculptures de cet édifice, était peinte. On voit encore la trace des prunelles d’un ton gris bleu.
- ↑ Autant que possible ces dessins sont faits sur des moulages que nous possédons, ou sur des photographies.
- ↑ Les deux statues de Notre-Dame de Corbeil étaient peintes. On voit encore sur la tête de la femme la coloration des sourcils et des prunelles. Mais nous devons revenir sur cette question de la peinture de la statuaire.
- ↑ Voyez Aug. Thierry, Lettres sur l’histoire de France, VIe « Quippe omnes fere sunt fabri lignarii, et ex hac arte mercedem capientes, semetipsos alunt. » Socratis. Hist. Éccl. lib. VII, cap. XXX, apud Script. rer. Gallic. et Franc., t.I, p. 604.
- ↑ Un magnifique sarcophage de marbre du XIIe siècle.
- ↑ Le cloître.
- ↑ Nous parlons ici du tympan de la porte Sainte-Anne (porte de droite, de la façade occidentale) lequel date de 1140 environ.
- ↑ Voyez Porte, fig. 68.
- ↑ Nous n’exagérons pas. Possédant des moulages de quelques-unes des têtes provenant de cette porte, il nous est arrivé de les montrer à des sculpteurs, dans notre cabinet. Frappés de la beauté des types et de l’exécution, ceux-ci nous demandaient d’où provenaient ces chefs-d’œuvre. Si nous avions l’imprudence de leur avouer que cela était moulé sur une porte de Notre-Dame de Paris, immédiatement l’admiration tombait dans la glace. Mais si, mieux avisés, nous disions que ces moulages venaient de quelque monument d’Italie — or au commencement du XIIIe siècle la sculpture italienne était assez barbare — c’était une recrudescence d’enthousiasme. Le dogmatisme académique, non seulement ne permet pas d’admirer ces œuvres françaises, mais il considère comme une assez méchante action de les regarder. Tout au moins ce serait une bien mauvaise note.
- ↑ Phédon, trad. de V. Cousin, édit. de 1822. Bossange, tome I, page 243.
- ↑ Les planches jointes à cet article ont toutes été dessinées soit sur des estampages, à la chambre claire, soit d’après des photographies, soit sur les originaux, de même à l’aide de la chambre claire. Nous faisons cette observation, parce que, de bonne foi d’ailleurs, quelques personnes ont prétendu que nous donnions à la statuaire du moyen âge un caractère de beauté qu’elle ne possède pas. Nous ne saurions accepter cette critique flatteuse. Mais serait-elle vraie qu’elle prouverait que l’étude de cette sculpture peut conduire ceux qui s’y livrent à faire mieux tout en conservant son style et son caractère ; donc cette étude ne serait pas une mauvaise chose.
- ↑ Sur un édifice récent, qu’il est inutile de citer, nous avons compté vingt-deux têtes de la Vénus de Milo, autant que de statues. Sur l’observation que nous faisions à un sculpteur de cet abus d’un chef-d’œuvre, il nous fut répondu : « Ces statues étaient si mal payées ! » Soit, mais alors qu’on ne vienne pas mettre en avant les intérêts de l’art.
- ↑ Il y a déjà plus de dix ans, notre belle statuaire des XIIe et XIIIe siècles a été moulée pour être envoyée en Angleterre, et former des musées comparatifs du plus grand intérêt, à tous les points de vue. À la même époque nous avons offert d’envoyer, sans frais de moulages, des épreuves de ces modèles pour en former à Paris un musée de statuaire comparée. Il n’a pas été répondu à cette offre.
- ↑ Nous ne nous servons pas du mot naïf qui nous semble appliqué fort mal à propos lorsqu’il s’agit des arts dits primitifs. Sculpter un lion comme les Égyptiens, en supprimant quantité de détails, mais en rendant d’autant mieux l’allure imposante de cet animal, cela n’est point de la naïveté ; tout au contraire, c’est le résultat d’un art très-réfléchi et très-sûr de ce qu’il fait.
- ↑ Apocalypse de saint Jean, chap. VI, v. 8.
- ↑ Voyez Maison, figure 11.
- ↑ Voyez le Recueil de photographies d’après les monuments de l’église abbatiale de Saint-Denis, publié par M. Fichot.
- ↑ Voyez la Monographie de la cathédrale de Chartres, publiée par Lassus, sous les auspices du Ministre de l’Instruction publique.
- ↑ Ce fait de vandalisme toléré par la police des villes n’empêche pas ces mêmes villes de posséder des Sociétés archéologiques qui lisent force mémoires, qui prêchent volontiers contre les restaurations qu’elles ne dirigent point à leur gré. Ne feraient-elles pas bien aussi d’obtenir de leurs édiles une police un peu plus attentive à l’endroit de ces mutilations perpétuelles de monuments uniques et de grande valeur ? Des deux siècles, au point de vue de l’art, quel est le barbare ? Est-ce celui qui a su inspirer ces sculptures et qui possédait, dans de petites capitales de province, des artistes capables de les exécuter, ou celui qui laisse détruire ces ouvrages par quelques polissons désœuvrés ?
- ↑ L’Architecture du Ve au XVIIe siècle et les arts qui en dépendent, t. I, Porche sept. de l’égl. cath. de Chartres et les détails.
- ↑ Alt-Christliche baudenkmale von Constantinopel. Berlin, 1854.
- ↑ Paris, Noblet et Baudry, 1865.
- ↑ Arch. romane du midi de la France, par H. Revoil, architecte. Paris, Morel, 1864.
- ↑ Voyez Chapiteau, fig. 18.
- ↑ Voyez Porte, fig. 51.
- ↑ IV Évang. lat. Sax. Bib. Cotton. Nero D. IV, p. 57. Brit. Museum, XIIe s.
- ↑ Voyez l’ouvrage de M. W. Salzemberg. Alt-Christliche baudenkmale von Constantinopel…, Berlin, 1854.
- ↑ Il faut dire que l’école de statuaire du Poitou est supérieure à celle de la Saintonge, mais ces deux écoles ne diffèrent entre elles que par la qualité de l’exécution, les artistes poitevins étant très-supérieurs aux artistes saintongeois. Quant au style, il est le même dans ces deux provinces.
- ↑ Il est clair que nous entendons ici l’art dit arabe, mais qui, de fait, est en grande partie dû aux artistes de l’époque des Sassanides.
- ↑ Les monuments gallo-romains étaient très-abondants en Auvergne, notamment au Puy en Vélay.
- ↑ Du cloître de la cathédrale du Puy en Vélay ; partie du XIIe siècle.
- ↑ Fragments romans replacés aux portes nord et sud, lors de la reconstruction de la cathédrale au XIIIe siècle.
- ↑ Chapiteaux de l’abside dont la construction remonte aux premières années du XIIe siècle. Nous devons ces dessins à M. Bœswilwald qui a bien voulu nous communiquer les études très-détaillées faites par lui sur cet intéressant monument.
- ↑ Voyez Flore.
- ↑ Voyez, à ce sujet, les deux excellents articles de notre ami si justement regretté, M. Félix de Verneilh, dans les Annales archéologiques, t. XXIII, p. 4 et 115.
- ↑ Voyez les Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres des croisades, par M. Reinaud, 1829.
- ↑ Des colonnes monostyles des collatéraux de l’abside.
- ↑ Annales archéologiques, t. XXIII, p. 128.
- ↑ Il faut observer ici comment les sculptures étaient faites en chantier dès cette époque, c’est-à-dire avant la pose. Notre figure donne deux assises de l’ornement montant. On voit parfaitement que le raccord entre les deux portions d’ornement, au lit de la pierre, ne se fait pas exactement, ce qui n’est possible qu’à la condition de ravaler et de sculpter sur le tas.
- ↑ Voyez figure 44.
- ↑ Le rinceau qui fait pendant à celui-ci imite les bourgeons de la fougère au moment où ils se développent.
- ↑ L’un des chapiteaux des piles cylindriques du chœur.
- ↑ Il n’existe pas une seule représentation d’animal dans les chapiteaux de Notre-Dame de Paris, bien qu’à cette époque (seconde moitié du XIIe siècle), on en sculptât encore dans beaucoup d’autres édifices.
- ↑ Nous devons les dessins de ces fragments à l’obligeance de M. Sauvageol.
- ↑ Chapiteaux du triforium.
- ↑ Ce n’est pas la première fois que nous signalons l’activité des constructeurs du moyen âge. La nef et une grande partie de la façade de Notre-Dame de Paris furent élevées en dix ans au plus ; la nef de la cathédrale d’Amiens et le pignon de la façade, d’où proviennent les fragments ci-dessus, étaient achevés en six ou sept ans. Le château de Coucy, si important, fut construit en peu d’années. De ce qu’un grand nombre de ces constructions ont été interrompues pendant des demi-siècles, faute de ressources, ou par suite de malheurs publics, puis reprises, puis interrompues, puis continuées, on en conclut qu’elles s’élevaient très-lentement. C’est une erreur : toutes fois que l’on construisait, pendant le moyen âge, on construisait très-vite.
- ↑ On n’avait pas inventé alors l’art industriel, dénomination qui démontre combien nous avons perdu le vrai sens de l’art.
- ↑ Remarquons encore ici que, dans nos musées de Paris ou de province, dans nos écoles, il n’y a pas un seul moulage de cette statuaire pouvant servir à l’enseignement ; et c’est nous qui sommes les gens exclusifs !
- ↑ Porte de droite, dont la partie inférieure date de 1250 à 1260.
- ↑ Il est entendu qu’en parlant du XVe siècle, nous ne nous occupons que de la véritable école française, en laissant de côté les magots flamands, sur lesquels habituellement on juge notre art.
- ↑ Ce tombeau date de 1320 environ.
- ↑ On détruisit un grand nombre de monuments de bronze vers la fin du règne de Louis XIV. Ce fut à cette époque que toutes les tombes de métal et les décorations du chœur de Notre-Dame de Paris furent fondues, afin d’aider à l’arrangement du nouveau chœur.
- ↑ Voyez l’article Tombeau, dans lequel nous présentons quelques-uns de ces monuments.
- ↑ Voyez la Monographie de Saint-Yved de Braisne, par M. Stanislas Prioux.
- ↑ La collection Gaignères d’Oxford, bibliothèque Bodléienne, conserve un dessin colorié de ce tombeau.
- ↑ Voyez, pour ces objets de bronze destinés à la décoration intérieure, le Dictionnaire du mobilier.
- ↑ Il en est de cette singulière prétention comme de beaucoup d’autres du même temps. On répète partout, par exemple, que la brouette a été inventée sous Louis XIV ; or, il est vingt manuscrits du XIIIe et du XIVe siècle dont les vignettes présentent des brouettes beaucoup moins grossières que celles de XVIIe siècle. Le haquet est, dit-on encore, inventé par Pascal ; l’invention ne lui ferait pas grand honneur, mais elle ne lui appartient pas. On voit des haquets figurés dès le XIVe siècle.
- ↑ Voyez Pignon, fig. 8 et 9.
- ↑ Ces statues mesurent 2m,15 (voy. Pignon, fig. 9).
- ↑ Cette figure est placée à la droite du Christ.
- ↑ Voyez Salle, fig. 1 et 2.
- ↑ « Ci commence li force des trais de portraiture si con li ars de iométrie les ensaigne por legierement ovrer… » Ici commence la méthode du tracé pour dessiner la figure ainsi que l’enseigne l’art de la géométrie pour facilement travailler. (Voyez l’Album de Villard de Honnecourt, publié en fac-simile, par J. B. Lassus et Darcel, pl. 34, 35, 36 et 37.)
- ↑ Voyez la planche 36 de l’Album de Villard de Honnecourt
- ↑ Voyez la Notice de M. Goze, correspondant du Comité des arts et monuments, sur ces statues remarquables.
- ↑ Deux des neuf preux qui donnaient leurs noms aux tours du château. Ces statues ont 2m,30 de haut. Ces preux portent les habits de guerre des dernières années du XIVe siècle, rendus avec une remarquable souplesse.
- ↑ Voyez l’Architecture domestique de MM. Verdier et Cattois, t. II, p. 60.
- ↑ Voyez Architecture.


